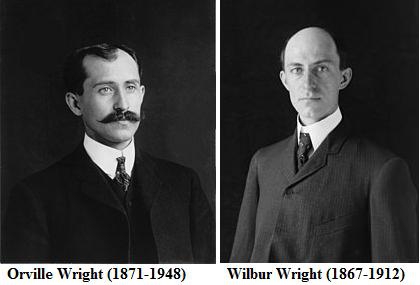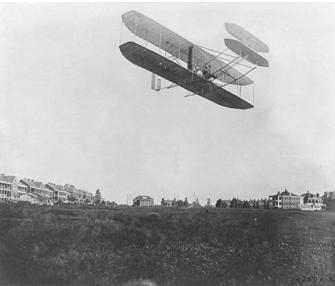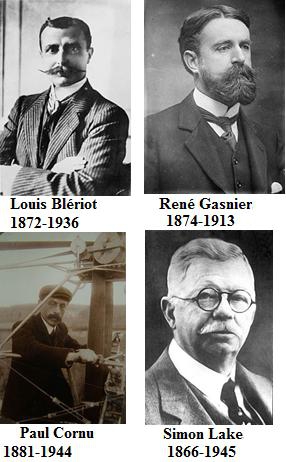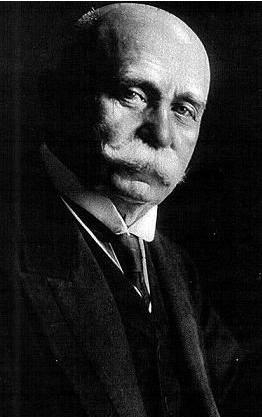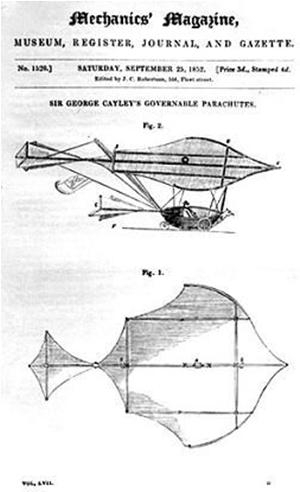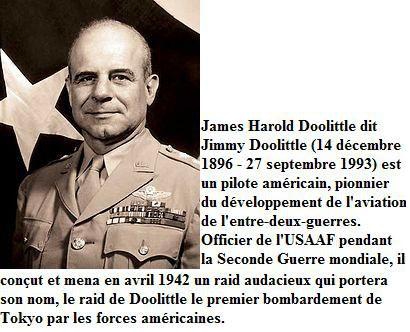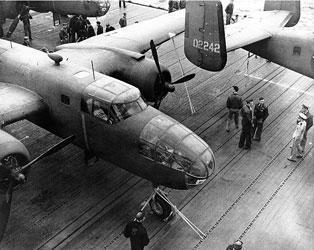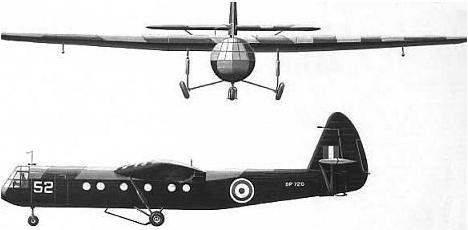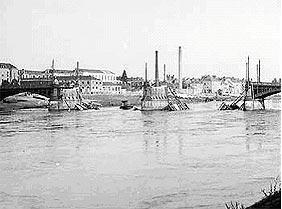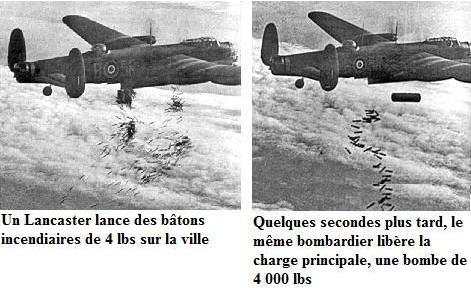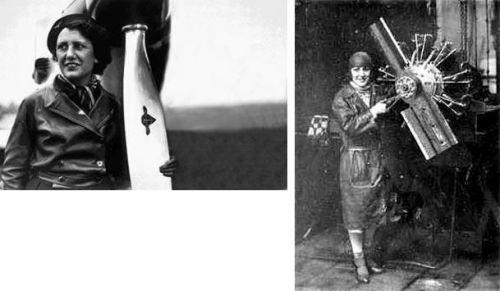AVIATION 1900 À 1939
LES FRÈRE WRIGHT
Le Wright Flyer est l'avion avec lequel les frères Wright effectuèrent les premiers vols contrôlés et motorisés de l'histoire de l'aviation, à Kitty Hawk en Caroline du Nord le 17 décembre 1903.
Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Après des vols de mise au point sur planeurs, ils ont effectué en 1903 le premier vol motorisé contrôlé d'un avion. Ils se sont distingués de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains par leur approche analytique et expérimentale du problème. Leur contribution essentielle sera d'avoir correctement analysé la mécanique de vol du virage et d'avoir réalisé, en 1902, les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la gouverne de direction et du gauchissement (obtenu par vrillage) des ailes. Maîtrisant le pilotage, ils effectuent en 1903 le premier vol motorisé, et en 1905 les premiers vols pouvant être qualifiés de « stables », de longue durée, avec des virages inclinés et non dérapés. Cependant, leur obsession du secret autour de leurs machines et de leurs capacités à réaliser un vol motorisé contrôlé (qu'ils maintiendront presque totalement jusqu'à l'obtention de brevet d'invention en 1905) entraînera un scepticisme général, en particulier en Europe, quand ils commenceront à communiquer en 1905 tout en exigeant un contrat commercial ferme avant toute démonstration. Ce qui explique le décalage de plusieurs années entre les premiers vols contrôlés de 1905, à l'écart de tous spectateurs dans les dunes de Virginie, et les vols publics de 1908 où leur maîtrise du pilotage sera reconnu. Consacrant leur énergie à protéger leur invention et à des luttes de brevets, ils ne remettent pas en cause la configuration atypique de leur machine (configuration canard, pas d'ailerons, pas de roues, hélices à l'arrière), qui est obsolète en 1910 et ne sera pas poursuivie.
Octave Chanute 1832-1910
Les frères Wright sont originaires de Dayton dans l'Ohio, où ils possèdent un atelier de bicyclettes. En relation avec Octave Chanute, ils réalisent en 1899 un planeur à échelle réduite de type cellulaire (biplan à haubans) et, innovation majeure, muni d'un contrôle du gauchissement de la voilure. Ce planeur est essayé en vol comme un cerf-volant, piloté depuis le sol. Dès le début, et suivant les recommandations de Chanute, les frères Wright ont compris l'importance et la nécessité de l'expérimentation et du contrôle (du pilotage) de la machine.
Planeurs, de 1900 et 1902
Wright planeur 1902.
En 1900, ils réalisent un planeur de plus grande dimension (5,30 mètres d'envergure), capable de porter un pilote. Ce planeur, qui comporte maintenant une gouverne de tangage placée à l'avant, est essayé d'abord en cerf-volant, puis piloté pour la première fois le 20 octobre 1900. Ces essais en vol plané amènent des modifications : pour mieux planer, l'envergure est augmentée à 6,70 m. Pour étudier le profil qui convient à la portance des ailes, ils construisent la première soufflerie dans leur atelier dès 1901. D'autres essais en 1901 montrent la nécessité d'augmenter encore l'envergure (9,75 m) et d'installer une gouverne de direction, disposée à l'arrière, pour contrôler la trajectoire. Avec ce planeur modifié, ils arrivent à maîtriser la trajectoire de vol de leur planeur, et effectuent en 1902 environ sept cents vols planés, d'une longueur de 150 à 200 mètres. Bien que cela soit rarement souligné, la pilotabilité de ce planeur représente en fait l'avancée majeure des frères Wright au début de l'aviation.
Flyer
Premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 sur Flyer
Capables de concevoir et de réaliser une machine qui vole et maîtrisant le pilotage, ils s'attaquent alors au problème de la propulsion et construisent dans leur atelier leur propre moteur et les hélices. Leur premier vol motorisé se déroule à Kitty Hawk en Caroline du Nord le 17 décembre 1903, avec l'appareil baptisé Flyer.
Flyer II
Wright Flyer II en Ohio, 1904.
L'année suivante, avec un nouvel appareil au pilotage également difficile, le Flyer II, ils parviennent à effectuer des virages. Orville Wright effectue le 20 septembre 1904 le premier vol en circuit fermé de l'histoire.
Flyer III
Wright Flyer à Fort Myer (Virginie) en 1908.
Les premiers essais ne sont pas satisfaisants, mais après une mise au point de plusieurs mois, le succès arrive : le Flyer III de 1905 vole mieux et effectue un vol record de 39 minutes. Conscients de leur réussite et pour protéger les droits sur leur invention, les frères Wright n'ont convié aucun témoin ni journaliste pour attester la réalité du vol motorisé contrôlé, et ne communiquent ni plans, ni photos. En 1906 et 1907, les frères Wright se consacrent à la gestion de leur affaire, et plus aucun vol n'est réalisé, dans l'attente de l'octroi d'un brevet d'invention. Cette discrétion, volontairement entretenue par les frères Wright, fera que beaucoup pourront de bonne foi douter des possibilités réelles du Flyer ; les Wright devront par la suite procéder à des vols de qualification exigeants lorsqu'ils démarcheront des clients pour vendre leur invention.
Flyer Model A
Prenant des contacts avec l'US Army en 1908, ils vont pouvoir montrer leur savoir-faire avec un modèle plus puissant, et biplace.
Démonstrations aux États-Unis
Thomas Etholen Selfridge 1882-1908
Orville réalise des démonstrations de plus en plus spectaculaires sur le site de Fort Myer (Virginie), emportant un passager à plusieurs reprises. Un incident (rupture d'une hélice) va avoir une conséquence tragique : le 17 septembre 1908 son avion s'écrase, le passager, Thomas Etholen Selfridge, est tué et Orville est gravement blessé.
Démonstrations en France
En même temps, un contrat est conclu avec la Compagnie générale de navigation aérienne de Lazare Weiller, pour un accord de licence sur le Flyer sous réserve de performances et de formation de trois pilotes. Wilbur a transporté un Model A en France et, installé au Mans depuis le 15 juin, le fait voler à partir d'août 1908, notamment aux Hunaudières.
Spectateurs et concurrents
Le Flyer vole le 8 août aux Hunaudières en présence d'une centaine de personnes dont Louis Blériot et René Gasnier, membres de l'Aéro-Club de France, et au Camp d'Auvours, près du Mans où il est hébergé par les frères Amédée et Léon Bollée. Parmi les personnes qui assistent aux vols : Paul Cornu et Ponton d'Amécourt, inventeurs de l'hélicoptère, Simon Lake, inventeur des sous-marins, etc. En octobre, on remarquera dans l'assistance les aviateurs Henri Farman, Léon Delagrange, Robert Esnault-Pelterie, René Gasnier. Les frères Wright ont également effectué un de leurs premiers vols en avion au camp d'Auvours à Champagné (Sarthe).
Passagers
Paul Tissandier 1881-1945
L'aviateur Ernest Zens sera le premier passager français de Wilbur Wright au Camp d'Auvours (15 septembre 1908). Paul Tissandier, présent au Mans pendant trois semaines, sera son compagnon de bord le 28 suivant : C'est vraiment à n'y pas croire, dira-t-il. Les détracteurs des frères Wright changeraient immédiatement d'avis s'ils pouvaient comme moi tout à l'heure, s'envoler dans cet admirable engin. En juillet à Turin, Thérèse Peltier serait la première femme qui ait pris place sur un aéroplane, le biplan Voisin de Léon Delagrange.
École de pilotage
Stèle au nom de la première école au monde de pilotage, devant l'aéroport de Pau-Pyrénées
Deux élèves-pilotes français ont commencé leur formation sur le Flyer dès l'automne 1908 au Camp d'Auvours avec Wilbur Wright : il s'agissait du comte Charles de Lambert et du capitaine Lucas-Girardville du Parc Aérostatique de Chalais-Meudon. La formation progressant lentement à cause de conditions aéro-météorologiques défavorables au Mans à l'automne 1908, Wilbur Wright accepte la proposition du Comité d'aviation de Pau de poursuivre les vols sur la lande du Pont-Long près de Pau, là où les conditions aérologiques hivernales sont généralement favorables comme l'attestent les relevés (effectués par le Dr Meunier depuis plusieurs années) qui lui sont présentés. Le premier janvier, l'aviateur américain commence ses préparatifs de départ, le Flyer sera démonté et expédié à Pau. Rejoint par Orville convalescent suite à son accident de Fort Myer, Wilbur organise la reprise de ses démonstrations en janvier 1909 à Pau. Il reprend ses vols le 3 février 1909 au Pont-Long, où il jette les bases de l'école de pilotage en poursuivant la formation de leurs élèves Charles de Lambert et le capitaine Lucas-Girardville, auxquels s'ajoute Paul Tissandier qui débute. Au début de mars 1909, à Pau-Pont Long, l'aviateur américain achèvera la formation de Paul Tissandier, auquel les frères Wright transmettent la responsabilité de l’École de pilotage Wright. Après le départ définitif des frères Wright (Wilbur quitte la France le 24 mars 1909), l’École Wright continuera son activité jusqu'en 1910 sous la direction de Paul Tissandier. Celui-ci à son tour emmènera son premier élève, l'aéronaute et aviateur René Gasnier, d'Angers, qui obtiendra son brevet de pilote aviateur le 8 mars 1910. Paul Tissandier formera également sur appareil Wright A le capitaine Albert Etévé, le capitaine Largier et le comte E. Malynski.
Charles de Lambert 1865-1944
Records
Le 13 novembre 1908, Wilbur Wright gagne le prix de la hauteur de la Sarthe dépassant facilement les 30 mètres imposés, en atteignant 45 puis 60 mètres d'altitude.
Le 31 décembre 1908, Wilbur Wright vole une dernière fois à Auvours pendant 2 h 20 min 23 s, couvre une distance de 124,7 km et remporte la Coupe Michelin.
La première photo en aéroplane
Elle aurait été prise par M. Bonvillain de la maison Pathé, à Auvours.
La Wright Company
Après d'autres démonstrations en Italie, les frères rentrent aux États-Unis en mai 1909, et fondent la Wright Company. Mais leur conception n'a pas beaucoup évolué ; elle est maintenant dépassée. Les frères Wright devront modifier leurs modèles.
Wilbur Wright meurt de la typhoïde en 1912 ; en 1915, Orville vend la Wright Company, fondée en 1909, à des investisseurs de New York. Elle fusionnera plus tard avec la Glenn L. Martin Company pour former la Wright-Martin. Elle subsiste actuellement dans la Curtiss-Wright Corporation.
Orville Wright fut lauréat de la Médaille Franklin en 1933. Il décède en 1948.
LA PREMIÈRE VICTOIRE AÉRIENNE

Joseph Frantz. Né le: 17 août 1890 à Beaujeu (Rhône). Mort le: 12 septembre 1979
Le sergent pilote Joseph Frantz, photographié en 1914, peu de temps après avoir reçu la Légion d’honneur pour son combat du 5 octobre, à l’issue duquel il avait remporté la première victoire officiellement homologuée. Joseph Frantz ouvrit l’ère du combat aérien le 5 octobre 1914 en abattant un Aviatik allemand.
Né le 17 août 1890 à Beaujeu (Rhône), Joseph Frantz entendit dès sa prime enfance parler des frères Montgolfier, qui avaient possédé un château dans la région. Un tel voisinage, encore enjolivé par l’imagination enfantine, suscita chez lui une passion précoce pour les choses de l’air.
Son père (qui fut le premier fabricant de limonade) ayant fait faillite, Frantz fut accueilli par un parent, qui possédait une confiserie à Romainville. Passionné de mécanique, le jeune garçon était chargé de l’entretien des machines, ce dont il s’acquittait avec zèle. Quant à ses moments de loisir, il les passait sur le terrain d’Issy-les-Moulineaux, offrant volontiers ses services pour tenir les appareils avant le décollage (à l’époque, on n’avait pas encore pensé à caler les roues).
Toujours à l’affût de l’heureux hasard qui lui permettrait d’accéder au monde de l’aéronautique, Frantz, ayant appris que la firme Pischoff et Koechlin recherchait un apprenti, se présenta à Juvisy et fut engagé. Il découvrit ainsi les moteurs d’avion et put même rouler sur des appareils au sol. Efficace et passionné par son travail, il devint bientôt chef mécanicien de la firme.
L’école Pivot, qui utilisait des avions Pischoff et Koechlin, ayant été transférée à Mourmelon, Frantz dut, à cette occasion, traverser une route en roulant avec un avion. Il était si enthousiaste qu’il décolla, et Koechlin, qui le regardait voler, le « bombarda » chef pilote. Le 16 janvier, il obtenait sans difficulté son brevet (n° 63) à Mourmelon. Après avoir été moniteur à Chartres, il fut engagé par la maison Savary, qui lui offrait un salaire mensuel de 300 francs net, plus le prix des exhibitions et un demi-louis par passager, quand il s’en présentait.
Il participa ainsi à de nombreuses manifestations (Périgueux, Gaillac, Ussel), et en particulier au Concours de Reims de 1911, dans lequel Savary l’avait engagé en compagnie de Level, chef pilote de la firme. Celui-ci s’étant tué au cours des épreuves, Frantz dut continuer seul. La course se terminait par un vol Reims-Amiens. Trente-quatre concurrents restaient en ligne pour cette finale, dont six seulement parvinrent au but. Frantz arriva sixième.
Après le décès de Level, il fut tout naturellement promu chef pilote, et, en 1912, lorsqu’il fut appelé sous les drapeaux, son employeur continua à lui verser régulièrement son salaire. Dès avril, avant de partir à l’armée, Frantz avait passé avec succès les épreuves du brevet militaire, qui consistaient à parcourir 300 km en trois étapes de 100 km. Ayant bénéficié d’un temps très favorable, il put franchir sans problème la distance Chartres-Orléans et retour trois jours consécutifs.
Il fit son service militaire dans une caserne modèle et eut la possibilité de se rendre souvent sur le terrain de Savary, ce qui lui donna l’occasion de battre plusieurs records d’altitude et de durée en volant 4 h 27 mn avec deux passagers. En mai 1913, Frantz participa aux manoeuvres du camp de Mailly. Ayant à son actif 8 h 50 mn de vol en reconnaissance, il faisait figure de pilote chevronné en la matière et fut le seul à ramener son avion intact, ce qui lui valut le grade de caporal. Il prit également part, sur Breguet, aux grandes manoeuvres du Sud-Ouest et, à cette occasion, effectua le parcours Étampes-Toulouse avec retour par Bordeaux et Tours.

Joseph Frantz aux commandes d’un biplan Robert Savary, qu’il présentait au Concours militaire de Reims en 1911.
La maison Savary ayant cessé toute activité peu avant la guerre, Frantz devint pilote d’essai chez Voisin (où il testa notamment le fameux triplan de 45 m d’envergure) avant de se voir doté du titre de 9 (spécialiste des avions lourds). Son ami Quenault, mécanicien chez Savary, le suivait dans tous ses déplacements. Les deux hommes étaient liés par une grande amitié et, quand éclata la Première Guerre mondiale, ils devaient écrire ensemble l’une des pages les plus étonnantes de l’histoire de la chasse.
A l’époque, on considérait le combat aérien comme parfaitement illusoire, et ceux qui, prophétiquement, l’envisageaient ne suscitaient que sarcasmes. Raymond Saulnier, par exemple, avait essayé d’approfondir l’idée du tir axial. Il contacta les autorités, mais personne ne prit la peine de lui répondre, cette idée étant jugée tout à fait fantaisiste!
Si beaucoup se passionnaient pour l’aviation, presque tous s’accordaient à ne lui reconnaître qu’un rôle mineur, limité à des opérations de reconnaissance. Les aviateurs eux-mêmes étaient admirés, certes, mais en même temps considérés comme des farfelus, inconscients du danger qu’ils couraient. Tel était l’état d’esprit qui régnait au début de la guerre, lorsque Frantz fut affecté au 2è groupe aéronautique.
Effectuant avec brio toutes les opérations de reconnaissance qui lui étaient confiées, il tenta également d’engager quelques combats. Un capitaine russe du nom de Nesteroff avait détruit un avion allemand dès le 8 septembre 1914, mais le vainqueur avait lui-même trouvé la mort dans ce premier combat. Les Allemands, de leur côté, essayaient également d’abattre des pilotes français.
C’est ainsi que l’un d’entre eux avait tiré trois balles sur l’avion de Levavasseur, lequel s’aperçut à son retour dans les lignes françaises que l’un des projectiles avait traversé son coussin. Dès lors, malgré l’avis contraire de ses supérieurs hiérarchiques, le chef d’escadrille de Frantz décida d’équiper de mitrailleuses les appareils de la V.24.
Lorsque Frantz prit l’air le 5 octobre 1914, il avait déjà tiré en vain sur douze avions. Comme d’habitude, il était accompagné de Quenault, et tous deux commençaient à penser que leurs tentatives étaient inutiles. Ce jour-là, alors qu’ils étaient à 1 800 m d’altitude au-dessus de la vallée de la Vesle, ils aperçurent un Aviatik qui volait au-dessous d’eux, regagnant les lignes allemandes, et décidèrent d’essayer de l’intercepter.
Il s’agissait pour eux d’un véritable travail d’équipe : Frantz devait manoeuvrer habilement pour que son Voisin fût placé dans l’axe de l’Aviatik, et Quenault, sans perdre son sang-froid, devait tirer sur la cible, coup par coup pour ne pas risquer l’enrayage. Surpris par la première balle, le pilote de l’Aviatik essaya de s’échapper en piqué.
Son observateur, bier que gêné par cette manoeuvre, tenta de riposter en si servant d’un simple fusil automatique. Pour ne pa: lâcher sa proie, Frantz pilotait en artiste! Mais, à la quarante-septième cartouche, la mitrailleuse de Quenault s’enraya. Tandis qu’il essayait de réparer Frantz poursuivait l’Aviatik.

Joseph Frantz aux commandes d’un biplan Robert Savary
Après un long combat l’avion allemand ralentit puis s’abattit en flamme: dans les marais s’étendant entre Muizon et Jonchery S’étant posés près de leur victime, les Français découvrirent dans les débris de l’appareil les corps carbonisés du sergent Wilhelm Schlichting et du premier lieutenant Fritz von Zangen.
Frantz en fut profondément affligé et ne put jamais évoquer ce souvenir sans émotion. Mais il avait réussi à prouver que l’on pouvait combattre en l’air! Modeste, il insista toujours sur le rôle capital qu’avait joué son coéquipier ce que, curieusement, les journaux de l’époque ne faisaient pas toujours spontanément.
Déjà titulaire de la médaille militaire, Joseph Frantz obtint la Légion d’honneur avec cette citation : Par décision ministérielle en date du 13 septembre 1914 la médaille militaire a été conférée au sergent Frantz pilote aviateur, pour l’ensemble des services rendus par lui depuis le début de la campagne. En particulier, le sergent Frantz, au mois d’août dernier, avait réussi sous le feu de l’infanterie et de l’artillerie de la garnison de Metz, à lancer deux obus sur les hangars d’aérostation de Frescati. Le 5 octobre dernier, ce même sous-officier, accompagné du mécanicien tireur Quenault, a poursuivi un aéroplane et réussi à abattre un avion allemand en reconnaissance dans les lignes françaises.
Le général commandant en chef lui confère la croix de chevalier de la Légion d’honneur et décerne au mécanicien Quenault la médaille militaire. L’exploit de Frantz eut des conséquences bénéfiques. C’est probablement grâce à lui que Roland Garros obtin l’autorisation de retourner à l’arrière pour tenter de mettre au point le système de tir à travers l’hélice.
Joseph Frantz fut également l’un des premiers à voler sur un avion-canon, avec lequel il abattit un Drachen. Il devint par la suite chef pilote chez Voisin et essaya tous les avions qui sortaient des chaînes pou aller au front.
Après la guerre, Frantz monta à Billancourt une usine de chromage et de nickelage. Un de ses titres de gloire est, de son propre aveu, de n’avoir jamai connu un jour de grève, même en 1936! Mobilisé et 1939, il commanda un groupe de transport basé à Bordeaux.
Après la guerre, il resta toujours attaché au: milieux de l’aéronautique, pilota jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans et devint président de l’association des Vieilles Tiges dont il avait été le fondateur fonction qu’il exerça jusqu’à sa mort, le 12 septembre 1979, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Il avait alors à son actif plus de 8 000 heures de vol.
UN EXPLOIT HORS DU COMMUN

Charles Godefroy Né le : 29 décembre 1888 à La Flèche (Sarthe). Mort le: 11 décembre 1958 à Oisy-sous-Montmorency
Pour protester contre l’absence des ailes françaises au défilé de la victoire, Charles Godefroy passa sous l’Arc de triomphe avec un (Bébé) Nieuport. Le 7 août 1919, bravant l’interdiction officielle, ce pilote inconnu, originaire de la Sarthe, passait sous l’Arc de triomphe de l’Étoile aux commandes de son (Bébé) Nieuport. Passer en vol sous l’Arc de triomphe de l’Étoile est une idée qui hante l’esprit de nombreux aviateurs de la Première Guerre mondiale.
Guynemer essaie, mais y renonce. Il déclare : C’est impossible. Quand on arrive sur l’Arc, on ne voit pas le trou, mais seulement un mur de pierres. Roland Garros, qui fait autorité, étudie lui aussi le projet. Il est formel : Celui qui essaiera de passer là se tuera! La décision prise par les autorités de faire participer à pied l’aviation au défilé de la victoire du 14 juillet 1919 suscite une certaine rancoeur chez les pilotes. Certes, il est prévu que les (as) seront groupés derrière leur porte-drapeau, le prestigieux capitaine Fonck, mais ils s’estiment cependant frustrés par cette mesure de prudence justifiée.
En effet, au cours de cérémonies analogues en province, des accidents se sont produits. Pour laver ce qu’il considère comme un affront, Jean Navarre, as aux douze victoires officielles, décide de passer sous l’Arc au moment même du défilé, en violation des règlements et des consignes.
Sa mort accidentelle le 10 juillet, en exécutant à Villacoublay un exercice de haute école, l’empêche de réaliser son projet. (Depuis, d’aucuns ont prétendu que Navarre, qui avait fait construire sur le terrain une réplique du monument, avait trouvé la mort en s’entraînant à passer sous celle-ci.) L’exploit sera réalisé le 7 août 1919 par un pilote inconnu : Charles Godefroy.
Né le 29 décembre 1888 à La Flèche (Sarthe), celui-ci est mobilisé en 1914 au 132e régiment d’infanterie, où il obtient deux citations en qualité d’agent de liaison. Après un séjour à l’hôpital, il est affecté à l’aviation le ler septembre 1917. Breveté sur Nieuport le 21 novembre à Miramas, Godefroy se fait remarquer par sa virtuosité et devient rapidement moniteur.

Un (Bébé) Nieuport; c’est avec ce type d’appareil que Charles Godefroy passa sous l’Arc de triomphe.
Il est de ceux qui rêvent de passer sous l’Arc de triomphe et s’entraîne aux environs de Miramas, en passant sous un pont du Petit Rhône, au grand désespoir des pêcheurs qui se demandent qui est ce fada! De retour à Paris, Godefroy, titulaire de cinq cents heures de vol, se rend souvent sur la place de l’Étoile en compagnie du célèbre journaliste Jacques Mortane, pour étudier les vents aux abords du monument.
Les baies latérales qui s’ouvrent sur l’avenue de Wagram et l’avenue Kléber provoquent deux courants d’air contraires. Pour les vaincre, il faut amorcer un piqué très allongé afin d’amener l’avion à sa vitesse maximale. Le vol des pigeons sous la voûte l’aide également à étudier sa manoeuvre. Le pilote s’estime prêt, mais l’interdiction toujours en vigueur de passer en vol sous l’Arc l’oblige à agir en fraude! La complicité d’un mécanicien de Villacoublay Lagogué, mis au courant de son projet, va le lui permettre.
Le 7 août 1919, à 6 heures du matin, Godefroy arrive à l’aérodrome, où Lagogué l’attend près d’un hangar. Il a choisi un « (Bébé) Nieuport, à moteur Gnome de 120 ch, et l’a soigneusement mis au point. Si le temps brumeux favorise les deux conspirateurs, en ce sens qu’il leur permet de sortir l’avion sans être vus, la visibilité réduite ne favorise guère le vol.
Qu’importe! Le moteur mis en route, le mécanicien, soucieux de ne pas être reconnu, s’éclipse, pendant que le pilote fait un court point fixe et décolle. Il est 7 h 20. Quelques minutes plus tard, le Nieuport survole la porte Maillot, pousse jusqu’à l’Étoile, qu’il contourne deux fois, puis revient vers la porte Maillot pour se mettre dans l’axe et prendre de la hauteur.
Après un demi-tour, le pilote reprend son point de mire et, remontant l’avenue de la Grande-Armée pleins gaz et en léger piqué, atteint la masse de pierre. Une légère embardée à droite, une autre à gauche, l’ombre, la clarté. Il a réussi! Malgré les remous provoqués par l’air aux abords immédiats du monument, un appareil de 9 m d’envergure est passé sous une voûte de 14,50 m de large! Un tramway arrive, dont les voyageurs ont très peur. En un clin d’oeil, Godefroy évite le véhicule et file vers la place de la Concorde, puis rentre à Villacoublay, où Lagogué l’attend avec anxiété. Le vol a duré une demi-heure.
Rapidement, les deux complices rentrent l’appareil au hangar. Le mécanicien, usant d’un vieux truc de compagnon, saupoudre les plans de sable fin afin de faire disparaître les traces d’huile. Dix minutes plus tard, le sable enlevé, tout est propre, nul ne peut dire que l’avion vient de voler.
A l’Étoile, l’émotion est grande. Des passants se sont sauvés dans tous les sens; des voyageurs du tramway ont sauté à terre. Des journalistes, des photographes et des cinéastes, prévenus par Mortane, se sont aplatis au sol; l’un deux s’est même trouvé mal.
Dans les milieux de l’aviation, les réactions sont mitigées : si pilotes et mécaniciens laissent voir leur enthousiasme, les responsables, même s’ils se réjouissent intérieurement de la prouesse de Godefroy, sont obligés de le blâmer. En effet, il a enfreint et avec quel éclat! Les arrêtés réglementant la circulation aérienne au-dessus des agglomérations urbaines, et les autorités se doivent de dissuader d’éventuels émules.
Ceux-ci, n’ayant pas forcément le coup d’oeil et la sûreté de manoeuvre exceptionnels de leur modèle, mettraient en cause la sécurité publique. De plus, des échecs pourraient provoquer de graves dégâts et nuire ainsi au prestige de l’aviation.

La photographie a immortalisé cet exploit jamais renouvelé
Toute publicité est interdite, et le film saisi, pour éviter tout esprit d’émulation. Le héros de cette aventure reçoit, quant à lui, des blâmes officiels. mais aussi de nombreuses lettres de félicitations. Les Français aiment la crânerie et le panache! La ville de La Flèche l’honore en apposant une plaque sur sa maison natale.
Il faut signaler que, ce 7 août 1919, Godefroy n’avait pas pris les commandes d’un avion depuis six mois. Fidèle à la promesse faite à sa famille, il devait abandonner le pilotage après cet exploit dangereux, mais de portée internationale, et se contenta de gérer un commerce de vins à Aubervilliers. Il mourut à Soisy-sous-Montmorency le 11 décembre 1958.
A la connaissance de l’auteur, aucun autre avion n’est passé sous la voûte de l’Arc de triomphe de l’Étoile, où repose, depuis le 11 novembre 1920, le Soldat inconnu. En revanche, le 24 février 1926, une tentative analogue fut faite à la tour Eiffel.
A la suite d’un pari, le lieutenant Léon Collet, venu d’Orly sur un Breguet 19, traverse la Seine et passe entre les piliers de la Tour. Il réussit, mais touche de l’aile une des antennes de l’émetteur radio. L’appareil, déséquilibré, s’écrase et prend feu. Moins heureux que Godefroy, le pilote meurt carbonisé sous les yeux des spectateurs.
UN PREMIER PAS SUR L’ATLANTIQUE

John Alcock 1892-1919, Arthur Whitten Brown 1886-1948
Deux Britanniques, Alcock et Brown, relient en seize heures et vingt-sept minutes le Nouveau Monde à l’Ancien Continent. Le ler avril 1913 (en Angleterre, ce jour n’est pas celui des canulars et autres farces traditionnelles), lord Northcliffe offrit un prix de 10 000 livres sterling à la première personne qui traverserait en avion, et sans escale, l’océan Atlantique. Une proposition de cette importance, moins de dix ans après le vol historique des frères Wright, ne pouvait être le fait que d’un visionnaire doué d’un extraordinaire sens prophétique. Mais, malgré les énormes problèmes posés par un vol de cette sorte, plusieurs pilotes ainsi que certains constructeurs entrèrent en lice et relevèrent le défi.
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale contraignit lord Northcliffe à retirer son offre pour la durée des hostilités; mais dès le mois de juillet 1918, la victoire des Alliés étant en vue, le roi de la presse britannique réitéra sa proposition. Quatre jours exactement après la signature de l’Armistice, la presse annonça que la course à l’Atlantique. Était de nouveau ouverte, dans le but de stimuler la production de moteurs plus puissants et d’appareils mieux conçus.
Le challenge comportait toutefois certaines conditions durée maximale de soixante-douze heures pour la traversée; tolérance d’un seul amerrissage en cours de route et veto formel à la participation d’avions ou d’équipages de nationalités (ennemies). Cette compétition était en outre réservée aux pilotes civils et, juge impartial et suprême, le Royal Aero Club était invité à superviser toutes les demandes d’engagement. Aucune restriction ne frappait le choix de l’itinéraire, est-ouest ou ouest-est, à condition que le vol fût direct.
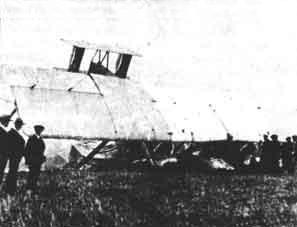
Une fin peu flatteuse pour un vol historique: le Vimy d’Alcock et Brown termine sa carrière dans le marais de Derrygimia en Irlande.
En conséquence, plusieurs constructeurs américains et européens se mirent immédiatement à l’œuvre dans le but de construire un appareil spécifiquement conçu pour accomplir cette traversée.
Mais la société Vickers Aviation possédait déjà un avion susceptible de réaliser cette performance : le Vickers (Vimy), un bombardier bimoteur conçu en 1917 comme appareil à long rayon d’action capable de bombarder le territoire allemand. Le prototype vola pour la première fois en novembre 1917, et la production démarra dans le courant de l’année suivante.
En l’occurrence, un seul Vimy arriva en France au mois d’octobre 1918, trop tard pour participer au combat. Un exemplaire de cet avion, propulsé par deux Rolls-Royce Eagle VIII développant 360 ch chacun, fut débarrassé de son équipement militaire en vue de tenter la traversée de l’Atlantique. La capacité en carburant fut notamment portée à 3 9001, ce qui donna au Vimy une autonomie d’environ 4 000 km. L’équipage théorique de trois personnes fut réduit à deux, et le cockpit fut réaménagé de manière à placer les deux sièges côte à côte.
Des volontaires
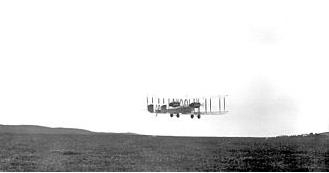
14 juin : départ de Terre-Neuve
Le 11 mars 1919, un pilote de la RAF démobilisé de la veille pénétrait dans les bureaux de la maison Vickers, à Brooklands. Le Captain John Alcock (DSC) ne tarda pas à convaincre les dirigeants de Vickers qu’il était l’homme de la situation. Né à Manchester en 1892, Alcock avait reçu une formation d’ingénieur, avant de passer, le 26 novembre 1912, son brevet de pilote d’avion (n° 368 anglais).
Au cours des deux années qui suivirent, il devait faire preuve de qualités de courage équivalentes à son aptitude au pilotage. Lorsque la guerre éclata, il se porta volontaire dans le Royal Naval Air Service, où il fut mobilisé comme instructeur pendant près de trois ans. On finit par lui accorder ce qu’il demandait depuis longtemps : en 1917, il fut envoyé sur le front d’Orient. Le 30 septembre de cette même année, il fut descendu, en mer, aux commandes d’un bombardier Handley (Page) et retenu prisonnier par les Turcs jusqu’à la fin des hostilités.
Près de trois semaines après la demande d’Alcock auprès de Vickers, l’homme qui devait être son compagnon devant l’histoire, alla frapper à la même porte pour demander à voler sur le Vimy. Arthur Whitten Brown, né à Glasgow en 1886, avait travaillé chez Westinghouse avant de rejoindre le Manchester Regiment à la déclaration de guerre.
En 1915, il passa dans le Royal Flying Corps (ancêtre de la RAF) comme observateur, poste où, le 10 novembre de la même année, il fut descendu avec son avion dans les lignes allemandes. Il resta prisonnier jusqu’au milieu de l’année 1918, profitant de sa captivité pour étudier la navigation et d’autres spécialités aéronautiques. A son retour, il entra dans l’industrie des moteurs d’avions.
Préparatifs hâtifs
Le temps commençait à presser, car de nombreux concurrents étaient alors plus avancés dans la mise au point des derniers détails. Afin de réduire le plus possible la durée du vol au-dessus de l’eau, il fut décidé de partir d’un point situé à Terre-Neuve, ce qui permettait, en outre, de bénéficier des vents d’ouest dominants. Il était alors vital de faire très vite.
Le 18 avril 1919, Alcock effectua un bref vol d’essai de l’appareil choisi, et, satisfait de ses performances, il prit la tête de l’équipe de treize personnes désignées pour partir à Terre-Neuve. L’élément précurseur, comprenant Alcock et Brown, partit pour le Nouveau Monde le 4 mai, tandis que le Vimy, en caisse, suivait dans un cargo. Arrivés à Terre-Neuve le 13 mai le Vimy arriva le 26.
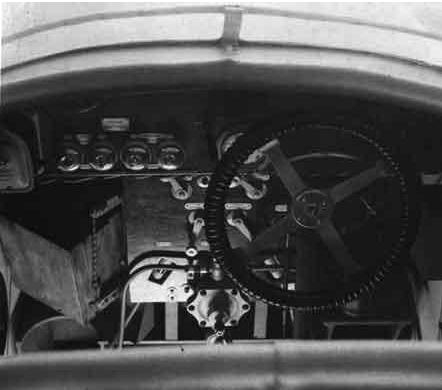
Le cockpit du Vimy tel qu’on peut le voir aujourd’hui
Alcock et Brown eurent quelques difficultés à trouver un site, jusqu’au moment où un autre candidat à la traversée, malheureux celui là, leur offrit généreusement le terrain de Quidi Vidi pour remonter le Vimy.
Les travaux commencèrent immédiatement, malgré l’obligation de travailler sous une simple bâche, qui protégeait mal des dernières rigueurs de l’hiver. Le problème de la piste d’envol ne fut résolu que lorsqu’un fermier, M. Lester, mit ses champs à la disposition de l’équipe Vickers, et, le 9 juin, Alcock put effectuer, un bref vol d’essai aux commandes du Vimy remonté Trois jours après, il fit un deuxième et dernier essai avant d’affronter l’Atlantique. Enfin, le samedi 14 juin 1919, à 13 h 24 exactement Alcock mit les contacts, fit chauffer ses moteurs et dirigea son biplan jaune pâle surchargé vers l’extrémité du champ de Lester.
LA TRAVERSÉÉ ATLANTIQUE NORD EN OUEST
Costes et Bellonte
Franchissent les premiers l’Atlantique d’est en ouest et relient Paris à New York en 37 heures de vol sans escale. Né à Caussade (Tarn-et-Garonne) le 4 novembre 1893, Dieudonné Costes avait vingt et un ans quand éclata la Première Guerre mondiale. Pour des raisons purement administratives, il ne put combattre dans l’aviation qu’au bout de dix mois, et encore ses compétences l’obligèrent-elles à rester à Chartres comme moniteur! A force d’insistance, il fut enfin affecté en escadrille. Il rejoignit donc la M F.55 et se porta volontaire pour le front de Salonique.

Costes Dieudonné Né en : 4 novembre 1892 à Caussade (Tarn-et-Garonne). Mort le: 18 mai 1973 à Paris.

Maurice Bellonte Né en : 25 octobre 1896 à: Méru. Mort le : 14 janvier 1984 à: Paris.
Son arrivée à la MF.85 fut marquée par un accident : victime d’une panne de moteur, il s’écrasa au-dessus d’un lac avec à son bord un camarade de l’infanterie, ce qui lui valut un mois d’interdiction de vol. Au terme de cette période d’inactivité, Costes mit les bouchées doubles. A partir du 29 avril, il remporta neuf victoires et montra toujours un courage exemplaire. Il finit la guerre comme sous-lieutenant et décoré de la croix de guerre avec huit palmes et une étoile. Durant le conflit, il avait totalisé 994 heures de vol en Orient, réalisé vingt-sept bombardements de nuit et livré cinquante-six combats.
Ayant quitté l’armée, il resta attaché à l’aviation comme pilote sur les lignes Latécoère et à la compagnie Air Union, assurant un service au départ de Toulouse-Francazal, puis sur la ligne Paris-Londres. Il entra ensuite chez Breguet comme pilote en second de Robert Thiery. C’est avec ce dernier que, le 13 septembre 1925, Costes tenta de battre le record du monde de distance en ligne droite, détenu jusque-là par Lemaître et Arrachart. Mais cette tentative s’acheva tragiquement.

Au matin du 1er septembre 1930, les aviateurs français Maurice Bellonte et Dieudonné Costes (à gauche) prennent le départ du Bourget pour la traversée de l’Atlantique sur leur avion Point d’interrogation.
Leur avion tomba, en Forêt-Noire, dans le lit d’un torrent. Costes s’en sortit avec des contusions, mais, la jambe coincée et suffoquant sous l’effet des vapeurs d’essence, il s’évanouit. Quand il revint à lui, il se porta au secours de Thiery, tombé à l’eau, et le maintint émergé en attendant les secours.
Mais ceux-ci arrivèrent tard : Thiery était déjà mort. Costes fut profondément choqué par cet accident, qui lui valut en outre d’être condamné à la prison et à une forte amende pour être tombé en territoire allemand, que les pilotes français n’étaient pas autorisés à survoler. C’est à bord du Nungesser et Coli, qui avait déjà permis au capitaine Girier et au lieutenant Dordilly de réaliser le fameux raid Paris-Omsk et retour, que Costes réussit ses premiers exploits.
Du 21 au 27 septembre 1926, avec le lieutenant de Vitrolles, il fit une première tentative de record en ligne droite, sur Paris-Assouan, soit 4 100 km. Il se l’adjugea les 28 et 29 octobre 1926, en compagnie de Rignot, en parcourant en trente-deux heures, sans escale, les 5 396 km qui séparent Djask de Paris. Ce record leur ayant été ravi par Lindbergh, Costes et Rignot reprirent l’air le 4 juin 1927 avec l’intention de reconquérir leur titre, mais, gênés par une météo épouvantable brume et pluie incessante, ils ne purent réaliser que la moitié de leur voyage, et encore!
Ce fut ensuite, en compagnie de Le Brix, l’aventure du tour du monde, durant lequel ils franchirent les premiers l’Atlantique Sud. Après un périple de 120 000 km, il leur fallut par surcroît effectuer un tour d’Europe, pour rendre visite aux pays qui les avaient invités. Le Nungesser et Coli ne résista pas à ces 6 000 km supplémentaires et rendit l’âme. C’est alors que devait sonner l’heure des records qui allaient associer dans l’histoire de l’aviation les noms de Costes et de Bellonte.
Né à Méru au mois d’octobre 1896, Maurice Bellonte servit, durant la Première Guerre mondiale, au 1er groupe d’aviation basé à Dijon, combattant sur le front français dans l’escadrille Br.213, et au Maroc dans la Br.2. Les hostilités terminées, il travailla à la Société franco-colombienne puis à Air Union, où, en septembre 1923, il fit la connaissance de Costes. Assurant tous deux la liaison Paris-Londres Costes en tant que pilote, Bellonte comme mécanicien et radiotélégraphiste, les deux hommes devinrent très vite une paire d’amis. Bellonte ayant passé ses brevets de mécanicien et de pilote de transport public, c’est sur lui que se porta le choix de Costes, au moment de tenter de nouvelles aventures.
C’est ensemble que, du 27 au 29 septembre 1929, ils battirent le record du monde de distance lors du raid Paris-Tsitsihar (Mandchourie), soit 7 905 km, record détenu jusque-là par les Italiens Ferrarin et Del Prete (7 188 km). Après avoir réuni non sans mal une documentation solide (les cartes de la Mandchourie qu’ils trouvèrent dataient de 1847!), ils embarquèrent tout leur matériel (y compris de quoi construire un radeau, sans oublier du matériel de pêche et des carabines pour survivre en cas d’accident) à bord du Point d’interrogation.

Le Breguet 19 GR n° 3 Point d’interrogation le 27 septembre 1929, quelques minutes avant l’envol pour Tsitsihar (Mandchourie). Une grande répétition et un record du monde avant Paris-New York.
Le 27 septembre à 7 h 20, ils décollaient du Bourget. Jusqu’à Dvinsk (Lettonie), qu’ils survolèrent vers 16 h 30, ils ne rencontrèrent pas de gros problèmes, et Bellonte put relayer Costes aux commandes de l’appareil. Ils avaient alors atteint la vitesse moyenne de 200 km/h.
Il faisait nuit noire lorsque, vers 21 heures, ils furent pris dans une tempête de neige. Effectuant pour la première fois un vol sans visibilité, ils s’orientèrent à l’aide d’un gyrorector. Au petit jour, ils atteignaient l’Oural, et, au crépuscule, ils survolaient la région du lac Baïkal, où ils rencontrèrent de fortes perturbations. L’avion souffrit terriblement des conditions atmosphériques.
Le moteur semblait vouloir rendre l’âme sous l’effet du givre, et la rupture d’un hauban ajouta encore à leur inquiétude. Ayant bouclé les ceintures de leurs parachutes, Costes et Bellonte, gardant leur sang-froid, entreprirent de redescendre à 1 400 m. Au jour, le moteur de l’avion se remit à tourner normalement, et, le 29 septembre à 10 h 39 GMT, ils atterrirent enfin, épuisés mais heureux. En butte à la méfiance de la population locale, ils ne purent repartir que le 11 octobre, pour rallier Kharbine. Sur le trajet de retour vers Paris, ils battirent encore le record du monde de vitesse en liaison postale. De leur grand périple eurasien, ils avaient tiré bon nombre d’enseignements pour l’avenir. Les deux aviateurs envisagèrent de rééditer l’exploit de Lindbergh en sens inverse. Bellonte y mit une condition : il voulut que le vol soit au préalable entièrement simulé tant en vol qu’au banc. Ils le préparèrent donc avec un soin tout particulier, et durent leur réussite à leur méticulosité aussi bien qu’à leur courage.
C’est à bord du célèbre Point d’interrogation que Costes et Bellonte ouvrirent l’ère des traversées transatlantiques. Cet appareil un Breguet 19 Grand Raid qui avait fait l’objet de minutieuses améliorations présentait une envergure de 18,30 m pour une longueur de 10,71 m et une hauteur de 4,08 m. Avec un poids total de 6 375 kg, il était capable d’atteindre 243,500 km/h à 2 000 m. Son autonomie était de 9 000 km.
L’entreprise de Costes et Bellonte bénéficia de facteurs favorables : ils disposaient des ondes courtes, utilisées à bord des avions depuis 1927; en outre l’Office national de météorologie (ONM) put leur fournir des renseignements précis sur les conditions atmosphériques régnant au-dessus de l’Atlantique.
Les essais en vol prirent fin le 23 juillet et, dans l’attente du grand départ, Bellonte se rendit tous les jours à l’ONM. Le 2 septembre 1930 à 9 h 54, le Point d’interrogation décollait du Bourget. Entre 13 heures et 14 heures, Costes et Bellonte survolaient l’Irlande. Utilisant les astres pour faire le point, ils purent se passer des renseignements que leur transmettaient les navires qu’ils survolaient. Tout au long du voyage, ils communiquèrent par l’intermédiaire de petits billets griffonnés.

Retour des États-Unis, Costes et Bellonte repartent en novembre sur le Point d’interrogation, orné de leurs exploits, pour un Tour de l’Amitié dans les grandes villes françaises.
À 23 h 18, l’exploit était réussi : les deux Français se posaient à Curtiss Field, où les Américains leur firent un véritable triomphe. Parmi eux se trouvait Lindbergh. Après- une tournée des grandes villes d’Amérique du Nord, où on leur réserva partout un accueil délirant, Costes et Bellonte regagnèrent la France (24 octobre), où ils durent encore sacrifier à de nombreuses manifestations officielles.
Ils furent reçus par le ministre de l’Air, les responsables de l’Aéro-Club de France, et le président de la République, Gaston Doumergue, tint à leur remettre lui-même les insignes de leur nouveau grade dans la Légion d’honneur. A leur tour, les usines Breguet firent aux deux héros un accueil des plus chaleureux.
Toutes ces réceptions officielles n’étaient d’ailleurs que le reflet d’un enthousiasme qu’ils avaient déjà ressenti lorsqu’ils s’étaient posés à New York. Ce jour-là, la radiotéléphonie naissante avait permis d’annoncer leur exploit aux Parisiens massés, pour l’occasion, sur la place de la Concorde.
Des deux côtés de l’Océan, ce fut la même explosion de joie. Les Ailes et toutes les autres revues célébrèrent l’événement. Mais les spécialistes étaient bien conscients du fait qu’il faudrait encore attendre longtemps avant que la traversée de l’Atlantique se fasse couramment : l’entreprise de Costes et Bellonte relevait encore du domaine de l’exploit.
Devenus célèbres, ils poursuivirent chacun de leur côté des carrières extrêmement brillantes. Ingénieur chez Hispano-Suiza, Bellonte fut chargé de la mise au point des nouveaux moteurs et assura cette responsabilité pendant cinq ans, de 1935 à 1939. Il travailla à l’Inspection générale de l’aviation civile de 1950 à 1961, en qualité de président de la Commission de sécurité aérienne, puis assura pendant deux ans la charge d’ingénieur général de la navigation aérienne.

Le 25 octobre 1930, Paris enthousiaste accueille les héros de l’Atlantique, décorés le matin de la Légion d’honneur par Gaston Doumergue.
De 1962 à 1972, il fut ingénieur conseil à la Société de fabrication d’instruments de mesure (SFIM). Ayant à son actif plus de sept mille heures de vol, Bellonte reste encore attaché au monde de l’aéronautique en étant notamment membre actif de nombreux clubs ou associations, par exemple Les Vieilles Tiges. En 1976, il a publié Le Premier Raid Paris-New York, ouvrage dans lequel il fait le récit de son épopée au-dessus de l’Océan.
Costes, de son côté, s’occupa de diverses affaires. Il assura entre autres, à partir de 1936, la présidence de la Société du téléphérique du Sancy. Il s’éteignit à Paris au mois de mai 1973.
CHARLES LINDBERGH
L’Ulysse du Minisota
Premier aviateur à franchir l’Atlantique Nord sans escale, Charles Lindbergh fut aussi un voyageur infatigable aux activités multiples. Né le 4 février 1902 dans la ville de Detroit, Charles Augustus Lindbergh vécut ensuite à Lindholm jusqu’à l’âge de quatre ans. A cette époque, leur maison ayant brûlé, les Lindbergh allèrent vivre en appartement à Minneapolis, puis à Little Rock. Charles Lindbergh avait cinq ans quand son père fut élu au Congrès des États-Unis.

Charles Lindbergh devant son avion le Spirit of St-Louis

Charles Lindbergh enfant, avec son père
Fils d’immigrants suédois, Lindbergh a grandi dans le Minnesota. Son père, Charles August Lindbergh, était avocat et membre du Congrès des États-Unis, opposé à l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 ; sa mère enseignait la chimie. Passionné d’aviation, il abandonne en 1922 ses études de construction mécanique, passe le brevet de pilote et achète son premier avion, un Curtiss JN-4 (Jenny), qu’il répare pour proposer des baptêmes de l’air. Franc-maçon, il est initié à Saint-Louis (Missouri) à la Loge Keystone (No. 243).
Le futur vainqueur de l’Atlantique Nord ne fut pas un élève émérite. S’il montrait de réelles dispositions pour tout ce qui touchait au bricolage et à la mécanique, ses résultats dans les disciplines traditionnelles laissaient, eux, à désirer. 11 eut son premier contact avec l’aviation à Fort Myer (Virginie), où sa mère l’emmena assister à un meeting. Ses parents le destinaient à une carrière d’avocat, mais, touché par le virus du plus lourd que l’air, Lindbergh quitta l’université du Wisconsin, à la fin du mois de mars 1922, pour s’inscrire comme élève à la Nebraska Aircraft Corporation.

Charles Augustus Lindbergh photographié devant le Ryan NYP baptisé Spirit of Saint Louis avec lequel il accomplit la première traversée de l’Atlantique Nord en solitaire le 21 mai 1927.
Le long chemin vers la célébrité
Lindbergh reçut le baptême de l’air, le 9 avril 1922. Dès lors, il n’eut plus qu’une pensée en tête : s’acheter un avion. Mais même les appareils provenant des surplus de la Grande Guerre lui étaient inaccessibles. Pour acquérir les sommes nécessaires à un tel achat, il accepta donc d’effectuer, en compagnie d’un pilote nommé Bahl, de dangereuses acrobaties aériennes.
Monté sur l’aile inférieure d’un biplan, il effectua de nombreux sauts en parachute au cours desquels il risqua souvent sa vie. Après avoir fait quelques économies, il put, en avril 1923, acheter un vieux biplan d’entraînement Curtiss JN-4D (Jenny) datant de la guerre de 1914-1918. Avec cet appareil, il se lança alors dans des vols d’exhibition qui lui permirent de gagner un peu d’argent.
Sur les conseils de quelques amis, Lindbergh, qui désirait voler sur des avions plus sûrs et plus modernes, signa son engagement dans l’Air Service de l’armée américaine. En janvier 1924, il passait avec succès son examen d’entrée à Chanute Field et, deux mois plus tard, entrait dans la vie militaire. L’entraînement fut extrêmement dur et la sélection impitoyable puisque des 204 élèves de sa promotion seuls 37 furent brevetés. Le passage de Lindbergh dans l’Air Service fut d’ailleurs marqué par un accident grave : au cours d’un vol de routine sur un SE-5, il percuta l’avion d’un de ses équipiers. Les deux pilotes purent cependant se tirer sans mal de ce mauvais pas en sautant en parachute.
En mars 1925, Lindbergh fut nommé sous-lieutenant puis versé dans la réserve. II rédigea une demande de service actif dans l’aviation militaire, qui ne fut pas prise en considération. Sans travail, il partit pour Saint Louis, où on le mit en relation avec les frères Robertson, deux hommes d’affaires qui attendaient leur premier contrat pour mettre sur pied une compagnie aéropostale.
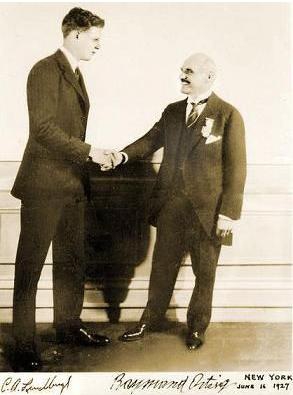
Charles Lindbergh reçoit le prix Orteig des mains de Remond Orteig le 16 juin 1927
En attendant, il dut accepter un emploi de pilote d’acrobatie au sein de l’Airways and Flying Circus, établi à Denver. Au mois de mai 1925, il y fut victime d’une panne qui l’obligea, encore une fois, à utiliser son parachute. A la fin de l’année, il apprit, à son grand soulagement, que la place promise par les frères Robertson allait lui être attribuée.
Sur des biplans De Havilland DH-4 équipés de moteurs Liberty, Lindbergh organisa donc une ligne aéropostale entre Saint Louis et Chicago, tout en assurant par ailleurs l’entraînement des pilotes de réserve de la garde nationale du Missouri, comme l’y obligeaient ses fonctions de sous-lieutenant. Quand il convoya luimême les premières lettres, le 15 avril 1926, il comptait près de 2 000 heures de vol.

Lindbergh et son épouse, Anne, peu de temps après leur mariage en mai 1929. Ensemble, ils effectuèrent plusieurs voyages aux Indes et en Chine.
C’est en septembre 1926, lors d’un vol solitaire, qu’il eut l’idée d’un raid au-dessus de l’Atlantique. Les 25 000 dollars offerts par Raymond Orteig, propriétaire d’un hôtel en renom de New York, au premier aviateur qui accomplirait un tel exploit, représentaient une véritable fortune, que le jeune pilote de l’aéropostale eût aimée s’approprier. Les seuls appareils qui, à l’époque, paraissaient capables de parcourir les 5 700 km qui séparent New York de Paris, les Fokker multimoteurs en particulier, coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Curieusement, Lindbergh porta d’abord son choix sur un monomoteur terrestre mis au point par Giuseppe Bellanca et équipé d’un propulseur Wright Whirlwind de 220 ch. Acquis par la Wright Aeronautical Corporation, l’avion était vendu 10 000 dollars, soit cinq fois ce que possédait Lindbergh. Pour trouver les fonds nécessaires à la réalisation de son périple, (Slim), comme le surnommaient ses amis, prit contact avec plusieurs hommes d’affaires de Saint Louis; ces entretiens furent, dans l’ensemble, décevants. II rencontra ensuite un représentant de Fokker, qui lui signifia que la firme néerlandaise n’accepterait jamais de voir un de ses trimoteurs engagé au-dessus de l’Atlantique.
Une autre entrevue avec le constructeur Bellanca et des responsables de la Wright Aeronautical n’aboutit à rien. Cependant, du côté de Saint Louis, l’obstination de Lindbergh commençait à porter ses fruits, et plusieurs personnalités consentirent enfin à commanditer son entreprise. En outre, une petite firme installée sur la côte ouest des États-Unis avait répondu favorablement à un télégramme dans lequel il faisait part de son intention d’acheter un avion capable de couvrir une très longue distance. II s’agissait de la Ryan Airlines, et cela se passait au début du mois de février 1927.

Lindbergh reçoit la médaille Hubbard de la Société Géographique par le président des États-Unis Calvin Coolidge en 1929
La société californienne acceptait en effet de lui construire pour 6 000 dollars, moteur compris, un dérivé du Ryan M-1, désigné NYP (pour New YorkParis). Lindbergh s’apprêtait à partir pour San Diego quand il reçut un message urgent de Bellanca lui signalant qu’il acceptait de lui vendre son avion, mais par l’intermédiaire de la Columbia Aircraft, dirigée par Charles Levine. II ajourna donc son voyage en Californie et partit pour New York, où il rencontra Bellanca et Levine.
Les deux hommes lui assurèrent qu’il pourrait acquérir leur Wright-Bellanca pour la somme de 15 000 dollars. Lindbergh revint à Saint Louis demander l’avis de ses commanditaires. Ceux-ci lui donnèrent leur accord et lui remirent un chèque correspondant au prix réclamé par Levine. Les neuf hommes qui avaient financé le jeune aviateur adoptèrent ensuite à l’unanimité le nom de (Spirit of Saint Louis) pour leur association.

Lindbergh entouré des pilotes de la RAF qui l’escortèrent au-dessus de la Manche à son retour de Paris, en juin 1927.
Le (Spirit of Saint Louis)
Quand il rencontra de nouveau Levine, Lindbergh eut une très mauvaise surprise. Le directeur de la Columbia Aircraft lui fit, en effet, savoir que s’il acceptait de voir figurer le nom de Spirit of Saint Louis sur le fuselage de son monomoteur, il se réservait le droit de choisir l’équipage. Cette attitude suffit à convaincre l’aviateur d’interrompre ses relations avec la Columbia Aircraft. Dès lors, son seul espoir résidait dans la Ryan Airlines. II débarqua donc à San Diego le 23 février 1927, passa commande de l’avion et, cinq jours plus tard, s’inscrivit pour le prix Orteig.
Lindbergh prépara minutieusement son raid. Pour pouvoir emporter plus de carburant, il décida de se passer de navigateur et de voyager seul. Le Ryan M-1 fut équipé d’un moteur Wright Whirlwind J-5C, ce qui obligea les techniciens à supprimer toute visibilité vers l’avant et à pratiquer une ouverture de chaque côté du fuselage. La réalisation de l’appareil – immatriculé NX-21 1 – fut très rapide, Lindbergh craignant d’être devancé par l’un des nombreux aviateurs engagés dans la course pour l’Atlantique Nord.
Le départ du Bourget, le 8 mai, de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau blanc lui assena un coup très rude. Deux jours plus tard, le jeune Américain prenait l’air pour la première étape de son voyage : un vol transcontinental de San Diego à New York avec une escale à Saint Louis. Le 12 mai, il se posait à Curtiss Field (New York), pulvérisant au passage le record de la traversée des États-Unis en avion.
Huit jours plus tard, Lindbergh s’engageait audessus de l’Atlantique Nord. Le 20 mai 1927, à 7 h 52, le Ryan NYP Spirit of Saint Louis quittait la piste de Roosevelt Field, réservée au Fokker de Richard Byrd, inscrit lui aussi au prix Orteig. Après avoir survolé les 400 km d’océan Atlantique séparant New York de la Nouvelle-Écosse, il fila, à travers un véritable déluge, vers Terre-Neuve, qu’il atteignit au bout de douze heures de vol. En bas, l’océan était recouvert de glace et d’icebergs monstrueux.
Au bout de quatorze heures de vol, Lindbergh dut réduire son altitude pour se soustraire aux effets du givrage. La suite fut une lutte sans répit contre le sommeil. Maintes fois, il dormit les yeux grands ouverts. A un moment, il dut même se frapper violemment le visage pour demeurer éveillé.

Lindbergh prenant la parole à un meeting de l’America First
La nuit ne fit qu’accentuer les souffrances de l’aviateur. Le soulagement qu’il ressentit quand le jour se leva, au bout de la vingtième heure de vol, fut de courte durée car, pendant deux heures, il dut voler dans les nuages. Enfin, à la vingt-septième heure, Lindbergh vit des mouettes annonçant à coup sûr la proximité d’une côte ou d’une route maritime fréquentée.
Il survola quelques chalutiers et, une heure plus tard, la côte irlandaise apparut sur l’horizon. Le Spirit of Saint Louis ne fit qu’effleurer l’extrémité sud de l’île. Après un léger incident, dû à un défaut d’alimentation du moteur, l’avion se présenta vers 17 h 30, heure locale, au-dessus de l’Angleterre. Après deux heures de vol, Lindbergh, à présent vainqueur de l’Atlantique Nord, repéra les lumières de Paris. 11 mit alors le cap vers le nord-est où il savait que se trouvait l’aérodrome du Bourget. A 22 h 22, heure de Paris, le Spirit of Saint Louis roula sur la terre de France.
Du fait de la disparition de Nungesser et Coli, l’Américain s’attendait à un accueil plutôt mitigé; en fait, une foule immense et presque en délire se rua vers le Ryan, dont l’hélice, tournant encore, risquait à tout moment de blesser quelqu’un. Lorsqu’il sortit de l’avion, Lindbergh fut porté en triomphe.
Un amateur plus hardi que les autres lui déroba son carnet de vol, que l’on n’a jamais retrouvé. L’aviateur fut soustrait à l’admiration du public par quelques militaires du 34e régiment d’aviation, et le Ryan fut entreposé dans un hangar, où il se trouva provisoirement à l’abri. Le jeune Américain avait tenu son pari; il avait parcouru les 5 816 km de son périple en 33 h 30 mn, soit à la moyenne de 173 km/h (il lui restait assez de carburant pour parcourir encore plus de 1 500 km).

Au terme de sa traversée historique, le Ryan est enfermé dans un hangar au Bourget, afin de le soustraire à la convoitise des amateurs de souvenirs.
La rançon de la gloire
Une tournée triomphale dans quelques pays d’Europe occidentale commença alors pour le nouveau héros. Reçu par les maréchaux Joffre et Foch, il déjeuna avec Blériot et, le 28 mai, pilota le Spirit of Saint Louis jusqu’à Bruxelles, où l’accueillit le roi Albert.
Le lendemain, le Ryan se posait sur un terrain situé près de Londres. Démonté, il fut ensuite entreposé sur le croiseur Memphis, de l’US Navy, qui devait ramener Lindbergh, nommé colonel de la garde nationale, aux États-Unis.
A New York, le président Coolidge lui remit la Distinguished Flying Cross, première médaille de ce genre jamais attribuée dans le pays. Puis, le jeune aviateur entreprit, au profit de la fondation Guggenheim, une tournée qui le mena dans les quarante-huit États américains. En décembre 1927, il se rendit au Mexique. Le 30 avril 1928, le Ryan NYP fut remis à la Smithsonian Institution à Washington, où il voisine désormais avec le Flyer des frères Wright.

Le Ryan NYP, extrapolé du Ryan M-1 par l’ingénieur Donald Hall, est aujourd’hui conservé au Smithsonian Institution’s National Air Space Museum à Washington.
Une nouvelle existence s’offrait alors à Lindbergh. Devenu conseiller technique de deux compagnies aériennes, la Pan American Airways et la Transcontinental Air Transport, il épousa, en mai 1929, la fille de l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Anne Morrow, et leur premier enfant, Charles Augustus, naquit l’année suivante.
En juillet 1931, à bord d’un Lockheed Sirius, Lindbergh emmena sa femme, qui jouait pour la circonstance le rôle de navigateur, dans un long voyage aérien de reconnaissance vers la Chine, via le Canada, l’Alaska et le Kamtchatka.

En 1929, Lindbergh et John Ambleton se préparent pour un vol qui les conduira de Miami à San Cristobal, au Panama.
C’est en mars 1932 que survint le tragique événement qui allait profondément marquer la vie du vainqueur de l’Atlantique Nord : le kidnapping et l’assassinat de son fils, à peine âgé de vingt mois. Bien qu’il eût payé les 50 000 dollars réclamés par le ravisseur, Lindbergh retrouva le corps de son enfant à deux kilomètres seulement de l’endroit où il avait été enlevé. Un peu plus d’un an après cette affaire, il accomplit un nouveau vol de New York à Copenhague pour, ensuite, rejoindre l’Afrique et relier la Gambie à Natal, au Brésil.

Hermann Goering décore Lindbergh d’une médaille au nom d’Adolf Hitler, Anne Lindberg est à l’extrême gauche. Photo prise le 28 juillet 1936
En étroite liaison avec les services de renseignements de son pays, il s’installa, en 1936, avec sa famille en Angleterre et reçut du ministère de l’Air une invitation à visiter les principales usines de constructions aéronautiques françaises pour donner son avis sur la production nationale. L’Allemagne le convia également à venir admirer les nouveaux avions militaires en cours de mise au point. II put observer le He-111, le Ju-86 et le Ju-87, et rencontra le général Milch, puis le chef de la Luftwaffe, Hermann Goering.
Ce qu’il vit de la puissance aérienne allemande l’impressionna au plus haut point. Ses craintes quant à une guerre future en Europe furent confirmées par le nouveau séjour qu’il effectua sur le territoire du Reich en 1937. A cette occasion, il put voir, ce qui n’était encore arrivé à aucun observateur occidental, le Do-17, le chasseur Bf-109 et le Hs-123. II aida l’attaché de l’air américain en Allemagne, Smith, à rédiger un rapport sur les forces aériennes allemandes et termina son séjour par un circuit dans les pays de l’Est, qui le mena en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.
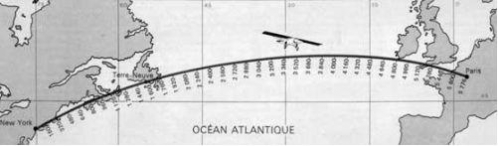
La route suivie par Lindbergh lors de son vol historique au-dessus de l’Atlantique Nord. Les chiffres représentent les distances en kilomètres.
Ses déclarations ambiguës sur la puissance militaire du llle Reich lui valurent cependant de très vives attaques de la part de la presse américaine, qui le taxa de nazisme. (Lindbergh fit sûrement une erreur en acceptant la Verdienstkreuz der deutscher Alder, que lui attribuèrent les autorités allemandes.)
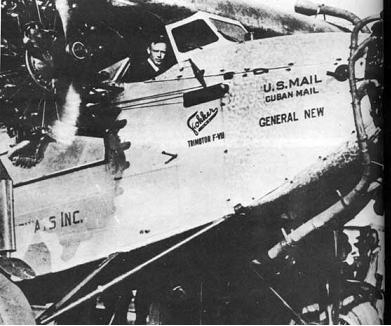
Le héros de l’Atlantique photographié à Cuba aux commandes d’un trimoteur Fokker F-Vllb de la Pan American Airways. La renommée de Lindbergh fut mise à profit par la grande compagnie américaine pou ouvrir de nouvelles routes postales en Amérique du Sud. En juillet 1927, l’aviateur effectua le premier transport de courrier entre Key West en Floride, et La Havane.
Soucieux de préserver la paix, il alla même jusqu’à proposer à la France et à l’Allemagne de collaborer autour d’un grand projet : monter sur une des meilleures cellules de l’époque, celle du Dewoitine 520, l’excellent moteur qu’était le Daimler-Benz DB-601. Si le projet ne se réalisa pas, Lindbergh n’en favorisa pas moins les démarches françaises auprès de l’Allemagne pour l’achat de propulseurs modernes. Celles-ci furent d’ailleurs réduites à néant par l’invasion de ce qui restait de la Tchécoslovaquie, en mars 1939.
De retour en Amérique, il fut contacté par le général Arnold, commandant de l’US Army Air Force, dans le but de reprendre du service. 11 refusa cette proposition en ajoutant, toutefois, qu’il était prêt à mettre son expérience au service des responsables du réarmement aérien américain, qui démarrait à ce moment.
Quand la guerre éclata en Europe, il se déclara tout net pour l’isolationnisme, s’opposant à Roosevelt, qui, d’ailleurs, ne le lui pardonna pas. Lorsque le conflit s’étendit au Pacifique et que l’Amérique entra à son tour dans la guerre, Lindbergh manifesta le désir de s’engager dans l’aviation, mais le président des États-Unis s’y opposa formellement.
Pilote d’essai à la Republic Aircraft Corporation, l’homme du Spirit of Saint Louis alla tester plusieurs appareils sur le front même. Au cours d’un vol sur un P-38 Lightning, alors qu’il était toujours considéré comme civil, il fut attaqué par des chasseurs japonais et abattit l’un d’eux. Il fut crédité de cinquante missions de combat.
En 1954, le général Eisenhower, alors président des États-Unis, le nomma général de brigade dans la réserve. Charles Lindbergh passa ses dernières années à Kipahulu, localité de la côte sud-est de l’île hawaïenne de Maui, où il mourut d’un cancer de la moelle épinière le 26 août 1974.
LA TRAVERSÉE ATLANTIQUE NORD DANS LES DEUX 2 SENS
Deux grands noms et une carrière
Pilotes de grands raids et aviateurs complets, Paul Codos et Maurice Rossi furent les premiers à franchir l’Atlantique Nord dans les deux sens. ils d’un exploitant forestier, Maurice Rossi naquit le 24 avril 1901 à Laverdure (Algérie). S’étant engagé dans l’artillerie en 1918, il passa dans l’aviation et fut breveté pilote à Istres l’année suivante.
Affecté à Oran, puis en Syrie, et enfin, en 1924, à l’Entrepôt spécial d’aviation n° 1 de Villacoublay, le sergent-pilote convoyeur Rossi résolut d’être pilote de raids. Ambitieux, volontaire, il mit tout en oeuvre pour y parvenir, travaillant ferme pour devenir pilote complet. Il sut, à l’occasion, exploiter habilement l’influence de ses amis pour se faire ouvrir certaines portes.
Breveté mécanicien d’avion, l’adjudant Rossi sortit de l’anonymat avec un vol sans escale de 1 750 km effectué le 20 avril 1927, sur un monomoteur Potez 25, avec le capitaine Dévé, professeur de navigation à l’école d’élèves-officiers de Versailles.

Paul Codos Né en: 1 er mai 1896 à Iviers (Aisne). Mort le: 30 janvier 1960 à Paris

Maurice Rossi Né en: 24 avril 1901 à Laverdure (Algérie). Mort le: 29 août 1966
Pilote de raids
Rossi s’entraîna au vol de nuit et au vol aux instruments, fit un stage de pilotage sans visibilité. Plus tard, il s’initia au morse et apprit à faire le point. Il se lia avec Joseph Le Brix, avec lequel il tenta en 1929 de joindre Paris à Saigon en quatre étapes avec le Potez 34 F-AJHU. En pleine nuit, l’équipage dut sauter en parachute au-dessus de la jungle birmane. Blessé, Rossi fut fait chevalier de la Légion d’honneur.

Le Joseph Le Brix porte sur le fuselage ses titres de gloire. Construit en 1930, équipé d’un Hispano-Suiza 12 Lb de 600 ch, puis d’un 12 Mbr (r pour réducteur) de 500 ch, le Blériot 110 fut aux mains de Codos et Rossi l’un des plus prestigieux avions de records français du début des années trente.
Le Brix conseilla à Lucien Bossoutrot, chef pilote chez Blériot, de s’adjoindre Rossi comme second pilote navigateur de l’avion de raids Blériot 110 F-ALCC. Agréé par le constructeur, il fut mis en congé des forces aériennes. Entre novembre 1930 et mars 1932, Bossoutrot et Rossi tentèrent à huit reprises de battre le record du monde de distance en ligne droite en circuit fermé, et se l’adjugèrent deux fois : en 1931, en parcourant, du 26 février au ler mars, 8 822 km en 75 heures 23 minutes à Oran; l’année suivante, du 23 au 26 mars, en franchissant une distance de 10 601 km en 76 heures 34 minutes, toujours à Oran.
De mauvaises conditions atmosphériques ou des incidents mécaniques interrompirent les autres tentatives après plusieurs dizaines d’heures de vol (67, 27, 56, 57, 61 et 44 heures). C’est en 1933 seulement que fut enfin levée l’interdiction ministérielle de toute tentative contre le record en ligne droite, intervenue en 1931 après la chute de deux Dewoitine D-33 (Trait d’union).

Avion venu soutenir les 2 aviateurs téméraires.
Le 10 février, Bossoutrot et Rossi s’envolèrent d’Istres pour Buenos Aires, mais durent se poser à Casablanca à la suite d’une fuite d’eau au niveau du circuit de refroidissement. La carrière du Blériot 110, baptisé Joseph Le Brix en hommage au navigateur disparu sur l’un des D-33, parut alors irrémédiablement compromise : Blériot ne pouvait plus assumer le financement de nouveaux raids.
De plus, Bossoutrot allait être occupé durant plusieurs mois à la mise au point de l’hydravion transatlantique quadrimoteur Blériot 5190 Santos-Dumont. A la suite d’une campagne de presse en faveur du Joseph Le Brix, le ministre de l’Air Pierre Cot consentit à avancer les fonds nécessaires à la remise en état de vol de l’appareil, ces fonds devant être toutefois retenus sur la prime de 1 million de francs promise à l’équipage français qui serait au 31 décembre 1933 détenteur du record du monde de distance en ligne droite. En outre, un pilote de grande valeur, recommandé par Costes fut choisi : Paul Codos.
Né à Iviers (Aisne) le 1 er mai 1896, et ouvrier typographe de son état, ce dernier s’engagea le 8 septembre 1914 dans l’artillerie de campagne. En 1917, à sa septième demande, il fut versé dans l’aviation; breveté pilote le 20 juin 1918, il fut désigné comme moniteur à l’école de pilotage de Miramas.
De 1920 à 1924, il appartint à trois entreprises de transport aérien à l’existence éphémère dont, en 19211922, les Aérotransports du Midi (lignes Ernoul). Il y fit la connaissance de Dieudonné Costes, avec qui il se retrouva à Air Union, où il entra le 25 septembre 1924. Affecté aux lignes Paris-Londres et Paris-Marseille, il devint ultérieurement chef pilote adjoint, puis, en 1938, inspecteur général d’Air France. Outre une expérience de treize ans de pilote de ligne, Codos présentait des références de pilote de records : Sur le Breguet 19 TR n° 3 Point d’interrogation, il avait battu, avec Costes, le record de distance en circuit fermé (8 029,440 km) à Istres du 15 au 17 décembre 1929, et cinq records internationaux de vitesse, de durée et de distance en circuit fermé avec charge de 500 kg et 1 000 kg ( janvier et février 1930, à Istres); sur le Breguet 330 n° 01 F-AKEZ, il avait, en compagnie d’Henri Robida, couvert la distance Paris-Hanoi en sept jours ( janvier 1932).
Rossi devenait le chef de bord du nouvel équipage. Il secondait Codos pour le pilotage et assurait- la navigation et les liaisons par TSF. Les conditions atmosphériques du moment incitèrent Rossi et Codos à prendre leur départ de New York en direction de l’Europe. Démonté, le Joseph Le Brix fut embarqué à bord du Champlain puis amené par chaland jusqu’à Floyd Bennet Field. Le 5 août 1933 à l’aube, Codos arrachait les 9 500 kg du Blériot 110 par un léger vent de trois quarts arrière. L’avion vola presque constamment dans les nuages.
Il aborda la terre française à Cherbourg, survola Le Bourget à basse altitude, après 33 heures 40 minutes de vol, se fit contrôler à Munich et à l’île de Rhodes. Voulant éviter le risque d’un atterrissage en campagne en pleine nuit dans une région inconnue, l’équipage se posa à Rayak (Syrie), après avoir parcouru 9 104,700 km. Le record de Gayford et Nicholetts était battu de plus de 550 km. Rossi fut nommé lieutenant et officier de la Légion d’honneur.
En septembre 1933, le Blériot 110 était parmi les cinq appareils de la mission chargée, sous l’autorité de Pierre Cot, de présenter en U.R.S.S. l’aviation commerciale française. Muni de carénages de roues et d’ailerons compensés, le monoplan s’envola du Bourget le 27 mai 1934 à 5 heures pour San Francisco, soit un vol de près de 10 000 km.
L’envol fut particulièrement délicat : la Morée fut sautée, la ligne de force évitée, mais l’appareil frôla au passage la cime d’arbres bordant l’extrémité du terrain. Commencée par beau temps, la traversée de l’océan se termina dans la crasse. La côte ouest des États-Unis ne put être atteinte : des vibrations de plus en plus violentes forcèrent Codos à atterrir à Floyd Bennet Field.
Ces vibrations provenaient de l’hélice, dont l’une des pales avait été endommagée par les arbres au départ du Bourget. Paris et New York avaient été reliés en 38 heures et 28 minutes (contre 37 heures 18 minutes pour Costes et Bellonte). Le Joseph Le Brix, qui totalisait un millier d’heures de vol, était l’unique avion au monde à avoir franchi l’Atlantique Nord dans les deux sens. Avant même son arrivée, le général Denain fit annoncer par radio à Rossi qu’il était promu capitaine et à Codos qu’il était fait commandeur de la Légion d’honneur.
Sachant que leur machine avait une autonomie de 12 000 km, Rossi et Codos quittèrent Istres le 16 janvier 1935 à 6 h 36 avec pour but Santiago du Chili. Dès le départ, la température de l’huile dépassa la normale sans affecter alors le fonctionnement du moteur. Pourtant, à l’aube du lendemain, une fuite d’huile dont l’importance faisait craindre le pire, fut découverte. Rossi lança un SOS. Faisant demi-tour, son fuselage couvert d’huile, l’avion fit route vers les îles du Cap Vert, distantes de 800 km.

Au dessus de la mer le brouillard s’annonce!

Carte postale annonçant l’échec du raid.
Il atteignit Praia à 13 h 20. En trente heures de vol, 6 000 kilomètres avaient été parcourus. C’est l’usure de la pompe récupératrice d’huile qui était cause de l’échec. L’avion regagna Buc le 15 mars. Ce fut son dernier raid. En dépit d’un palmarès demeuré sans égal dans le monde, il était promis à la démolition.
Dernières performances
La retraite forcée du Blériot 110 entraîna la séparation des deux coéquipiers. Chacun d’entre eux devait se signaler par de nouveaux exploits dans les années qui suivirent. Rossi ajouta à son palmarès personnel : Le record de vitesse sur 5 000 km, le 24 avril 1937 à Istres, sur le Caudron 640 (Typhon) F-AODR baptisé Louis Blériot, à 311,840 km/h; une participation à la course Istres-Damas-Paris sur le même appareil (mais avec abandon sur ennuis mécaniques, le 20 août 1937).
Codos et Rossi
Onze records de vitesse sans et avec charge su 1 000 km, 2 000 km et 5 000 km sur l’Amiot 370 prototype en compagnie d’André Vigroux, les 8 février 8 juin 1938; sur le même avion, avec le radio Esmond, le record de vitesse sur 10 000 km (Istres, 15 août 1939: 317,62 km/h).
De son côté, Paul Codos : se classa cinquième à 294 km/h dans Istres-Damas Paris, avec Maurice Arnoux sur le Breguet Fulgur F-APDY Raoul Ribière; relia Paris à Santiago du Chili en 58 h 42 mn sur 1 Farman 2.231 n° 01 F-APUZ Chef pilote Laure, Guerrero, avec Reine, Gimié et Vauthier (21 novembre 1937); effectua en octobre 1939 une reconnaissance au dessus de l’Atlantique Sud sur le Farman F-2.234-0 F-AQJM Camille Flammarion avec Guillaumet, Corne Néri et Cavaillès; assura des liaisons France-Djibouti, de 1940 à 1942 sur le Latécoère 522-01 F-ARAP et l’Amiot 370-0 F-AREU Anne-Marie. Paul Codos est décédé le, 30 janvier 1960, et Maurice Rossi le 29 août 1966.
LES PREMIERS BREVETS DE PILOTES
Louis Blériot, Ferdinand Ferber, Henry Farman et Léon Delagrange fut en 1909, parmi les huit premiers aviateurs à obtenir le brevet de pilote délivré par l’Aéro-Club de France. Le brevet de base de pilote d’avion (BB) est un brevet français pour les pilotes non professionnels. Ce brevet autorise le pilote à voler seul à bord dans un rayon de 30 km autour de l’aérodrome. Des extensions d’autorisation peuvent être accordées par un instructeur-examinateur.

Quelques grands pilotes militaires réunis sur une photo exceptionnelle : Cne Charles Marconnet, Ltt René Chevreau, Ltt Albert Féquant, Ltt Jacques de Caumont-la-Force, Ltt Joseph Maillols, Ltt René Jost et Ltt Albert Lucas
Création du premier établissement d’aviation militaire à Vincennes:

Le premier établissement d’aviation militaire fut créé en décembre 1909 au polygone de Vincennes par l’artillerie et le Cdt Etienne en est nommé directeur. Le deuxième établissement fut créé début 1910, au camp d’aviation de Chalons, dirigé par le génie et destiné à l’instruction des aviateurs militaires. Le premier aéroplane livré à l’armée sera un biplan Wright qui arrivera le 10 février 1910 au camp de Satory, près de Versailles.
L'HISTOIRE DU PARACHUTE
Moyen de sauvetage, arme offensive ou discipline sportive, le parachutisme doit son essor aux grandes opérations aéroportées de la Seconde Guerre mondiale. Posséder la maîtrise de l’air est l’un des rêves les plus anciens de l’homme. Le mythe d’Icare symbolise sa volonté de surmonter sa condition ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées dans l’acquisition de ses connaissances. Comme la montgolfière ou le cerf-volant, le parachute a donc un passé, une histoire. C’est en Orient, semble-t-il, que se situent les premières réalisations, qu’elles soient mythiques ou réelles.

Invention nouvelle pour descendre du haut d’un édifice sans le secours d’un escalier » : cette gravure du Mlle siècle constitue un témoignage sur les premières tentatives de chute freinée, laquelle allie aux possibilités connues du plus léger que l’air le principe de la sustentation mécanique défini en 1710 par Newton.
La légende veut ainsi que, en 2000 avant J.-C., un empereur de Chine se soit lancé d’une grange, accroché à deux parasols. La première relation connue est celle d’un missionnaire à son retour de Chine, lequel rapporte qu’en 1306 les fêtes du couronnement de l’empereur à Pékin furent marquées par des réjouissances fastueuses et des exploits extraordinaires.
Les foules avaient été particulièrement impressionnées par la prestation d’acrobates qui se jetèrent du haut de tours et touchèrent le sol sain et sauf grâce à des appareils que l’on pourrait baptiser maintenant (parachutes). En 1650, des ambassadeurs signalèrent qu’au Siam des équilibristes se lançaient du sommet de perches de bambou tenant dans leurs mains un parasol.
Les précurseurs occidentaux
En Occident, c’est à Léonard de Vinci que l’on attribue généralement l’invention du parachute. Dans une communication faite en 1502, il décrivait en ces termes l’engin qu’il avait imaginé : Un cadre de bois solide sert de base à une sorte de pavillon pyramidal de forte toile empesée haut de 12 brasses et large d’autant de chaque côté. Des angles partent quatre cordes qui soutiennent un homme.

L’Allemande Kathe Paulus réalisa le premier pliage et la première mise en gaine d’une voilure en 1892. Ce document la présente lors de son soixante-cinquième saut.
Fort heureusement ce touche-à-tout génial de la recherche ne tint pas à expérimenter son invention. Mais un principe était défini. 11 ne fut repris qu’en 1616 lorsque, dans un ouvrage intitulé Homo volens, l’évêque Fausto Veranzio décrivit à son tour un appareil lui aussi constitué d’un cadre de bois rigide soutenant cette fois une étoffe rectangulaire. Mais c’est seulement en 1710 que Newton définit la théorie mathématique du parachute et en 1779 que furent réellement entrepris les premiers essais.
Alors qu’il construisait son premier ballon, Joseph Montgolfier s’était intéressé au problème de la chute freinée et avait réalisé une sorte de demi-sphère de 2,40 m de diamètre, à laquelle le sujet de ses expériences, un mouton, était rattaché par douze cordes. Le premier largage d’un animal à partir d’un ballon fut réalisé en 1784 par Jean-Pierre Blanchard, qui confia son chien à un appareil de sa conception. Un pas restait à franchir, celui du saut humain.
Le premier qui l’osa fut Jacques André Garnerin, un autodidacte passionné d’aéronautique. Le ler brumaire an VI (22 octobre 1797), Garnerin effectua une ascension au-dessus du parc Monceau. Sous la sphère qui l’emportait était suspendue une coupole de tissu de 10 m de diamètre et d’une surface de 30 m2 reliée à la nacelle par de gros cordages. Arrivé à 700 m d’altitude, l’aéronaute coupa ces cordes;
Libéré, le ballon s’éleva rapidement et explosa, tandis que le parachute se déployait et que Garnerin, dans sa nacelle, commençait sa descente. L’ensemble fut bientôt secoué de balancements effrayants, mais le premier parachutiste se posa sans problème, acclamé par une foule d’autant plus excitée qu’elle avait cru être témoin d’un effroyable accident.
Sur les conseils de l’astronome Lalande, Garnerin modifia sa voilure en y pratiquant une ouverture centrale qui, en permettant à l’air de s’échapper, éliminait les dangereuses oscillations qui avaient marqué la première descente.

Confiant dans son manteau-parachute, Frantz Reichelt s’élança, en 1912, du premier étage de la tour Eiffel avec l’accord des autorités. La voilure n’eut pas le temps de se déployer, et son inventeur tomba comme une pierre.
Bien qu’il eût été breveté en 1802 comme appareil de sauvegarde pour les aérostiers en perdition, ce parachute servit surtout pour des exhibitions publiques. De 1815 à 1836, Garnerin, sa femme, Jeanne Geneviève, et sa nièce, Élisa, exécutèrent dans l’Europe entière des démonstrations fortes lucratives.
Cependant, les recherches se poursuivaient dans le but de réduire l’encombrement de ces engins. En 1887, Thomas Scott Baldwin, ayant réalisé un appareil sans armature et indépendant de la nacelle, effectua un saut de 1 250 m durant lequel il resta suspendu par les mains à un anneau reliant les suspentes. Cette technique peu sécurisante fut cependant reprise dans les années qui suivirent par les frères Spencer, qui se produisirent de la sorte dans 1e monde entier.
C’est l’Allemande Kathe Paulus qui, en 1892, osa réaliser 1e premier pliage et la première mise en gaine de sa voilure; quand elle se jetait de la nacelle, son poids faisait céder une boucle serrant le gainage, et le parachute se trouvait libéré. De 1893 à 1909, la jeune femme exécuta ainsi 147 sauts publics. A la même époque, les Américains Stewens et Broadwick eurent l’idée de placer leur appareil dans un sac dorsal. La voilure était reliée à un point fixe du ballon par une sangle qui en assurait l’extraction. Le parachute à ouverture automatique était né.
De l’exhibition au sauvetage
Devant le nombre d’accidents mortels qui endeuillaient l’aviation naissante, l’Aéro-Club de France fonda en 1910 (cette année-là on avait dénombré vingt-huit morts) le prix Lalande, destiné à récompenser la réalisation d’un parachute d’avion pliable et efficace.
Le premier homme à sauter d’un aéroplane fut l’Américain Albert Berry, qui, le 1er mars 1912, fut pressenti pour accomplir cet exploit dans 1e cadre d’une campagne de publicité au profit d’un nouvel avion (son parachute était logé sur l’axe du train d’atterrissage).
En France de nombreux chercheurs se penchèrent également sur la question et les expérimentations à partir d’ouvrages d’art se multiplièrent, notamment à partir du premier étage de la tour Eiffel. C’est de là que le tailleur Frantz Reichelt, croyant avoir surmonté les difficultés grâce à un manteau de son invention, s’élança le 6 février 1912 pour un saut mortel.
Le 19 août 1913, Charles Pégoud décolla seul aux commandes d’un Blériot qui devait être sacrifié dans l’aventure. Arrivé à bonne hauteur, il libéra une voilure logée sur le fuselage de l’appareil. Le parachute se gonfla et arracha Pégoud de son siège, ce saut permit au constructeur du parachute, Bonnet, de remporter le prix Lalande. Jean d’Ors, Le Bourchis, sautèrent eux aussi d’avions dans les mois qui suivirent. Un concours de sécurité en aéroplane fut organisé en juin 1914 et fut remporté par 1e constructeur Robert.
Toutes ces expériences intéressaient vivement les autorités, et, avec les rumeurs de guerre, les conditions semblaient réunies pour que l’idée de fournir aux équipages militaires un matériel de sauvetage, rudimentaire certes, mais suffisamment efficace, fît rapidement son chemin.
Et pourtant aucune des nations qui entrèrent en guerre en août 1914 n’envisagea d’introduire cet élément dans la dotation de ses aviateurs. C’est seulement au vu des pertes enregistrées en 1916 et au début de 1917 que quelques recherches furent entreprises. En France, les études portèrent sur le parachute de type Robert, qui fut transformé en parachute à ouverture commandée. Le 10 juillet 1917, le caporal Lallemand, à qui l’on doit cette amélioration, effectua le premier d’une courte série de sauts qui lui valurent la croix de guerre.

Un Polikarpov Po-2 utilisé pour le largage de parachutistes au centre de formation de Touchino en 1935; c’est sous l’impulsion du major Minov que le parachute trouva en U.R.S.S. ses premières applications militaires offensives.
Mais les autorités refusèrent de cautionner le nouveau système d’ouverture. Lallemand lui apporta donc des modifications supplémentaires et, le 27 mars 1918, sauta en ouverture automatique. Fatalité, la voilure ne se déploya pas, et Lallemand s’écrasa au sol. Les études furent alors confiées à l’établissement de Chalais-Meudon, qui mit au point un matériel de qualité, malheureusement beaucoup trop tard pour qu’il pût être mis en service au cours des opérations.
En Angleterre, malgré la réalisation de l’ingénieur Calthrop, dont l’efficacité fut maintes fois démontrée par des expériences réussies, l’aviation termina également la guerre sans que les pilotes fussent dotés de parachute. Du côté allemand, on se montra plus soucieux de la vie des aviateurs; à la fin de 1917, certains équipages furent dotés d’un parachute des types Paulus puis Heinecke, et plusieurs dizaines de navigants, dont Ernst Udet, doit à cette précaution d’avoir la vie sauve.
Cet état de choses apparaît d’autant plus étonnant que dans le domaine de l’aérostation le problème de la sauvegarde du personnel était jugé essentiel dès les premiers mois de la guerre. Moyens d’observation privilégiés, les ballons figuraient parmi les cibles prioritaires. Les premiers aérostats abattus furent des engins allemands, mais, le 9 octobre 1915, celui du maréchal des logis Schmitt fut incendié à son tour;
L’observateur français survécut, mais il était gravement brûlé. Le 14 octobre, le maréchal des logis Roze succombait lors d’une attaque du même type. L’établissement central du matériel aéronautique de Chalais Meudon se vit donc confier la tâche de réaliser un parachute répondant aux besoins spécifiques des aérostiers. Assisté du capitaine Le Tourneur, le lieutenant Juchmesch mit au point un appareil qui fut essayé avec succès, lesté de sacs de sable.

Parfaitement équipés et entraînés, les Fallschirmjàger constitueront, à partir de 1942, une infanterie d’élite.
Le 17 novembre 1915 un volontaire, le quartier-maître Duclos, effectuait une descente, devenant ainsi le premier parachutiste militaire français. Grâce au courage et à l’assurance de cet homme, qui n’hésita pas à effectuer dix-sept démonstrations en trente-quatre jours, le parachute fut homologué, et la confiance des aérostiers lui fut aussitôt acquise. Dès le 16 mars 1916, le sous lieutenant Levassor d’Yverville abandonna sa nacelle à 3 000 m d’altitude.
Le nombre de sauts de sauvetage effectués par les observateurs français durant le conflit n’est pas connu avec exactitude. Le journaliste Jacques Mortane en a recensé plus de 157, mais ce chiffre est assurément inférieur à la réalité. De leur côté, Anglais et Américains prirent aussi des mesures de sauvegarde. Avec le parachute Spencer, les Anglais effectuèrent 405 descentes.
Quant aux Américains, ils adoptèrent, dès leur arrivée en ligne, le matériel français, qui sauva 125 de leurs observateurs. Enfin, les Allemands avaient fait confiance dès 1916 au parachute présenté par Kathe Paulus, dont plus de 7 000 exemplaires furent livrés à l’armée impériale. Bien que d’autres facteurs entrent en ligne de compte, la comparaison des pertes en vies humaines de l’aviation et de l’aérostation est significative, puisque 5 500 aviateurs français périrent en mission contre 31 aérostiers seulement.
II fallut cependant attendre encore une dizaine d’années pour que l’emploi du matériel de sauvetage se généralise dans l’aviation. Seule l’Amérique s’attacha avec énergie à résoudre le problème de la sécurité de ses navigants. A l’instigation du général Mitchell, un centre technique d’expérimentation fut créé sur la base MacCook à Dayton (Ohio), et placé dès la fin de 1918 sous la direction du Major Hoffman.
La première tâche à laquelle s’attelèrent Hoffman et son équipe fut d’expérimenter l’ensemble du matériel mondial et de définir les critères auxquels devait répondre un parachute de sauvetage destiné à l’aviation. Les données recueillies durant ces travaux permirent aux spécialistes d’affirmer que seule l’ouverture commandée pouvait fournir le haut degré de sécurité requis.
Encore fallait-il en convaincre les autorités, qui, elles, restaient favorables au procédé d’ouverture automatique. La section d’Hoffman travailla donc à parfaire un prototype que l’un de ses membres, Floyd Smith, avait conçu en 1918. Le 28 avril 1919, après que plusieurs essais eurent été effectués avec des mannequins, Leslie Irwin se jeta d’un appareil volant à 130 km/h à 460 m d’altitude.
II tira rapidement sur la poignée de commande d’ouverture et, deux secondes plus tard, la voilure se déployait. Le 19 mai, Floyd Smith exécutait la première chute libre de quelques secondes. Désormais jugé fiable, le parachute entra en service dans les unités américaines dès 1920, et les pilotes furent autorisés à accomplir des sauts d’entrainement à partir de 1923.
En France, les progrès furent plus lents. Bien qu’un matériel de qualité eût été mis au point au lendemain de la guerre et qu’il fît l’objet d’améliorations incessantes, la dotation des unités tarda. En 1927, cependant, vingt et un aviateurs avaient pu quitter leur machine en perdition. Mais c’est en 1928 seulement qu’intervinrent les premières mesures visant à généraliser l’emploi du parachute et en 1935 que le capitaine Geille créa à Avignon-Pujaut la première école de saut.

Les parachutistes allemands sautent au-dessus de la crête, où ils remporteront leur dernière victoire.
Si l’Italie prit également une part active aux recherches avec la réalisation du (Salvator) par le lieutenant Fréri, les autres nations s’inspirèrent des modèles américains. C’est ainsi qu’en 1939 les pilotes anglais et allemands, comme ceux de trente-six autres pays, étaient dotés du même parachute Irwin. Adopté par toutes les aviations durant la Seconde Guerre mondiale, le parachute de sauvetage a été régulièrement perfectionné. Il existe actuellement des modèles s’ouvrant en deux secondes avec une perte d’altitude de moins de 50 m et descendant à quelque 7 m/s.
En 1956, à bord des avions à réaction le parachute a cédé le pas au siège éjectable, que les Allemands utilisaient déjà sur le Dornier 335, le Heinkel 162 et le Messerschmitt 163 pendant la Seconde Guerre mondiale. Parfois, c’est l’habitacle entier qui se détache du fuselage, évitant ainsi au pilote le choc du vent relatif.
La découverte d’une nouvelle arme
L’idée de l’utilisation militaire du potentiel que représentait le parachute n’est pas nouveau puisque Garnerin écrivait déjà : II est certain que ces machines ne pourront jamais servir que comme machine de guerre. Heureux alors l’État qui s’en servira le premier.

C’est l’Allemagne qui, la première, sut tirer le meilleur parti des troupes aéroportées.
Durant la Première Guerre mondiale de timides tentatives furent faites pour explorer, non pas la voie offensive, mais les possibilités d’infiltration discrète qu’offrait cette invention. Dès le début des opérations, les services de renseignements se rendirent compte de l’intérêt que présentait l’avion pour le transport d’hommes derrière les lignes ennemies.
A partir du 18 novembre 1914, date à laquelle le sous-lieutenant Pinsart déposa un agent secret au sud du Castelet, les meilleurs pilotes français (Védrines, Guynemer, Navarre) exécutèrent des missions de ce type.
Cependant, les états-majors envisageaient une utilisation plus offensive du parachute. En 1918, le commandant Évrard proposa un plan audacieux qui consistait à attaquer un QG allemand avec cent cinquante hommes dûment entrainés au saut. Beaucoup plus ambitieux, le général Mitchell envisageait de larguer, à partir de 1200 bombardiers Handley Page, la première division d’infanterie américaine dans le but de prendre à revers un ennemi subissant par ailleurs un assaut frontal conventionnel.
Un système de ravitaillement par air de cette force était envisagé. Ces deux projets ne purent être réalisés avant l’Armistice. Malgré une démonstration réussie, en 1920, Mitchell n’emporta pas l’adhésion de l’état-major, et ses projets furent oubliés. Mais d’autres pays allaient prendre la relève.
Le phénomène soviétique
En effet, c’est l’Union soviétique qui devait être le berceau des troupes aéroportées. Dans ce pays bouleversé par la guerre civile, obligé de se doter de nouvelles structures économiques et politiques, les théories militaires d’avant-garde n’étaient pas étouffées par le dogmatisme d’états-majors traditionalistes.
Dès 1925, une mission aéronautique fut envoyée en France pour examiner le matériel de sauvetage. Quatre ans plus tard, le chef de cette mission, le major Minov, repartait pour l’Amérique afin d’y étudier la technique de construction des parachutes. C’est alors qu’il découvrit les idées de Mitchell et se convainquit de leur valeur.
De retour en U.R.S.S., il mit sur pied, dès le 2 août 1930, une première manoeuvre expérimentale : à la tête d’une dizaine de volontaires, il prouva qu’il était possible de mettre rapidement en oeuvre une troupe fortement armée. Un mois plus tard, un commando similaire parvenait, au cours de manoeuvres dans la région de Moscou, à surprendre un état-major adverse.

En avril 1940, la Luftwaffe largue la 7e division aéroportée en Norvège; les terrains d’Oslo-Fornebu et de Stavanger-Sola seront capturés en quelques heures.
Ces démonstrations emportèrent la conviction du chef d’état-major de l’armée rouge, le futur maréchal Toukhatchevsky, et, grâce à son appui, le parachutisme militaire connut un développement spectaculaire en Union soviétique. Dès 1931, un détachement expérimental était mis sur pied sous la direction du général Alksnis.
A la fin de 1933, 29 bataillons regroupant 8 000 parachutistes avaient été créés, et des écoles de formation de moniteurs avaient été organisées (la plus importante se situait à Touchino, près de Moscou).
En 1934 l’U.R.S.S. s’était donc forgé une doctrine d’emploi et disposait des forces capables de la mettre en application. La preuve en fut donnée lors des manoeuvres de Biélorussie, durant lesquelles 900 parachutistes furent largués.
Plus stupéfiantes encore, les manoeuvres de Kiev donnèrent aux observateurs étrangers la preuve de la suprématie de l’Union soviétique en la matière : en quelques minutes, trente quadrimoteurs larguèrent 1 200 hommes au-dessus d’un terrain d’aviation; la place conquise, un deuxième groupe d’avions débarqua une forcé de 2 500 fantassins; enfin, une troisième vague apporta les stocks de munitions et l’artillerie de campagne.
Le problème du transport des troupes avait été résolu dès 1934 par la mise en service du TB-3, un quadrimoteur pouvant emporter quarante hommes et dont les six ouvertures de saut permettaient une évacuation rapide, réduisant d’autant la zone de dispersion. Si l’on ajoute l’effort de propagande considérable qui fut mené par l’Osso Aviakhim, un organe de l’armée rouge, pour attirer la jeunesse vers les sports aéronautiques (800 000 sauts de jeunes civils furent organisés à partir de tours et 11 000 à partir d’avions en 1935), on mesurera le degré d’avancement de l’U.R.S.S. en ce domaine.

Le 16 mars 1954, les Douglas C-47 de l’armée de l’Air larguent un bataillon de parachutistes au-dessus de la DZ Isabelle H à Dién Bién Phu. Jusqu’aux derniers jours des volontaires seront ainsi parachutés pour renforcer les 15 000 hommes encerclés dans la cuvette.
Mais en 1937 les purges staliniennes devaient porter un coup fatal à cet élan. L’exécution du maréchal Toukhatchevsky et la disparition de nombreux officiers d’élite marquèrent la fin de la suprématie soviétique sur le plan du parachutisme militaire. Les opérations menées par l’armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale n’eurent jamais l’ampleur qu’aurait pu laisser préjuger leur développement initial.
Dans les années trente, d’autres pays allaient également explorer avec plus ou moins de succès la voie ouverte par les parachutistes soviétiques. En France, l’état-major, d’abord tenté par la solution de l’aérotransport, autorisa en 1935 deux officiers de l’armée de l’Air, les capitaines Geille et Durieux, à effectuer un stage de parachutisme à Touchino.
Ils étaient accompagnés par le commandant Péchaud, de l’armée de Terre, plus spécialement chargé d’étudier l’utilisation tactique des troupes aéroportées. Bien que breveté et fort d’une expérience irremplaçable, Geille, à son retour en France, se heurta à un mur d’incompréhension.
C’est sans aucun crédit spécial qu’il dut mettre sur pied un centre de parachutisme à Avignon-Pujaut. Malgré les difficultés, des stages d’initiation au parachutisme de sauvetage furent organisés à partir du le, octobre 1935, mais il fallut encore attendre plus d’un an pour que fussent exploités les rapports du commandant Péchaud et des observateurs admis aux manoeuvres de Kiev.
Deux groupes d’infanterie de l’Air (GIA), forts de 365 hommes chacun, furent en effet créés en avril 1937, dont les cadres avaient été formés à Avignon. Les premiers vols d’entraînement des parachutistes, effectués sur Potez 650 ou Farman 224, débutèrent en mai. La doctrine d’emploi de ces forces semblait clairement définie, puisque l’instruction ministérielle présidant à leur création précisait qu’elles étaient destinées à être transportées par avion et débarquées en territoire ennemi par parachute.
Le 601e. Et le 602e GIA ne fut pourtant jamais engagés de la sorte. Un moment regroupé (en mars 1939) en Algérie, en prévision d’une action possible en Tripolitaine, ces unités furent bientôt rapatriées et c’est finalement comme corps francs que les parachutistes prirent part aux combats sur le front d’Alsace en janvier et février 1940. Ils furent ensuite repliés vers l’arrière, et c’est en mer, en route pour l’Algérie, qu’ils apprirent la nouvelle de l’armistice. Le véritable destin des parachutistes devait s’accomplir quelques années plus tard sous les couleurs de la France libre.
L’Italie, quant à elle, avait utilisé le parachute comme moyen de ravitaillement des troupes en 1935, durant la campagne d’Éthiopie. En 1938, le maréchal de l’Air Italo Balbo créa le premier bataillon de « fantassins du ciel », composé exclusivement de supplétifs libyens. Un second bataillon vit le jour l’année suivante, de même que l’école de Tarquinia, destinée à former les premiers volontaires italiens.
La réunion des bataillons libyens et italiens permit de mettre sur pied un premier régiment parachutiste italien, mais une série d’accidents mortels freina quelque temps ses activités. En 1942, malgré tout, l’effectif d’une division avait été entraîné cette force fut engagée essentiellement durant la guerre du désert, en Libye et en Égypte. En fait, c’est l’Allemagne qui, la première, sut tirer le meilleur parti des possibilités offensives de l’arme nouvelle.
Les premières opérations aéroportées l’atout allemand
En septembre 1935, alors qu’à l’École d’aviation commerciale de Berlin, qui servait de couverture à une organisation militaire, toute une série d’études théoriques et pratiques étaient menées en ce domaine, le général Goering ordonna la création d’un premier bataillon parachutiste constitué de volontaires issus de sa garde personnelle et intégré dans la Luftwaffe.
Une école de saut fut fondée à Spandau, puis une autre à Stendhal, relevant, elle, de la Wehrmacht. Les problèmes techniques furent assez rapidement résolus avec l’adoption du parachute à ouverture automatique RZ 1 et la mise en service du trimoteur Ju-52, capable d’emporter dix-huit hommes équipés.
Le ler juillet 1938 le Brigadegeneral Student était nommé inspecteur des troupes aéroportées; un an plus tard, il se trouvait à la tête d’une division complète. S’opposant aux conceptions restrictives de l’aviation et de l’armée de Terre, il considérait que cette division devait être engagée en bloc dans des missions de grande envergure. La valeur de ses idées devait être démontrée sur le terrain.
Les troupes aéroportées allemandes furent employées pour la première fois durant la campagne de Norvège, où, dès le 9 avril 1940, elles établirent une tête de pont à Stavanger-Sola. Mais c’est surtout lors de l’offensive. Le 17 juillet 1953, en Indochine, les chasseurs parachutistes sont largués aux abords immédiats de la ville de Lang-son, au nord du 17è parallèle. Le succès de cette opération éclair de grande envergure ne modifia pas la situation des troupes françaises, prisonnières dans leurs camps retranchés lancée contre l’Europe occidentale qu’elles firent Icur, preuves. Deux obstacles majeurs pouvaient entraver l’avance des troupes nazies aux Pays-Bas, le système défensif derrière lequel s’abritaient quatre corps d’armée néerlandais et, en Belgique, le barrage constitué par le canal Albert avec son verrou principal, le fort d’Eben-Emael.
Contre !’Avis des officiers de la Werhmacht, Hitler décida (le faire confiance aux hommes de Student. La neutralisation du canal Albert fut confiée à un groupe de 427 hommes commandés par le Hauptmann Koch, l’attaque du fort à l’Oberleutnant Witzig à la tête de 85 combattants. Le 10 mai 1940 à 4 h 30 du matin, les avions remorqueurs et les planeurs (cette solution avait été retenue pour obtenir le plus grand effet de surprise possible) décollèrent de Cologne. Malgré les accidents de remorquage qui amputèrent le groupe Witzig, l’opération était déclenchée. Le pari de Student se révéla payant.
Cloués par la surprise, les soldats belges ne purent détruire les ouvrages d’art franchissant le canal qu’en un seul point et le fort d’Eben-Emael, réputé imprenable, dut se rendre au bout de quelques heures. Aux Pays-Bas, quatre bataillons furent largués simultanément sur différents points du pays. Si la partie du plan visant à s’emparer de La Haye échoua, la désorganisation du système de défense hollandais fut complète, et le 13 mai les Panzer purent faire leur jonction avec les troupes aéroportées; le lendemain, l’armée néerlandaise capitulait.

En 1956, la campagne de Suez donna lieu à la dernière opération aéroportée française de grande envergure. Ici, au matin du 5 novembre, les H paras attendent, à côté des Nord 2501 de la 61, escadre, stationnée à Tymbou, l’ordre de s’embarquer à destination de Port-Saïd.
Après un an d’inactivité, les parachutistes de Student furent de nouveau engagés dans les Balkans, où ils se distinguèrent notamment en Crète dans le cadre de l’opération Merkur Crète. Mais les pertes furent importantes, et, à compter de cette date, aucune action de grande envergure ne devait plus reposer de façon spécifique sur les troupes aéroportées. Certes, elles livrèrent encore de durs combats, au Monte Cassino ou en Russie par exemple, mais engagées comme infanterie d’élite.
Les parachutistes alliés
Les pays anglo-saxons ne semblent avoir pris conscience des possibilités offertes par les parachutistes qu’au vu de la démonstration faite par les Allemands en mai 1940. Malgré ce retard, l’Angleterre et les États-Unis allaient, poussés par les nécessités de la guerre, mettre sur pied des forces d’une efficacité redoutable.
Il serait vain de vouloir énumérer toutes les actions où elles eurent l’occasion de s’illustrer, mais, en résumé et de façon schématique, l’action britannique devait obtenir les meilleurs résultats dans le domaine du raid stratégique, alors que les Américains remportèrent leurs plus grands succès dans les actions aéroportées de masse.
C’est en juin 1940 que le Major J.F. Rock, du Royal Engeeners, mit sur pied la première école de parachutisme britannique à Ringway. Pour l’Angleterre, isolée sur le plan militaire, ces premiers commandos représentaient l’un des seuls moyens de reprendre contact avec l’ennemi. Le type d’opérations exécutées par ces forces découlait de cette situation incursions rapides en territoire ennemi, attaques d’installations vitales, missions de renseignements, contacts avec les premiers mouvements de résistance.
Des opérations victorieuses furent ainsi montées contre des objectifs stratégiques, comme l’aqueduc de Tragino (Italie du Sud), attaqué le 10 février 1941, ou la station radar de Bruneval, détruite en février 1942 (cette mission permit à l’Angleterre de conserver une avance vitale en ce domaine). D’autres en revanche se soldèrent par des échecs, comme la première attaque du centre de production d’eau lourde de Vermok en Norvège.
l'HISTOIRE DU ZEPPELIN
Un zeppelin est un aérostat de type dirigeable rigide, de fabrication allemande, mais le mot est souvent utilisé dans la langue populaire pour désigner n’importe quel ballon dirigeable. C’est le comte allemand Ferdinand von Zeppelin qui en initie la construction à la fin du XIXe siècle. La conception très aboutie des zeppelins en fait des références pour tous les dirigeables rigides, de sorte que (zeppelin) devient un nom commun, encore que cela ne s’applique en français qu’aux dirigeables rigides allemands. Le dirigeable rigide français Spiess (construit par Zodiac en 1912), par exemple, bien que ressemblant de près à un zeppelin, n’a jamais été nommé de la sorte.
Comte allemand Ferdinand von Zeppelin 1838-1917
Les dirigeables rigides diffèrent des dirigeables de type souple en ce qu’ils utilisent une enveloppe externe aérodynamique montée sur une structure rigide avec plusieurs ballons séparés appelés (cellules). Chaque cellule contient un gaz plus léger que l’air (le plus souvent de l’hydrogène). Un compartiment relativement petit pour les passagers et l’équipage est ajouté dans le fond du cadre. Plusieurs moteurs à combustion interne fournissent l’énergie propulsive.
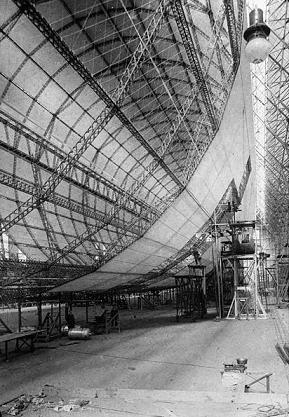
Le Zeppelin est un dirigeable à coque rigide (ici en construction en Allemagne, près du lac de Constance, en 1928).
Outre la création de la société de construction d’aéronefs, LZ (Luftschiffbau Zeppelin), qui en tout produisit cent dix-neuf appareils jusqu’en 1938, le comte von Zeppelin fonde la première compagnie aérienne commerciale au monde, dénommée DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-AG). Les deux entreprises sont basées à Friedrichshafen, en Allemagne.
Ayant dès 1913 des doutes sur la validité du concept des dirigeables, le comte crée une succursale, en collaboration avec Bosch et Klein, la VGO Versuch Gotha Ost, Staaken par la suite (qui produira des avions bombardiers géants, mais de conception classique), ainsi qu’un département aviation au sein de LZ, qui sera dirigé par Claudius Dornier et chargé d’une recherche plus innovante sur les avions métalliques.

Le LZ 126 atterrissant dans le New Jersey en 1924
Quand le comte meurt en 1917, Hugo Eckener lui succède à la tête de l’entreprise. Il est à la fois un maître de la publicité et un capitaine d’aéronef très expérimenté. C’est sous sa houlette que les zeppelins atteignent leur apogée. L’entreprise est prospère jusqu’aux années 1930 et réalise des transports de l’Allemagne vers les États-Unis d’Amérique et l’Amérique du Sud. L’aéronef qui rencontre le plus de succès durant cette période est le LZ 127 (Graf Zeppelin) qui parcourt plus d’un million et demi de kilomètres et accomplit le premier et seul tour du monde en dirigeable.
La grande dépression et la montée du nazisme en Allemagne contribuent tous deux à la disparition des aéronefs transportant des passagers. En particulier, Eckener et les nazis ont une haine mutuelle : LZ est nationalisée par le gouvernement allemand vers 1935. Elle ferme quelques années après, à la suite de la catastrophe du Hindenburg, au cours de laquelle le vaisseau amiral prend feu à l’atterrissage.
Pendant la vingtaine d’années d’existence des Zeppelins au sein de la compagnie aérienne, l’exploitation de ce type d’aérostat est assez profitable et les voyages sont menés en toute sécurité, jusqu’à l’incendie du Hindenburg.
Les débuts
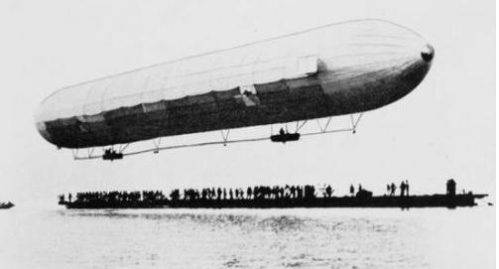
Le premier vol d'un zeppelin, le 2 juillet 1900.
Le comte semble s’intéresser à la construction d’un ballon dirigeable à l’issue de la Guerre franco-allemande de 1870-1871, après avoir été témoin de l’utilisation par les Français de ballons pendant le siège de Paris. Il voit aussi l’utilisation militaire de ce type d’aéronefs en 1863 pendant la guerre de Sécession à laquelle il participe comme observateur militaire du côté de l’Union.
Il développe sérieusement son projet après sa retraite anticipée de l’armée en 1890, à l’âge de 52 ans. Le 31 août 1895, il dépose un brevet incluant les principales caractéristiques du futur engin, même si toutes ne seront pas retenues au stade de la construction. Un squelette rigide en aluminium d’une forme mince, fabriqué par l’entreprise de Gustav Selve à Altona, fait de poutres en anneaux et en long.
L’espace pour le gaz contenu dans de nombreuses cellules cylindriques ; la possibilité de naviguer en utilisant des ailerons pour le gouvernail et la profondeur (hauteur) ; deux nacelles séparées reliées rigidement au squelette ; des hélices montées à la hauteur de la résistance maximum de l’air ; la possibilité de joindre plusieurs aéronefs en convoi.
Le comité d’experts auquel il présente ses plans en 1894 manifestant peu d’intérêt, le comte est obligé de financer lui-même la réalisation de ce projet. En 1898, il fonde la Gesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt (société pour la promotion des vols en dirigeable) et apporte plus de la moitié des 800 000 marks du capital initial. Il délègue la réalisation technique à l’ingénieur Theodor Kober, puis à Ludwig Dürr.
La construction du premier dirigeable zeppelin commence en 1899 dans un hangar d’assemblage flottant sur le lac de Constance dans la baie de Manzell à Friedrichshafen. Le lieu est choisi pour faciliter la difficile procédure du départ, car le hangar pouvait facilement être placé face au vent. Le prototype dirigeable LZ 1 (LZ pour (Luftschiff Zeppelin) avait une longueur de 128 m, était doté de deux moteurs de 14,2 ch Daimler et conservait son équilibre en déplaçant un poids entre ses deux nacelles.
Le premier vol d’un zeppelin intervient le 2 juillet 1900. Au bout de 18 minutes, le LZ 1 est forcé de se poser sur le lac après que le mécanisme qui permet d’équilibrer le poids casse. La réparation effectuée, la technologie démontre son potentiel dans les vols suivants en portant à 9 m/s (32,4 km/h) le record de vitesse de 6 m/s (21,6 km/h) de l’aéronef français La France, mais ne parvient pas à convaincre un investisseur potentiel. Ayant épuisé ses ressources financières, le comte est forcé de démonter le prototype et de dissoudre la société.
Une naissance difficile
Grâce au soutien de passionnés d’aéronautique, l’idée de von Zeppelin connaît une seconde (et troisième) chance. Elle peut être développée en une technologie raisonnablement fiable utilisable dès lors de manière profitable pour l’aviation civile et militaire.
Les dons et le profit d’une loterie spéciale, joints à quelques fonds publics et 100 000 marks du comte lui-même, permettent la construction du LZ 2, qui décolle pour la première et dernière fois le 17 janvier 1906. Après que les deux moteurs tombent en panne, il fait un atterrissage forcé dans les montages de l’Allgäu, où le dirigeable, provisoirement amarré, est ensuite endommagé de façon irréparable par une tempête. Son successeur, le LZ 3, qui incorpore toutes les parties de LZ 2 encore utilisables, est le premier zeppelin à voler sur de longs parcours, totalisant 4 398 km pendant 45 vols jusqu’en 1908. La technologie devenant intéressante pour les militaires allemands, ceux-ci achètent le LZ 3 que l’on renomme Z I. Il sert comme zeppelin-école jusqu’en 1913, jusqu’à ce que, technologiquement dépassé, il soit réformé.
L’armée souhaite aussi acheter le LZ 4 mais exige la démonstration que le vaisseau peut faire un trajet de 24 heures. Pendant qu’il tente d’accomplir cette obligation, l’équipage doit faire un atterrissage prématuré à Echterdingen près de Stuttgart. Là, un coup de vent arrache l’aéronef de son amarre dans l’après-midi du 5 août 1908. Il s’écrase ensuite dans un arbre, prend feu et brûle rapidement. Personne n’est sérieusement blessé (bien que deux mécaniciens qui réparaient les moteurs aient sauté du zeppelin), mais cet accident aurait certainement mis un terme au projet si un spectateur dans la foule n’avait décidé de lancer une collecte qui réunit la somme impressionnante de 6 096 555 Marks. Ces nouveaux fonds permettent au comte de fonder la Luftschiffbau Zeppelin GmbH (construction de dirigeable Zeppelin Ltd.) et d’établir la fondation Zeppelin. Ainsi, le projet renaît comme le phénix de ses cendres et son financement est garanti durablement.
Les zeppelins avant la Première Guerre

L’USS Akron (ZRS-4) au dessus de Manhattan en 1931-1933
Dans les années précédant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, à l’été 1914, un total de 21 autres aéronefs zeppelin (du LZ 5 au LZ 25) sont construits. En 1909, LZ 6 devient le premier zeppelin à être utilisé pour le transport de passagers. À cette fin, il est acheté par la première compagnie aérienne Deutsche Luftschiffahrts-AG (DELAG). Six autres dirigeables sont vendus à la DELAG jusqu’en 1914, et reçoivent des noms en sus de leurs numéros de production, par exemple LZ 11 (Viktoria Luise) (1912) et LZ 17 (Sachsen) (1913). Quatre de ces vaisseaux sont détruits par des accidents, la plupart pendant leur transfert au hangar, sans faire de victimes. Au total, les dirigeables DELAG voyagèrent sur environ 200 000 km et transportèrent environ 40 000 passagers.
Les 14 autres zeppelins construits avant-guerre sont achetés par l’armée et la marine allemande, qui leur donne les références Z I/II/ et L 1/2/, respectivement. Pendant la guerre, l’armée change sa méthode de dénomination à deux reprises : après Z XII, ils passent à l’utilisation des nombres LZ, plus tard, ils ajoutent 30 pour empêcher l’évaluation de la production totale.
Quand la Première Guerre mondiale éclate, les militaires réquisitionnent aussi les trois vaisseaux DELAG. À ce moment, ils ont déjà réformé trois autres zeppelins (LZ 3, Z I, inclus). Cinq supplémentaires sont perdus dans des accidents, dans lesquels deux personnes périssent : une tempête fait couler en mer du Nord le zeppelin de la marine LZ 14, L 1, noyant 14 soldats, et le LZ 18, L 2, s’enflamme à cause de l’explosion d’un moteur, tuant la totalité de l’équipage. En 1914 les nouveaux Zeppelins ont des longueurs de 150 à 160 m et des volumes de 22 000 à 25 000 m3, leur permettant de transporter environ 9 tonnes. Ils sont le plus souvent mus par trois moteurs Maybach d’environ 300 ch chacun, leur permettant d’atteindre une vitesse d’environ 80 km/h.
Le département Aviation
Dès 1913, après la perte des dirigeables L-1 et L-2, Ferdinand von Zeppelin doute sérieusement de la valeur des dirigeables et commence à s’intéresser aux avions. En 1914, ses doutes deviennent une conviction, et c’est seulement sous la pression des autorités militaires (réquisition des usines) que Luftschiffbau Zeppelin continue le développement des dirigeables. Sous la direction de l’ingénieur Claudius Dornier, le département aviation (Abteilung Flugzeug surnommé Abteilung Do) de la Luftschiffbau Zeppelin, construira entre 1914 et 1919 des hydravions dont le gigantisme n’a rien à envier aux dirigeables du même nom.
De la série SR-I, SR-II, SR-III et SR-IV, on retiendra particulièrement le SR-III, un hydravion de reconnaissance et de chasse aux sous-marins, de construction presque entièrement métallique (influencé par Junkers, à l’exception des ailes encore entoilées) dont les performances en 1917 étaient inégalées : charge utile d’environ. 2 000 kg, un poids total de 10 600 kg, une vitesse de 135 km/h avec une dizaine d’hommes d’équipage et une autonomie de 10-12 heures. Arrivé trop tard pour participer réellement au conflit, il échappe dans un premier temps aux destructions imposées par le traité de Versailles et est utilisé pour le déminage de la mer du Nord, tâche dans laquelle il se montrera d’une très grande fiabilité.
L’expérience acquise avec cet appareil servira ensuite à Dornier dans le développement d’une série d’hydravions (Wal, Do-24) qui connaîtra le succès jusqu’après la Deuxième Guerre mondiale, et dont certains volaient encore dans les années 1960.
Zeppelins dans la Première Guerre mondiale. Bombardiers et éclaireurs
Les Zeppelins sont utilisés comme bombardiers pendant la Première Guerre mondiale mais ne montrent pas une grande efficacité. Au début du conflit, le commandement allemand entretient de grands espoirs pour l’aéronef, car il semble avoir des avantages irrésistibles en comparaison avec les avions de l’époque : ils sont presque aussi rapides, transportent plus d’armement, ont une plus grande charge utile de bombes et un rayon d’action et une résistance très supérieurs. Ces avantages ne se traduisent pas dans les faits.
La première utilisation offensive de Zeppelins a lieu deux jours seulement après l’invasion de la Belgique, par un seul aéronef, le Z VI, qui est endommagé par des tirs et est forcé de faire un atterrissage près de Cologne. Deux autres sont abattus en août et un est capturé par les Français. Leur utilisation contre des cibles bien défendues pendant le jour est une erreur et le haut commandement perd toute confiance dans les capacités du Zeppelin, les transférant au service aérien de la marine pour d’autres missions.
La mission principale des aéronefs est la reconnaissance au-dessus de la mer du Nord et de la mer Baltique, son long rayon d’action permit aux bateaux de guerre d’intercepter de nombreux vaisseaux alliés. Pendant la totalité de la guerre, 1 200 sorties en éclaireur sont effectuées. Le service aérien de la marine dirige aussi un certain nombre de raids stratégiques contre la Grande-Bretagne, montrant la voie dans des opérations de bombardement et obligeant les Britanniques à mettre à niveau leurs défenses anti-aériennes. Les premiers raids sont approuvés par le Kaiser en janvier 1915. Les objectifs sont militaires mais les raids ayant lieu de nuit après que le couvre-feu est devenu obligatoire beaucoup de bombes tombent au hasard dans l’est de l’Angleterre.

Cratère d’une bombe de Zeppelin lâchée sur Paris
Le premier raid a lieu le 19 janvier 1915, c’est le premier bombardement aérien de civils. Deux Zeppelins lâchent 50 kg de bombes à forte explosion et des bombes incendiaires de 3 kg inefficaces sur King’s Lynn, Great Yarmouth et les villages avoisinants. Les défenses britanniques sont initialement divisées entre la Royal Navy et l’armée (cette dernière prend un contrôle total en février 1916) et plusieurs mitrailleuses de calibre 4 pouces (10 cm) sont converties en mitrailleuses anti-aériennes. Des projecteurs de recherche sont introduits, d’abord aux mains de policiers qui confondent des nuages avec des aéronefs en attaque. Les défenses aériennes contre les Zeppelins sont insuffisantes, souffrant surtout du manque d’appareils de visée. Les premiers succès obtenus contre les dirigeables le sont en les bombardant d’un avion. Le premier homme à abattre un zeppelin de cette manière est R. A. J. Warneford du RNAS, volant sur un Morane Parasol le 7 juin 1915. En jetant six bombes de 9 kg, il met le feu au LZ 37 au-dessus de Gand et est décoré de la Victoria Cross.
Les raids continuent en 1916 ; Londres est accidentellement bombardée en mai. En juillet, le Kaiser autorise les raids directement contre les centres urbains. Il y a vingt-trois raids de dirigeables, qui larguent un total de 125 tonnes de bombes, tuant 393 personnes et en blessant 691. Les défenses antiaériennes deviennent plus efficaces et de nouveaux Zeppelins sont introduits dont le plafond double de 1 800 m à 3 750 m. Pour éviter les projecteurs, ces aéronefs volent autant que possible au-dessus des nuages, descendant un observateur à travers la couche nuageuse pour diriger le bombardement. Cette sécurité accrue est contrebalancée par les contraintes supplémentaires sur l’équipage et l’introduction à mi-1916 des chasseurs tirant vers l’avant. Le premier Zeppelin abattu dans ces conditions l’est le 2 septembre 1916 par W. Leefe-Robinson.

L’introduction de chasseurs efficaces marque la fin de la menace Zeppelin. De nouveaux Zeppelins sont mis en service pouvant opérer à 5 500 m mais en les exposants à des conditions extrêmes de froid, et à des sautes de vent pouvant éparpiller de nombreux raids de Zeppelins. En 1917 et 1918, il n’y a que onze raids contre l’Angleterre, le dernier ayant lieu le 5 août 1918. Le capitaine de corvette Peter Strasser, commandant du département de l’aéronautique navale, meurt dans ce raid.
Un total de quatre-vingt huit Zeppelins sont construits pendant la guerre. Plus de soixante sont perdus, dont la moitié par accident et l’autre contre l’ennemi. Cinquante et un raids sont accomplis, lâchant près de 200 tonnes en 5 800 bombes, tuant 557 personnes et en blessant 1 358. Ona affirmé que les raids ont été plus efficaces que les dommages ne l’indiquent, en perturbant l’effort de guerre et en mobilisant douze escadrons de chasseurs et 10 000 hommes pour la défense anti-aérienne.
Progrès technique
À part les problèmes stratégiques, la technologie du Zeppelin est améliorée considérablement sous la pression de la demande pour les exigences militaires. Vers la fin de la guerre la société Zeppelin, essaime plusieurs annexes dans diverses parties de l’Allemagne avec des hangars plus près du front que Friedrichshafen, fournissant des aéronefs d’environ 200 m de longueur et plus et avec des volumes de 56 000 à 69 000 m3. Ces dirigeables peuvent transporter des charges de 40 à 50 tonnes et atteindre une vitesse de 100 à 130 km/h en utilisant cinq ou six moteurs Maybach d’environ 260 ch chacun.
En fuyant les tirs ennemis, les Zeppelins atteignent des altitudes de 7 600 m et sont aussi capables de vols au long cours. Par exemple, le LZ 104, L 59, basés à Jamboli/Yambol en Bulgarie, envoyés pour renforcer les troupes en Afrique de l’Est allemande (l’actuelle Tanzanie) en novembre 1917. L’aéronef n’arrive pas à temps et doit retourné en apprenant la défaite allemande face aux troupes britanniques, mais il a parcouru 6 757 km en 95 heures et donc battu le record de la plus longue distance.
La fin de l’utilisation militaire des Zeppelins
La défaite allemande dans la guerre marque aussi la fin des dirigeables militaires allemands, car les Alliés victorieux exigent un désarmement complet des forces aériennes allemandes et la livraison de tous les aéronefs au titre des réparations de guerre. Le traité de Versailles comporte des articles traitant explicitement des dirigeables :
Article 198. Les forces Armées de l’Allemagne ne doivent pas inclure des forces aériennes militaires ou navales. Aucun dirigeable ne doit être conservé. Article 202. Lors de l’application du présent traité, tous les matériels aéronautiques militaires et navals doivent être livrés aux gouvernements des principaux alliés et pouvoirs associés, en particulier, ce matériel inclura tous les objets sous les titres suivants qui sont ou ont été utilisés ou conçus pour des fins militaires: Dirigeables capables de décoller, étant fabriqués, réparés ou assemblés.
Usines pour la fabrication de l’hydrogène. Hangars et abris pour n’importe quel aéronef
En attendant leur livraison, les dirigeables seront, aux frais de l’Allemagne, maintenus gonflés avec de l’hydrogène ; l’usine pour la fabrication de l’hydrogène, aussi bien que les abris pour dirigeables pourront, à la discrétion desdits pouvoirs, être laissés à l’Allemagne jusqu’au moment où les dirigeables seront transférés.
Le 23 juin 1919, une semaine avant que le traité ne soit signé, plusieurs équipages de Zeppelin détruisent leurs aéronefs dans leurs hangars pour éviter qu’ils soient livrés aux Alliés, suivant en cela l’exemple de la flotte allemande qui s’est sabordée deux jours auparavant à Scapa Flow. Les dirigeables restants sont transférés à la France, à l’Italie, au Royaume-Uni et à la Belgique en 1920. La France utilisera le LZ-114, rebaptisé Dixmude, jusqu’en 1923 où il disparaîtra en Méditerranée. 115 Zeppelins furent utilisés durant la Grande Guerre. Voici leur destin :
FIN DE CARRIÈRE NOMBRES
Posés en territoire ennemi 7
Détruits en vol 17
Détruits accidentellement 19
Détruits à l’atterrissage 26
Détruits en hangar 8
Endommagés 7
Transférés aux Alliés 9
Détruits par l’Allemagne 22
Après la Première Guerre mondiale. Les débuts d’une renaissance
Construction de l’USS Los Angeles en 1932.
Le comte von Zeppelin meurt en 1917 et Eckener lui succède à la tête de l’entreprise. Alors que le traité de Versailles a éliminé son seul concurrent national sérieux, la Schütte-Lanz qui n’opérait que pour les dirigeables militaires, la société Zeppelin connaît des difficultés considérables pour fabriquer deux petits Zeppelins : LZ 120(Bodensee) qui vole pour la première fois en août 1919 et, dans les deux années suivantes transporte quelque 4 000 passagers ; et LZ 121 (Nordstern) qui est prévu pour une liaison régulière vers Stockholm.
Cependant, en 1921, les Alliés demandent que ces deux Zeppelins soient livrés dans le cadre des réparations de guerre, et comme compensation pour les dirigeables détruits par leurs équipages. D’autres projets ne peuvent pas être réalisés à cause de l’interdiction alliée. Cela met provisoirement un terme à la production de Zeppelin.
Eckener et ses employés refusent cependant de renoncer et continuent à chercher des investisseurs et une façon de contourner les restrictions des Alliés. L’opportunité se présente en 1924. Les États-Unis d’Amérique ont commencé à expérimenter les aéronefs rigides, en construisant un, le ZR I’ (USS Shenandoah) et passant un ordre d’achat en Angleterre. Cependant le R 38 anglais, prévu pour devenir le ZR II, ne réalise que des performances décevantes. Bien qu’il ait traversé l’Atlantique avec succès, il est trop lent, et sa structure ne parvient pas à tenir une révision avec des moteurs plus puissants.
Dans ces circonstances, Eckener parvient à obtenir une commande pour les dirigeables américains suivants. Bien sûr, l’Allemagne doit payer les coûts pour l’aéronef lui-même, comme ils sont calculés en compensation des réparations de guerre mais pour la société Zeppelin, c’est secondaire. Aussi l’ingénieur Dr. Dürr conçoit-il le LZ 126, et utilisant toute l’expertise accumulée pendant des années, la société finalement achève le meilleur Zeppelin à la date prévue, lequel décolle pour son premier vol d’essai le 27 août 1924.
Aucune société d’assurance n’accepte d’émettre une police pour la livraison à Lakehurst, laquelle implique bien sûr un vol transatlantique. Eckener cependant est si confiant dans le nouvel aéronef qu’il est prêt à risquer la totalité du capital de l’entreprise et, le, 12 octobre au matin, le vol débute avec lui comme capitaine. Sa foi n’est pas déçue et il ne connaît aucune difficulté au cours du voyage de 8 050 km, accompli en 81 heures et deux minutes. Les foules yankees célèbrent avec enthousiasme son arrivée tandis que le président Calvin Coolidge invite l’équipage et appelle le nouvel appareil un ange de paix.
Sous son nouveau nom ZR III (USS Los Angeles), il devient le dirigeable américain le plus prospère. Il opère de manière fiable pendant huit années jusqu’à son retrait en 1932 pour des raisons économiques et est démonté en août 1940.
L’âge d’or de l’aviation en Zeppelin
Bien que la société ait retrouvé son rôle de meneur dans la construction d’aéronefs rigides, elle n’est pas encore complètement consolidée. Obtenir les fonds nécessaires pour le prochain projet est un travail difficile dans la situation économique de l’après-guerre en Allemagne, et Eckener à besoin de deux ans d’action d’influence politique et de travaux pour le secteur public pour obtenir la fabrication du LZ 127.

Un hangar à Zeppelin à Rio de Janeiro.
Deux autres années plus tard, le 18 septembre 1928, le nouveau dirigeable qui a été nommé Graf Zeppelin en honneur du comte, vole pour la première fois. Avec une longueur totale de 236,6 m et un volume de 105 000 m3, il devient alors le plus grand dirigeable.
Le concept initial d’Eckener consiste à utiliser LZ 127 (Graf Zeppelin) à des fins d’expérimentation et de démonstration pour préparer la voie pour des voyages commerciaux réguliers, en transportant des passagers et du courrier. En octobre 1928, le premier voyage au long cours conduit l’aéronef à Lakehurst, où Eckener et son équipage sont accueillis avec une parade à New York. Ensuite Graf Zeppelin fait le tour de l’Allemagne et visite l’Italie, la Palestine et l’Espagne. Une seconde expédition aux États-Unis avorte en France en mai 1929 suite à une succession de pannes moteur (un puis deux puis trois).
En août 1929, le LZ 127 prend le départ d’un autre exploit : la circumnavigation complète du globe. La popularité croissante du « géant des airs » facilite la découverte de commanditaires (sponsors). L’un d’eux est le magnat de la presse américaine William Randolph Hearst, qui demande que le tour débute officiellement à Lakehurst. De là, Graf Zeppelin vole vers Friedrichshafen d’abord, continuant vers Tokyo, Los Angeles et retour à Lakehurst. Le voyage dure 21 jours, 5 heures et 31 minutes. En incluant le déplacement avant et après entre Lakehurst et le point d’origine, le dirigeable avait voyagé sur 49 618 km.
L’année suivante, Graf Zeppelin entreprend plusieurs trajets en Europe, puis, après un déplacement en Amérique du Sud en mai 1930, il est décidé d’ouvrir la première ligne transatlantique régulière. Malgré le début de la grande dépression et une compétition grandissante avec les avions, LZ 127 transporte un nombre croissant de passagers et courrier au-dessus de l’océan chaque année jusqu’en 1936. De plus, l’aéronef assure, en juillet 1931, un voyage scientifique en Arctique ; cela était un rêve du comte vingt ans auparavant, mais qui n’avait pu être réalisé avec le déclenchement de la guerre.
Eckener veut ajouter au succès de cet aéronef un autre similaire prévu comme LZ 128. Cependant l’accident catastrophique du dirigeable britannique R 101 en 1931 mène la société Zeppelin à mettre en question la sécurité des vaisseaux remplis d’hydrogène, et ce choix est abandonné en faveur d’un nouveau projet. LZ 129 sera le dernier dirigeable rempli de dihydrogène, ce qui sera à l’origine de son incendie à Lakehurst le 6 mai 1937.
Le crépuscule
Cependant, à partir de 1933, l’installation de la dictature nazie sur l’Allemagne commence à assombrir les affaires de la société. Les Nazis ne sont pas intéressés par l’idéal d’Eckener de joindre pacifiquement les gens ; sachant très bien que les dirigeables seraient inutilisables dans une guerre, ils préfèrent développer la technologie des avions.
D’un autre côté, ils sont impatients d’exploiter la popularité des aéronefs pour leur propagande. Comme Eckener refuse de coopérer, Hermann Göring obtient le monopole. Les zeppelins doivent désormais afficher de manière très visible le swastika nazi sur leurs ailerons et quelquefois faire le tour de l’Allemagne pour endoctriner le peuple avec largages de tracts, musiques de marches et discours tonitruants depuis le ciel.
Le 4 mars 1936 LZ 129 (Hindenburg), nommé d’après le président de l’Allemagne Paul von Hindenburg, fait son premier voyage. Cependant avec la nouvelle situation politique Eckener n’a pas obtenu l’hélium pour le gonfler. Seuls les États-Unis possèdent le gaz rare en assez grande quantité et ils ont imposé un embargo militaire. Par conséquent, le Hindenburg est rempli d’hydrogène inflammable comme ses prédécesseurs. À part des missions de propagande, le LZ 129 débute sur les lignes transatlantiques avec le Graf Zeppelin.
Le 6 mai 1937 alors qu’il atterrit à Lakehurst, l’arrière de l’aéronef qui est proche d’un pylône d’attache prend feu, et en quelques secondes le zeppelin s’embrase. Les causes de la catastrophe du Hindenburg restent inconnues ; cependant des spéculations de sabotage sont nombreuses (impliquant aussi bien les nazis que leurs ennemis), l’opinion majoritaire tend à supporter la théorie d’un accident, où le nouveau revêtement du dirigeable aurait joué un rôle-clé. 35 des 97 personnes présentes à bord périrent, plus une personne au sol.
Quelle qu’en soit la cause, l’incendie met fin à ce type de transport pour longtemps. La confiance du public dans la sécurité des dirigeables est ébranlée, et faire voler des passagers dans des vaisseaux remplis d’hydrogène devient impensable. Le LZ 127 (Graf Zeppelin) est retiré du service deux jours plus tard et effectue un dernier vol non commercial le 18 juin 1937 et devient un musée. Eckener continue à essayer d’obtenir de l’hélium pour l’aéronef similaire LZ 130 Graf Zeppelin II, mais en vain. Le nouveau vaisseau amiral est terminé en 1938 et, rempli à nouveau d’hydrogène, fait quelques vols d’essai (le premier le 14 septembre), mais il ne transporte jamais de passager. Un autre projet LZ 131, qui est destiné à être encore plus grand ne progresse jamais au-delà de quelques anneaux de squelette.
La fin définitive vient avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En mars 1940, Göring ordonne la destruction des vaisseaux restants, et les morceaux d’aluminium vont dans l’industrie militaire.
Autres dirigeables comparables
Les aéronefs utilisant les méthodes de construction des zeppelins sont quelquefois référencés comme zeppelins même s’ils ne furent pas construits par la société. Plusieurs dirigeables de ce genre furent construits aux États-Unis, au Royaume Uni, en Italie et en Union Soviétique dans les années 1920 et 1930, la plupart s’inspirant de zeppelins capturés ou accidentés.
Le premier dirigeable construit par les Américains est l’USS Shenandoah (fille des étoiles), avec ZR étant pour (Zeppelin Rigid) qui vole en 1923. Le vaisseau est baptisé le 20 août à Lakehurst et est le premier à utiliser de l’hélium. Il est testé en vol le 3 septembre. Il peut transporter une grande quantité de carburant pour faire 8 000 km à la vitesse moyenne de 90 km/h. L’hélium est si rare à ce moment que le Shenandoah contient presque toute la réserve mondiale. Aussi quand le Los Angeles est livrée, il est au départ rempli avec l’hélium du ZR I. Plus tard, une série de crashes avec des morts met fin à la construction aux États-Unis des Zeppelins.
Développements récents
Économiquement il est assez surprenant, même dans les années 1930, que les zeppelins puissent être en compétition avec les autres moyens de traverser l’Atlantique. Leur avantage est de transporter nettement plus de passagers que les avions de l’époque, tout en fournissant l’agrément comparable au luxe des voyages en paquebots. Moins important, la technologie est potentiellement plus efficace pour la consommation que les avions (plus lourds que l’air). D’un autre côté, son utilisation est très exigeante en particulier en personnel. Souvent l’équipage est plus nombreux que les passagers à bord, et des équipes importantes sont nécessaires pour aider au décollage et à l’atterrissage. Et, pour abriter des Zeppelins comme le Hindenburg, de grands hangars sont nécessaires.
De nos jours avec des avions grands, rapides et efficaces il est, c’est le moins que l’on puisse dire, difficile de justifier que d’énormes aéronefs puissent opérer à nouveau avec profit dans les transports réguliers de passagers, même si l’idée d’une croisière relativement lente et majestueuse à relativement basse altitude a certainement gardé un certain cachet. Il y eut des niches pour les aéronefs pendant et après la Seconde Guerre mondiale, comme des observations de longue durée et de la publicité ; ceci n’a cependant généralement besoin que d’aéronefs petits et adaptables, et avec l’avantage principal du design à la Zeppelin de construire des vaisseaux très grands capables de soulever des charges très lourdes, ces fonctions étant généralement bien mieux remplies avec les moins coûteux.
Il a été suggéré périodiquement que le concept du zeppelin aurait pu être intéressant pour le transport des marchandises, en particulier pour la livraison des charges lourdes avec de mauvaises infrastructures. L’une des plus récentes entreprises du genre fut le projet Cargolifter, avec un design hybride (donc pas entièrement zeppelin), même plus grand que le Hindenburg. Vers 2000, cet essai était devenu assez consistant, avec un hangar énorme érigé en Briesen-Brand, quelque 60 km au sud de Berlin. Cependant en mai 2002 le projet ambitieux manqua de trésorerie et la société dût demander la liquidation.
Dans les années 1990, le successeur de la société d’origine à Friedrichshafen, la Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, avait recommencé la construction d’aéronefs avec des objectifs plus raisonnables. Le premier aéronef expérimental nommé Friedrichshafen du type Zeppelin NT vola en septembre 1997. Bien que plus grand que les blimps ordinaires, les New Technology, Zeppelins sont beaucoup plus petits que leurs ancêtres géants et ne sont pas du type zeppelin dans le sens classique, mais seulement des aéronefs hybrides semi-rigides de haute technologie. En plus de leur charge utile plus importante, leurs avantages principaux comparés aux blimps sont une vitesse plus grande et une manœuvrabilité excellente. Le Zeppelin NT est fabriqué en série et exploité avec profit pour des promenades ludiques, des vols de recherche et des applications similaires. Fin octobre 2004, un NT qui doit être livré au Japon a atteint 111,8 km/h.
En août 2005 un troisième Zeppelin NT a été fabriqué et expédié en Afrique du Sud pour une nouvelle tâche de deux ans pour la compagnie De Beers. Après avoir volé de Friedrichshafen à Amsterdam, il a été transporté par ferry de la même manière que le Zeppelin Yokoso Japon qui lui avait été expédié au Japon entre décembre 2004 et janvier 2005. La tâche principale du Zeppelin était l’exploration de nouvelles réserves de diamant en Afrique du Sud. Le Zeppelin NT devait fournir une plate-forme unique pour ces explorations fournissant une amélioration comparée aux systèmes courants. Mais des vents violents l’ont détaché de ses amarrages près de la mine de Jwaneng, aucune réparation ne fut envisageable après cet accident survenu le 22 septembre 2007. Le 26 juin 2008 le quatrième dirigeable de NT de Zeppelin a reçu l’autorisation de FAA (Federal Aviation Administration).
Courrier
L’histoire des Zeppelins est d’un intérêt spécial pour les collectionneurs de timbres. De 1909 jusqu’en 1939, les zeppelins transportèrent du courrier pendant leurs vols transatlantiques, incluant des couvertures (enveloppes avec timbres attachés et annulés) préparées par et pour les collectionneurs. De nombreuses nations émirent des timbres zeppelin à grand prix dans l’intention du passage par le courrier du zeppelin. Parmi les plus rares de ces couvertures zeppelin sont celles transportées pendant le vol fatal du Hindenburg ; celles qui survécurent furent brûlées le long des marges, et d’un prix atteignant plusieurs milliers de dollars.
L'HISTOIRE DE L'AVIATION
L’époque des précurseurs : c’est la période qui se termine au début du XXe siècle et au cours de laquelle des hommes imaginent de manière plus ou moins réaliste ce que pourrait être une machine volante. À partir de la fin du XVIIIe siècle, cette période voit le début de la conquête de l’air avec le développement de l’aérostation et de nombreuses tentatives de vol plané. Les pionniers du plus lourd que l’air : c’est la période des premiers vols d’engins à moteur capables de décoller par leurs propres moyens. Presque chaque vol est une première ou une tentative de record : un peu plus loin, plus vite, plus haut etc. Les aviateurs sont, le plus souvent, des concepteurs et des aventuriers.
L'HISTOIRE DE L'AVIATION
La légende du vol d’Icare, révèle que le désir de voler existait depuis longtemps.
La Première Guerre mondiale : quelques années seulement après le premier vol, cette période voit l’apparition d’une nouvelle arme sur le champ de bataille. On passe brutalement à une production en grande série, certains modèles d’avions étant même construits à plus d’un millier d’exemplaires ; les pilotes deviennent des professionnels, même si le parfum d’aventure n’a pas totalement disparu.
L’entre-deux-guerres : la fin de la Première Guerre mondiale met sur le marché un surplus de pilotes et d’appareils qui permettent le lancement du transport aérien commercial et, en premier lieu, celui du courrier. L’aviation se développe et l’on assiste à la création d’une armée de l’air dans nombre de pays. L’aviation militaire pousse les constructeurs à battre de nouveaux records. Les progrès de l’aviation civile sont une retombée des études militaires.
La Seconde guerre mondiale : l’aviation est largement utilisée sur le champ de bataille. On peut considérer cette période comme l’apogée des avions utilisant un moteur à piston et une hélice comme moyen de propulsion. La fin de la guerre voit la naissance du moteur à réaction et du radar.
La seconde moitié du XXe siècle : une fois encore, la fin de la guerre met sur le marché un surplus d’appareils et de pilotes. C’est le début du transport aérien commercial régulier tout temps capable de s’affranchir des conditions météorologiques et de pratiquer le vol sans visibilité. L’aéronautique militaire pousse au développement du réacteur et part à la conquête du vol supersonique. Les retombées civiles permettent le développement des premiers avions de ligne quadriréacteurs et le transport aérien s’ouvre à tous, au moins dans les pays développés.
Le début du XXIe siècle : c’est le domaine de l’actualité. Le transport aérien commercial s’est tellement développé que certaines zones sont saturées, le développement étant moins lié aux avions eux-mêmes qu’aux progrès en matière de gestion du trafic et des moyens de navigation. Sur le plan militaire, l’avion n’est qu’une des composantes des systèmes d’armes et le rôle du pilote tend à se réduire au profit des systèmes automatiques. Le drone remplacera-t-il un jour l’avion ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer mais le pilote militaire, rôle encore emprunt de prestige, est bien loin du « chevalier du ciel » de la Première Guerre mondiale.
Les précurseurs
Le vol pour l’homme est un vieux rêve, la légende d’Icare le confirme. S’il est attribué à Archytas de Tarente l’invention d’une colombe en bois capable de voler et si Léonard de Vinci, vers 1500, a étudié scientifiquement la possibilité de faire voler un plus lourd que l’air, ce n’est que bien longtemps après, presque quatre siècles plus tard, que les choses vont se concrétiser.
En 1783, les frères Montgolfier ont permis à l’homme de s’élever dans les airs, à bord de (plus légers que l’air) grâce au ballon à air chaud. La même année, Jacques Charles fait voler un ballon à hydrogène.
Le britannique George Cayley (1773-1857), est le véritable précurseur de l’aviation, en comprenant que le poids et la traînée sont les deux forces qu’il faut vaincre. Il comprend également qu’il est inutile de reproduire le vol battu des oiseaux et que les ailes doivent être fixes, mais aussi il prévoit la nécessité d’un empennage pour stabiliser le vol. Il a ainsi établi la forme de base de l’avion. S’inspirant des travaux des Français Launoy, il construit un hélicoptère en 1796. En 1808, il construit un (ornithoptère) à l’échelle humaine et, en 1809, un planeur qui volera sans passager.
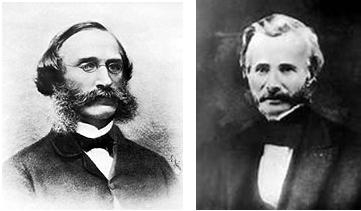
William Samuel Henson 1812-1888, John Stringfellow 1799-1883
William Henson et John Stringfellow, reprenant les travaux de Cayley, firent voler un modèle réduit d’aéroplane à vapeur. Néanmoins, les moteurs puissants pour les appareils à taille réelle étaient beaucoup trop lourds pour leur permettre de décoller. Les progrès vont donc d’abord passer par les planeurs et par l’étude de l’aérodynamisme.
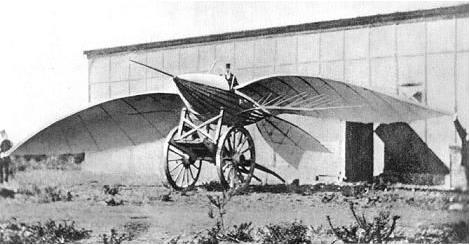
Le Bris et son Albatros, photographié par Pépin fils, photographe Brestois, 1868
Entre 1857 et 1868, le Français Jean-Marie Le Bris essaie successivement deux planeurs de son invention, d’abord depuis les collines de la baie de Douarnenez (Finistère), puis sur la hauteur du Polygone de la Marine, près de Brest (Finistère), reprenant ainsi en France les travaux des pionniers britanniques de la décennie précédente. En 1863, le mot (aviation) est inventé par Gabriel de La Landelle. Et le Britannique Francis Herbert Wenham, en 1871, construit le premier tunnel, ancêtre de la soufflerie qui va permettre d’expérimenter des maquettes. Le français Louis Mouillard s’inspire de l’aile d’oiseau pour concevoir des planeurs dont la voilure est courbée. Il propose le gauchissement des ailes.
Les choses s’accélèrent. Entre 1857 et 1877, les Français Félix et Louis du Temple essaient des modèles réduits à moteur à ressort, en les aidant d’un plan incliné, puis peut-être un engin, muni d’un moteur à vapeur, monté par un matelot. Les essais de planeurs se succèdent, et s’y prêtent tour à tour l’Allemand Otto Lilienthal, le Britannique Percy Pilcher, les Américains John Joseph Montgomery et Maloney, et les Français Ferdinand Ferber, Maurice Colliex ainsi que les frères Voisin et leurs avions.
Pionniers du (plus lourd que l’air)
Le premier homme ayant volé en contrôlant la trajectoire de sa machine est Otto Lilienthal, qui a effectué entre 1891 et 1896 deux mille vols planés depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. Les premiers vols sur une machine pilotée par gouvernes agissant sur les trois axes (tangage, roulis, lacet) ont été réalisés par les frères Wright sur leur planeur en 1902.
Premier décollage motorisé
Le premier homme ayant déclaré avoir volé à l’aide d’un moteur est le français Clément Ader, aux commandes de son Avion. La réalité de ces vols est discutée, à cause du manque de témoins et par l’absence de contrôle de ses engins. La première tentative a lieu en 1890 aux commandes de l’Éole; les marques laissées par les roues dans le sol meuble auraient présenté un endroit où elles étaient moins marquées et auraient totalement disparu sur une vingtaine ou une cinquantaine de mètres. Son engin volant aurait ainsi effectué un bond ; il n’y avait pas de témoins autres que des employés d’Ader. La même machine, essayée devant des témoins officiels en 1891, ne donne pas d’autres résultats.
Les essais suivants d’Ader furent effectués au camp militaire de Satory, où avait été établie une aire circulaire de 450 mètres de diamètre pour effectuer une démonstration officielle. Le 12 octobre 1897, Ader effectua un premier tour sur ce circuit à bord de son Avion III. Il sentit à plusieurs reprises l’appareil quitter le sol, puis reprendre contact. Deux jours plus tard, alors que le vent est fort, Clément Ader lance sa machine devant deux officiels du ministère de la Guerre qui déclarent : Il fut cependant facile de constater, d’après le sillage des roues, que l’appareil avait été fréquemment soulevé de l’arrière et que la roue arrière formant le gouvernail n’avait pas porté constamment sur le sol. Les deux membres de la commission le virent sortir brusquement de la piste, décrire une demi-conversion, s’incliner sur le côté et enfin rester immobile (il semble que, les roues n’ayant plus assez d’adhérence du fait de la sustentation, le pilote ait perdu le contrôle directionnel de sa machine, qui est alors sortie de la piste puis s’est renversée sous l’effet du vent). À la question l’appareil a -t-il tendance à se soulever quand il est lancé à une certaine vitesse ? La réponse est la démonstration n’a pas été faite dans les deux expériences qui ont été effectuées sur le terrain. Devant cet échec, le ministère de la Guerre coupe les crédits à Ader. On peut conclure que, ce 14 octobre 1897, le Français Clément Ader aurait peut être effectué le premier décollage motorisé – mais non contrôlé – d’un plus lourd que l’air.
Premier vol motorisé contrôlé
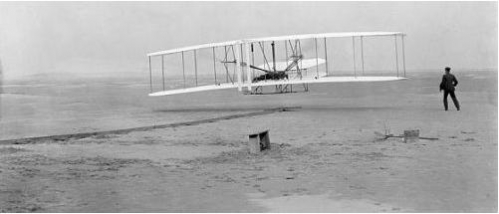
Premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 sur le Flyer.
Premiers vols motorisés contrôlés autonomes
Traian Vuia vola à Montesson le 18 mars 1906 avec un appareil plus lourd que l’air autopropulsé (sans mécanisme de lancement) sur une distance d’environ 12 mètres à une altitude d’un mètre. Ce vol se terminant par un accident, Vuia reprit ses essais à partir de mois de juillet après avoir réparé et modifié son appareil. Le 19 août 1906 il vola sur une distance de 25 mètres à une altitude de 2,5 mètres à Issy-les-Moulineaux.
Le Brésilien Alberto Santos-Dumont vola à Bagatelle le 23 octobre 1906 sur soixante mètres à une altitude de deux à trois mètres. Grâce à ce vol à bord du 14 Bis, il remporta devant un large public le prix Archdeacon décerné par Aéro-Club de France pour le vol d’un plus lourd que l’air autopropulsé (sans mécanisme de lancement). Ses détracteurs entre autres les partisans des frères Wright lui reprochent de ne pouvoir voler qu’en effet de sol, alors que le Flyer III pouvait déjà prendre de l’altitude lorsqu’il vola sur 39,5 kilomètres le 5 octobre 1905.
Les premiers jours
Aussi longtemps que l’homme a rêvé de voler, des prophètes, bons et mauvais, se sont exprimés sur ce sujet. D’une part il y avait des hommes tels que William Cowper (1731-1800) qui écrivit : Je condamnerai à mort un homme qui serait coupable de voler. Les historiens chargeraient ma mémoire de reproches accablants, mais, en même temps, le monde irait tranquillement et, s’il jouissait de moins de liberté, il serait quand même plus sûr.
Planeur conçu par George Cayley: les bases de la structure de l’avion sont jetées
D’autre part il y avait des esprits pratiques et visionnaires à la fois. Parmi eux, Sir George Cayley (1773-1857), le pionnier du vol, et le poète Alfred-Lord Tennyson (1809-1892). En 1816, Cayley écrivait : Un océan navigable ininterrompu, qui vient jusqu’au seuil de la porte de tout homme, ne doit pas être négligé en tant que source de satisfaction et d’avantages humains. Tennyson, bien qu’il ait craint que le voyage aérien ne devienne inévitable, était dans l’ensemble optimiste.
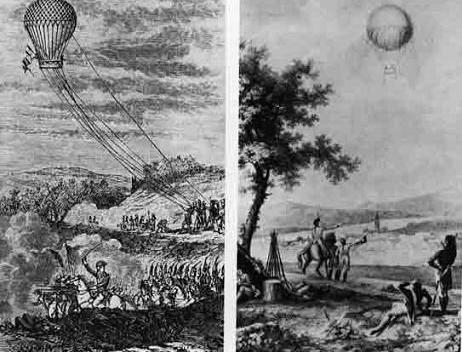
Ballons militaires en poste d’observation à la bataille de Fleurus. Au siège de Mayence en 1794.
Les avertissements et exhortations de tels hommes furent, malgré tout, de peu de poids, jusqu’à ce que des machines volantes fussent inventées. Beaucoup de tentatives avaient été faites pour produire un appareil volant depuis l’époque de Léonard de Vinci (1452-1519) et même un peu avant lui, les unes risibles dans leur simplicité, d’autres louables pour le courage qu’elles demandaient à leurs auteurs. Toutes échouèrent sur un obstacle particulier : jusqu’à la fin du XIXe siècle, il n’y avait aucune source d’énergie capable de réaliser l’aéroplane. Mais certains, comme Cayley mentionné plus haut avaient étudié les problèmes théoriques du vol et produits des machines volantes qui auraient pu voler s’il avait existé un moteur. Ce qui ne devait pas être avant l’invention, en 1885, des premiers moteurs à essence construits par Karl Benz et, d’autre part, Gottlieb Daimler.
Jusque-là, les seules machines aériennes qui aient volé étaient des ballons. Le premier ballon efficace fut inventé par les frères Montgolfier, en France, en 1783. Son essor était dû à la force ascensionnelle de l’air chaud produit par un feu allumé sous le ballon.
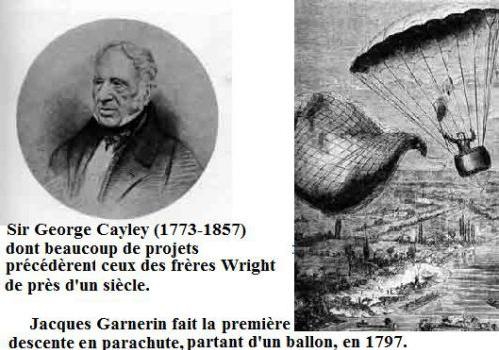
Les chefs de la Révolution française, qui commença en 1789, étaient évidemment intéressés par toute invention qui pouvait favoriser leur cause. Ils fondèrent dans les premières années de la révolution une école militaire d’aérostation. Cette institution eut l’honneur de fournir au monde ses premiers aérostiers militaires, dont les observations faites d’un ballon, à la bataille de Fleurus en 1794, assurèrent une victoire française. Malgré cela, Napoléon Bonaparte ne fut pas impressionné par les possibilités du ballon comme arme militaire. Il ferma récole d’aérostation.
Désormais, le ballon, véhicule militaire, déclina pendant une cinquantaine d’années. II y eut des tentatives occasionnelles pour ranimer l’intérêt à son sujet, mais il ne fut plus utilisé avant 1849, quand les Autrichiens tentèrent vainement de lancer, portées par des ballons sans équipage, des bombes sur la cité de Venise assiégée. Après une nouvelle pose, les Français se tournèrent vers l’utilisation du ballon. En 1870, Paris étant assiégé par les Prussiens, plusieurs personnalités françaises et une quantité considérable de courrier sortirent de la ville en ballon.
L’intérêt pour le ballon militaire gagna aussi d’autres pays. Pendant la guerre civile américaine de 1861-1865, des ballons furent quelquefois utilisés par chacun des partis pour obtenir des renseignements sur les mouvements militaires de l’autre. Mais c’est surtout le parti des Unionistes, avec sa plus grande capacité industrielle et ses facultés inventives, qui en tirèrent profit.
En 1892, le corps des transmissions des États-Unis créa une école d’aérostation; puis des tentatives d’observations en ballon furent faites pendant la guerre hispano-américaine, à San Juan Hill, en 1898. A cette époque, les Britanniques, éperonnés par le colonel Robert Baden Powell, formèrent des compagnies d’aérostiers dans le génie.
Le perfectionnement des machines (1906-1914)

Meeting d’aviation, Indianapolis, 1910.
En 1905, Robert Esnault-Pelterie invente l’aileron en modifiant un avion de sa construction conçu d’après le Flyer des frères Wright. En 1906, il invente le moteur en étoile. En décembre, il dépose le brevet du manche à balai. Le 3 juillet 1909, au Champ d’aviation de la Brayelle près de Douai est organisé le premier meeting aérien au monde, Louis Blériot avec son monoplan vole 47 km en 1 h 7, Louis Paulhan avec son biplan, bat le record de hauteur avec 150 mètres.
Du 22 au 29 août 1909, fut organisé le premier meeting international d’aviation de l’histoire : la prestigieuse Grande semaine d’aviation de la Champagne de Reims qui se déroula très exactement sur la commune de Bétheny, à l’emplacement de l’actuelle Base aérienne 112 Reims-Champagne à laquelle participèrent tous les grands pilotes de l’époque : Louis Blériot, Henri Farman, René Moineau, Louis Paulhan, Hubert Latham, Glenn Curtis. Près d’un million de spectateurs y assistèrent. Du 1er au 30 novembre 1909, fut construite à Pau la première école d’aviation au monde, dont la direction est confiée par Louis Blériot à Henri Sallenave.
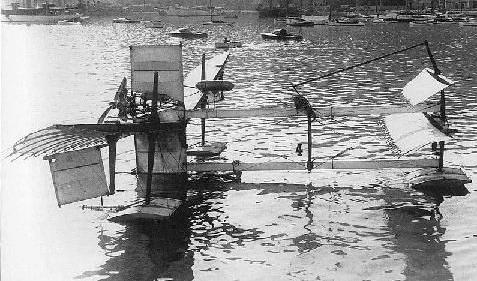
Le premier hydravion, le Canard, en 1911
Le premier vol autonome d’un hydravion fut réalisé par Henri Fabre, qui décolla le 28 mars 1910 de l’étang de Berre, à Martigues, en France, avec son hydro-aéroplane Canard. L’exploit fut constaté par huissier. En 1913, Adolphe Pégoud effectue le, premier looping.
Aviation durant la Première Guerre mondiale
Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, les tensions grandissantes en Europe incitent les gouvernements à s’intéresser à l’aviation en tant qu’arme de guerre. D’où l’organisation par la France du fameux concours d’aéroplanes militaires de Reims (octobre et novembre 1911), premier concours de ce type de l’histoire mondiale de l’aviation. Les différents constructeurs, français et britanniques notamment, se livrent à une course contre la montre pour tenter d’obtenir des commandes à l’export.
Léopold Trescartes, titulaire du brevet civil de l’Aéroclub de France n° 842 délivré le 16 avril 1912, effectue le 7 septembre 1912 le premier vol au-dessus de Porto (Portugal) à bord d’un biplan fabriqué par Maurice Farman. Cet avion, officiellement acheté par un journal de Porto et dont les exhibitions servent, pour le grand public, à financer la construction d’une crèche, est en réalité un modèle destiné à convaincre le gouvernement portugais d’acheter des avions français dans le cadre de la création d’une force aérienne. Après de nombreuses démonstrations, en présence notamment du ministre de la guerre portugais, le choix des autorités portugaises se portera finalement sur un appareil britannique de marque Avro.
Avions et pilotes pionniers (volontaires détachés d’autres unités qui gardaient leur uniforme d’origine, surtout recrutés dans la cavalerie) sont réquisitionnés pour des missions de reconnaissance. Cibles des deux camps au sol, ils sont décimés. Les grandes nations se dotent très vite d’une aviation militaire où les avions se spécialisent : reconnaissance, chasseurs, bombardiers.
Une course aux records est engagée pour prendre l’avantage sur l’ennemi, l’armement étant amélioré avec l’apparition des premières mitrailleuses synchronisées. Le parachute fait son apparition, mais est seulement utilisé par les pilotes de dirigeables, les avions volant trop bas pour qu’il soit efficace. Au sol, on construit des aérodromes, et l’avion est fabriqué en série.
Le 5 octobre 1914, tout près de Reims, se déroule au-dessus du point de jonction des communes de Jonchery-sur-Vesle, de Prouilly et de Muizon, le premier combat aérien de l’histoire mondiale de l’aviation militaire, avec un avion abattu. Remporté par le pilote Joseph Frantz et le mecanicien Louis Quenault de l’escadrille V 24 sur Voisin, contre l’Oberleutnant Fritz von Zagen sur un Aviatik allemand. À la suite, les duels aériens se multiplient. Si les premiers combats sont très rares et dangereux (fusils embarqués, qui nécessitent une dextérité extrême), le développement des mitrailleuses synchronisées (invention de l’aviateur français Roland Garros) accélèrent le nombre de batailles. Contrairement à l’horreur des tranchées (boue, bombardements constants ) la guerre aérienne est vue comme une guerre propre (si tant est que cela soit possible) Dans les représentations des pilotes comme des civils et de l’infanterie, qui suivent avec assiduité la guerre du ciel, l’aviation possède un côté noble, chevaleresque (Guynemer refusera d’abattre Ernst Udet car sa mitrailleuse s’était enrayée). Il y a une grande compétition entre les (As) tant au sein d’un camp qu’entre ennemis.
Les grandes figures de cette époque sont le français Guynemer et l’allemand surnommé Le Baron Rouge (et son cirque aérien), ou Ernst Udet
À la fin de la guerre, il y a :
4 500 avions français ;
3 500 avions britanniques ;
2 500 avions allemands.
Marie Marvingt invente en 1914 l’aviation sanitaire.
L’entre-deux-guerre (1918-1939)
L’aviation doit trouver d’autres voies que l’utilisation militaire. De nombreux pilotes se tournent vers les exhibitions, l’acrobatie, les tentatives de records. Les constructeurs cherchent à trouver de nouvelles exploitations commerciales : premières lignes de passagers, transport du courrier, comme en France les usines Latécoère qui créent un service postal en direction du Sénégal, via l’Espagne et le Maroc, utilisant d’abord les anciens appareils militaires, puis les nouveaux modèles construits par l’entreprise.
Les premières grandes traversées
Henri Farman, parcourant le 30 octobre 1908 les vingt-sept kilomètres qui séparent le petit village marnais de Bouy de la ville Reims, effectue à bord d’un aéroplane Voisin le premier voyage aérien de l’histoire de l’aviation.
En 1909, le 25 juillet, Louis Blériot à bord de son Blériot XI traverse la Manche en 37 minutes.
En 1913, le 23 septembre, Roland Garros traverse la Méditerranée en 7 heures et 53 minutes.
Le 5 février 1925, partant de Bruxelles (aéroport d’Haeren), Edmond Thieffry, as de l’aviation belge de la Première Guerre mondiale, s’envole à bord d’un Handley-Page (avec moteurs Rolls Royce) pour relier les colonies. Le voyage durera 51 jours (suite à de nombreuses pannes, avaries, casses.) Mais finalement, le Princesse Marie-José se pose magistralement à Léopoldville (devenue Kinshasa, en RDC) après plus de 75 heures et 21 minutes de vol effectif, ayant traversé sur plus de 3 500 km des zones jamais survolées jusqu’alors.
Traversées de l’Atlantique
Albert Cushing Read, premier homme à traverser l’Atlantique par les airs
Avec escales, de Long Island à Plymouth en mai 1919, par Albert Cushing Read ; Sans escale, en juin 1919, Alcock et Brown décollent de Terre-Neuve et traversent, l’océan d’ouest en est, et se posent en Irlande ; En solitaire et sans escale, le 21 mai 1927, Charles Lindbergh réussit à traverser l’Atlantique, de New York au Bourget. L’exploit, réalisé sur un monoplan le Spirit of Saint-Louis lui demanda trente-trois heures, 15 jours après la disparition de Charles Nungesser et François Coli à bord de l’Oiseau blanc, lors de leur tentative de traversée entre Paris et New-York ; D’Irlande au Québec, Hermann Köhl, James Fitzmaurice et Ehrenfried Günther von Hünefeld le 13 avril 1928 ; de Paris à New York : Dieudonné Costes et Maurice Bellonte sur le Breguet 19 Point d’Interrogation les 1er et 2 septembre 1930.
Atlantique Sud :
Carlos Viegas Gago Coutinho et Sacadura Cabral en 1922 sont les premiers à avoir traversé l’Atlantique Sud ;
Ramon Franco en 1926 avec un hydravion Dornier Wal ;
Première traversée de Jean Mermoz pour l’Aéropostale le 12 mai 1930.
En dirigeable : par le zeppelin Hindenburg le 6 mai 1936
En ULM : Guy Delage en 1991, du Cap-Vert au Brésil sans escale, en 27 heures.
Développement de l’aviation civile commerciale
En France
Lignes Aeriennes Latécoère, 1918.
En 1918, est fondée la Société des lignes Latécoère, future Compagnie générale aéropostale par Pierre-Georges Latécoère.
En février 1919, est fondée la Compagnie des Messageries Aériennes, par Louis-Charles Bréguet. Les autres fondateurs sont Louis Blériot, Louis Renault et René Caudron. La première voie commerciale, un service de fret et de courrier entre Paris et Lille, débuta le 18 avril 1919 à l’aide d’anciens avions militaires Breguet 14. Le 19 Septembre de la même année un service de transport international de voyageurs entre Paris et Londres a été lancé, en utilisant également des Breguet 14.

Le Farman Goliath, un des plus anciens avions de ligne, fut d’abord utilisé comme bombardier
Les Grands Express Aériens est une compagnie aérienne française fondée le 20 mars 1919 et qui a fusionné avec la Compagnie des Messageries Aériennes pour former Air Union le 1e janvier 1923.
Le 7 avril 1922, se produit la première collision d’un avion de ligne en vol : un Farman F.60 Goliath des Grands Express Aériens, partant du Bourget en direction de Croydon près de Londres alors qu’il vole dans le brouillard, entre en collision avec un Daimler Airway de Havilland DH.18 qui faisait le même voyage en sens inverse. Sept personnes sont tuées sur le Farman F.60, dont trois passagers.
Le monde
En 1919 est fondée la KLM, c’est la plus vieille compagnie au monde encore existante, mais aussi la compagnie colombienne Avianca et, en 1920, la Qantas.
Préparation à la guerre
Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, les recherches militaires s’intensifient et de nouvelles inventions révolutionnaires sont ébauchées, telles la turbine (au Royaume-Uni et surtout en Allemagne), la fusée (en Allemagne) ou le radar (au Royaume-Uni).
La guerre d’Espagne sert de terrain d’expérimentation aux forces naissantes de la Luftwaffe. Un épisode connu de cette guerre est le bombardement de la ville de Guernica par les avions de la (Légion Condor), massacre figé par Pablo Picasso.
Seul le bombardier lourd manque à la panoplie de la Luftwaffe. Elle possède, en outre, le Messerschmitt BF109 qui passe pour le meilleur chasseur du moment.
Le Japon, quant à lui, aligne les fameux (Zero) à partir de 1939. Les Mitsubishi A6M, aux performances remarquables qui domineront les combats dans le Pacifique pendant la première moitié de la guerre. Elle utilisera son aviation embarquée pour détruire la flotte américaine basée à Pearl Harbor, ce qui déclenche l’entrée en guerre des États-Unis.
Le Royaume-Uni possède des Hawker Hurricane lents mais bien armés, puis des Supermarine Spitfire plus rapides, capables de résister aux Messerschmitt BF109. Elle peut compter sur ses radars côtiers et sur son statut d’île, à distance respectable du continent.
Quant à la France, son plus remarquable chasseur est sans nul doute le Dewoitine D.520.
L’aviation civile d’après-guerre
La fin de la deuxième guerre mondiale a été l’occasion pour les constructeurs, en particulier américains, de recycler dans le domaine de l’aviation commerciale les avancées techniques réalisées au titre de l’effort de guerre. Des avions de transport militaires, comme les Douglas C-47 ou C-54, ont rapidement trouvé des débouchés civils. Parallèlement, un constructeur comme Boeing a pu mettre à profit les chaines de production de ses bombardiers lourds B-29 pour lancer des appareils commerciaux aux dimensions et aux performances alors inédites.
Cette disponibilité d’avions en grand nombre et de pilotes démobilisés accompagna le renouveau économique de l’après-guerre par la création et la remise en fonctionnement de nombreuses lignes aériennes. Cette période marqua l’apogée de l’aviation commerciale à pistons, des appareils aussi prestigieux que le Lockheed Constellation voyant leur carrière abrégée dès la fin des années 1950 avec l’arrivée des premiers avions de ligne à turbopropulseurs puis à réaction.

Le Boeing 377 Stratocruiser (à cabine pressurisée), mis en sevice en 1949.

Le Vickers Viscount, premier avion à turbopropulseur produit en série, mis en service en 1950.
Les premiers avions de ligne à réaction
Le premier avion de ligne à réaction est le De Havilland Comet mis en service en 1952. Le coût du passager au kilomètre chute de 30 %, ce qui permet de démocratiser le voyage en avion. Les vitesses de vols passent de 450 à 800 km/h.

Le De Havilland Comet mis en service en 1952

Le Boeing 707 mis en service en 1958

La Caravelle du constructeur français Sud-Aviation mise en service en 1959

Le Douglas DC-8 mis en service en 1958
Avions sans carburant. Avions à propulsion musculaire
Gossamer Condor (1977)

Le MC30E en vol, lors de la campagne d’essais d’Août 2011.
Avion solaire

la navette pour voyage dans l'espace futuriste 2014
HISTOIRE DE L’AÉROSTATION
L’aérostation est la technique qui permet le vol au sein de l’atmosphère terrestre en utilisant des engins plus légers que l’air. L’histoire de l’aérostation commence véritablement à la fin du XVIIIe siècle d’abord avec les ballons gonflés à l’air chaud, puis à l’hydrogène. Elle conduit au développement des dirigeables qui, un temps, concurrenceront le transport aérien par avion et se termine tragiquement avec l’accident du Hindenburg en 1937. L’aérostation est, au début du XXIe siècle, essentiellement une activité de sport et de loisir. Les ballons restent utilisés à des fins scientifiques, météorologie en particulier. Des projets de dirigeables renaissent périodiquement pour le transport de charges encombrantes et pondéreuses. Elle a été récemment démocratisée grâce aux retours des grands ballons captifs notamment à Paris et Disneyland Resort Paris Aerophile SA.
Les premiers essais
Les premières expériences enregistrées de vols de ballons remplis d’air chaud furent celles effectuées en présence du roi Jean V du Portugal en août 1709 par un prêtre brésilien, Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Le ballon construit en papier aurait atteint une hauteur de 4 mètres.
Les frères Etienne et Joseph Montgolfier font leurs premiers essais avec un ballon de papier rempli d’air chaud en 1782 et de nombreuses anecdotes non documentées rendent compte de ces vols. Le premier vol d’une mongolfière aurait eu lieu à Annonay, près de Lyon,
le 25 avril 1783, et elle aurait atteint une hauteur d’environ 300 mètres. La première démonstration publique aura lieu le 4 juin 1783 en présence des États particuliers du Vivarais et la montgolfière dépasse 1800 mètres de hauteur. Ce vol leur ouvre les portes de la cour de Versailles où ils réalisent, le 19 septembre 1783, en présence du roi Louis XVI, un vol dans un ballon de 13 mètres de diamètre. Les premiers passagers sont un coq, un canard et un mouton qui parcourront plus de 3 km à une hauteur de 550 mètres ouvrant ainsi la voie aux vols habités.
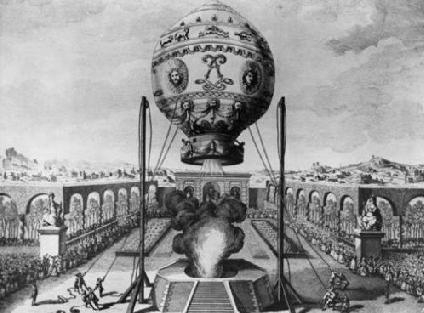
Gravure représentant le 1er vol habité à la Folie Titon, le 19 octobre 1783
Le 27 août 1783, le physicien Jacques Charles avec l’aide des frères Robert, lâche le premier ballon à gaz rempli d’hydrogène à Paris, devant l’École militaire. Le ballon, inhabité, se pose à Gonesse, 25 km plus loin.
Le 19 octobre 1783, le premier vol habité par des humains est effectué, à la manufacture de Jean-Baptiste Réveillon à la Folie Titon, avec un ballon captif (relié au sol). Il emporte deux personnes : Jean-François Pilâtre de Rozier et Giroud de Villette.
Les premiers vols – les ballons libres
Le début réel de l’aérostation est marqué par le succès des frères Montgolfier, le 21 novembre 1783, du vol de leur montgolfière où avaient pris place Jean-François Pilâtre de Rozier et le Marquis d’Arlandes.
Le 1er décembre 1783, dix jours après, Jacques Charles et Marie-Noël Robert volèrent au-dessus des jardins des Tuileries à Paris avec un ballon à gaz, rempli à l’hydrogène.
Le 19 janvier 1784, envol à Lyon du Flesselles, une énorme montgolfière de plus de 20 000 m³, pilotée par Jean-François Pilâtre de Rozier avec à son bord Joseph Montgolfier. L’année 1784 verra, d’ailleurs, un grand nombre d’essais d’envol de montgolfière dont de nombreux réussis. Cela en France, mais également en Angleterre et en Italie.
Le 2 mars 1784, la foule rassemblée sur le Champ de Mars à Paris assiste à l’ascension d’un aérostat gonflé à l’hydrogène et piloté par Jean-Pierre Blanchard. Le ballon, muni d’une hélice actionnée à la main et poussé par le vent, franchit la Seine et revient pour se poser rue de Sèvres. À partir de ce moment, toute une série de vols vont se produire en Europe, en France, bien sûr, mais également en Italie et en Angleterre.
Le 4 juin 1784, vol de la première femme, Élisabeth Thible, avec M. Fleurant dans l’aérostat Le Gustave (baptisé ainsi en l’honneur du roi de Suède Gustave III, présent ce jour-là).
Le 23 juin 1784, triple record du monde, de Jean-François Pilâtre de Rozier et du chimiste Louis Joseph Proust à bord de la montgolfière La Marie-Antoinette conçue par Étienne Montgolfier : distance 52 km, vitesse 60 km/h et altitude 3 000 m environ.
Le 7 janvier 1785, Jean-Pierre Blanchard et John Jeffries accomplissent pour la première fois la traversée de la Manche dans le sens Angleterre-France dans un ballon gonflé à l’hydrogène.
Le 15 juin 1785, Jean-François Pilâtre de Rozier, qui tentait également de traverser la Manche mais dans le sens inverse, c’est-à-dire contre les vents dominants, se tue avec Pierre Romain à bord d’un ballon mixte, montgolfière et ballon à gaz.
Ce drame qui est d’ailleurs le premier accident aérien, va mettre un frein aux divers envols de ballon à air chaud. Il va falloir attendre la révolution française, où André-Jacques Garnerin sera nommé Aérostatier des Fêtes Publiques pour que les ascensions reprennent.
Les ballons dans l’armée

Ballon à gaz de Coutelle, Blocus de Mayence, 1795.
Le comité de Salut Public décide même le 24 novembre 1793, la construction d’un ballon à gaz capable d’emporter deux observateurs à des fins militaires. Jean-Marie-Joseph Coutelle, physicien, est le responsable, il a pour adjoint un autre physicien, Nicolas-Jacques Conté. Le ballon, L’entreprenant, est prêt le 29 mars 1794, et un essai en captif est effectué, à 682 mètres au-dessus de la Seine, Coutelle armé d’une lunette peut faire des observations à grande distance. Le 2 avril, la première compagnie d’aérostiers est créée, Coutelle en est le chef. Ils partent pour rejoindre l’armée de Sambre-et-Meuse qui se bat à Maubeuge. Le 2 juin a lieu la première ascension d’observation sous le feu de l’artillerie autrichienne. Ils vont ensuite se déplacer jusque devant Charleroi avec le ballon gonflé pour faire des observations le 24 et le 25. Le 26, les Autrichiens capitulent à Charleroi. L’ennemi est désorienté et démoralisé de voir toutes ses actions à découvert.
Une deuxième compagnie est créée, ainsi qu’une école à Meudon et neuf ballons sont construits. La première compagnie est capturée à Wurtzbourg, le 3 septembre 1796 suite à la retraite de l’armée française. Les ballons captifs sont difficiles à déplacer, les fours en brique pour produire l’hydrogène sont long à construire, le gonflage durait de deux à trois jours, autant de facteurs défavorables. Ils sont pourtant embarqués pour la campagne d’Égypte mais les deux navires où est tout le matériel coulent. De retour en France, Bonaparte démantèle les compagnies d’aérostiers et ferme l’école.
Les ballons au secours de Paris
Les ballons à gaz vont pourtant reprendre du service lors du siège de Paris par les Allemands en 1870. Nadar, qui a déjà auparavant réalisé la première photographie aérienne en ballon, créé une compagnie d’aérostiers qui a pour charge de rompre le siège et de permettre d’envoyer du courrier à l’extérieur. Des personnalités politiques vont pouvoir aussi s’échapper comme Léon Gambetta. En un peu moins de 6 mois, 66 ballons vont transporter 11 tonnes de courrier. Cinq seulement seront pris par les Allemands, chiffre faible si on tient compte que la direction du voyage n’était pas complètement contrôlée et qu’il fallait compter avec les caprices des vents.
Une compagnie d’aérostiers fut créée dans le cadre de l’armée de la Loire, organisée par Gaston Tissandier (lui-même échappé du siège de Paris en ballon), avec pour double but d’assister l’armée sur le champ de bataille et de tenter des vols vers Paris. Les deux échoueront. En souvenir de ces exploits, d’importants concours de ballons furent organisés lors des Jeux olympiques d’été de 1900 à Paris.
Le Zénith : premier drame de l’altitude
En 1875, trois aérostiers français, après avoir réussi un vol de longue durée, tentent un record d’altitude à bord du Zénith. N’étant pas informés des risques encourus à une telle altitude, deux d’entre eux trouveront la mort (le vol dépassera 8 600 m).
Les ballons captifs aux expositions universelles

Photo aérienne de l’exposition
Henri Giffard met en œuvre un ballon captif actionné par un treuil à vapeur pour l’exposition universelle de 1867 (pour l’anecdote, ce ballon finira en tente dans le camp prussien durant le siège de 1870), puis pour l’exposition universelle de 1878 avec un succès considérable : tout le gotha français et mondial fera des ascensions. En 1878, 900 personnes feront l’ascension en une seule journée au cours de 24 ascensions. Du 28 juillet au 4 novembre, 1 000 ascensions seront réalisées, emmenant 35 000 passagers.
Après la mort de Giffard, deux équipes reprendront le flambeau pour l’exposition universelle de 1889, l’un au Trocadéro, l’autre boulevard de Grenelle, ce qui explique l’existence de photographies de la Tour Eiffel vue d’en haut, avec la présence d’un autre ballon sur l’image.
Paris possédera 6 ballons captifs en 1900. La Suisse entre dans la danse en 1896 pour l’exposition nationale suisse, avec A.Liwentaal et Eugène Baud. Beaucoup de grandes villes dans le monde s’équiperont de ballons captifs à toutes sortes d’occasions.
L’avènement des dirigeables

L’aérodrome de la Porte Maillot à Neuilly-sur-Seine, avant 1903
Le ballon libre est trop tributaire du vent pour ses déplacements. Très tôt, le général Jean-Baptiste-Marie Meusnier conçoit un ballon de forme ellipsoïdale, muni d’un gouvernail, mais à l’époque aucun moteur n’existe. Les inventeurs en sont réduits à essayer des systèmes à base de rames qui s’avèrent complètement inefficace.
La première réalisation effective est dû à Henri Giffard qui utilise une petite machine à vapeur pour actionner l’hélice ; il décolle de Paris le 25 septembre 1852, et atterrit à Trappes après un trajet de 27 km. Mais le poids des moteurs empêche une utilisation plus facile.
En 1881, à l’Exposition d’électricité, Gaston et Albert Tissandier contribuent au premier modèle de ballon dirigeable mû par l’électricité (vol non habité en intérieur).
En 1883 et 1884, ils font deux vols dans un dirigeable électrique, mais, s’ils parviennent à le manœuvrer, ils ne parviennent pas à remonter le vent.
Le 9 août 1884, Charles Renard et Arthur Krebs font revenir leur dirigeable La France à leur point de départ, un petit voyage de huit kilomètres entre Meudon et Villacoublay. Il est propulsé par un moteur électrique pesant 44 kg au cheval et alimenté par piles. Il faudra attendre une vingtaine d’années et les exploits de Santos-Dumont pour rééditer la performance. Mais, c’est l’invention du moteur à combustion interne qui va permettre au dirigeable de faire des progrès fulgurants. Progrès qui l’amèneront avec les Zeppelin à pouvoir traverser l’océan Atlantique, ou encore à Roald Amundsen et Umberto Nobile de survoler le pôle Nord. Malheureusement ce sont ces mêmes moteurs qui vont permettre à l’aviation de supplanter l’aérostation.
L’aérostation moderne
Les accidents tragiques avant la Seconde Guerre mondiale de grands dirigeables gonflés à l’hydrogène vont mettre un terme à cette épopée, et définitivement ruiner l’utilisation commerciale du ballon comme moyen de transport. Restaient les utilisations sportives, scientifiques et militaires.
Le 28 mai 1931, le professeur Auguste Piccard et son assistant Paul Kipfel battent un record d’altitude : ils montent à 16 000 mètres, dans la stratosphère, grâce à l’utilisation d’une cabine pressurisée. L’objectif était l’étude du rayonnement cosmique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques lâchèrent des dizaines de milliers de ballons vers l’Allemagne lors de l’Opération Outward. Ces derniers étaient équipés de bombes incendiaires ou laissaient traîner des filins en métal pour causer des court-circuits en touchant les lignes électriques.
De novembre 1944 à avril 1945, les Japonais utilisèrent des ballons incendiaires dans le projet Fugo. Ceux-ci dérivaient à l’altitude du courant-jet, 9 à 10 km, pour atteindre l’Amérique. Les résultats ont été très minimes.
La première traversée de l’Atlantique dans un ballon à hélium, non dirigeable, est effectuée le 17 août 1978 par Ben Abruzzo, Maxie Anderson, et Larry Newman.
C’est seulement en 1999 que Bertrand Piccard et Brian Jones font le tour du monde sans escale en ballon mixte, en parcourant 46 759 km en un peu plus de 19 jours. Ils étaient partis de Suisse et atterrirent en Égypte à 500 km du Caire.
La société Aerophile SA détient le record du plus grand nombre de passagers élevés grâce au principe de plus léger que l’air avec 1 280 000 passagers depuis 1993.
LES MOTEURS À PISTONS DE 1900 À 1945
L’aviation moderne est née le jeudi 17 décembre 1903 lorsque les Américains Orville et Wilbur Wright parvinrent à faire voler plusieurs fois de suite leur Flyer. Grâce à leur moteur artisanal en ligne refroidie par eau, de 12 CV a 4 cylindres, ils réussirent à rester en vol pendant 59 secondes et à parcourir 259 mètres. Avant les frères Wright, bien d’autres ingénieurs avaient essayé mais sans succès, car leurs moteurs, généralement des moteurs à vapeur, étaient bien trop lourds et pas assez puissants. Parmi ceux-là on peut citer les Français Félix du Temple et Clément Ader, dont on oublie souvent qu’ils ont surtout travaillé, à la fin du XIXème siècle à réduire le poids du moteur à vapeur qu’ils voulaient monter sur leurs appareils. Rapidement, les premiers pionniers comprirent que le moteur était essentiel pour parvenir à leurs fins. Souvent, ils élaborèrent leurs projets autour des propulseurs déjà existants. Le plus souvent utilisé fut au début le moteur (Antoinette) car au moment où il apparut, il répondait à l’attente des inventeurs.
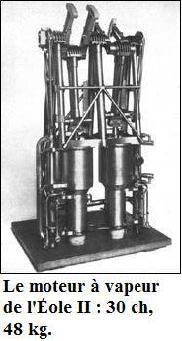
Santos-Dumont utilisa pour la première fois en 1906 le moteur Antoinette à 8 cylindres en V refroidi par eau, de 50 ch. L’Antoinette, conçu et construit en France par Léon Levasseur, devint le propulseur le plus répandu en Europe jusqu’en 1910. Huit cylindres en V de 90 degrés, refroidissement par évaporation, injection directe ; telles étaient les caractéristiques essentielles, très en avance sur leur temps, qui firent de l’Antoinette un moteur sûr, robuste et suffisamment puissant. Le moteur Antoinette a permis à de nombreux pilotes d’établir des records.
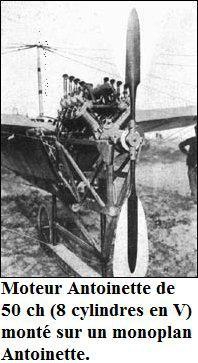
Antoinette était le nom d'une société d'aviation française créée en 1904 par Léon Levavasseur et Jules Gastambide, et des produits qui y furent fabriqués. C'est le prénom de la fille de Gastambide qui fut utilisé, le nom officiel étant ociété des avions et moteurs Antoinette. Elle construisit d'abord des moteurs à combustion qui équipaient la plupart des avions de l'époque. Le capitaine Ferdinand Ferber rejoint la société en août 1906 pour mettre en application ses idées sur l'aviation. La société s'intéresse d'abord à l'automobile puisqu'elle présente un modèle original en 1906 au moteur V8. La société produit notamment le moteur V8 de 50 ch qui équipe l'aéroplaneur 14 Bis qui bat trois records du monde en 1906.

On dit que lorsque le Français Louis Blériot traversa pour la première fois la Manche le 25 juillet 1909 a bort du Blériot XI, ce fut un vol risqué, car le moteur utilisé, le moteur Anzani à trois cylindres en étoiles n’était pas très fiable. L’Anzani était un moteur semi-radial à 3 cylindres refroidi par air, de 22-25 ch. Sa puissance était donc relativement faible par rapport à celle de ses concurrents les plus directs.

Le Rhône, moteur rotatif de 9 cylindres de 80 ch était un des moteurs les plus fiables au début de la première guerre mondiale. Moteur rotatif signifie que les cylindres tournaient autour de l’axe central, ce qui permettait un meilleur refroidissement. Il équipa de nombreux avions et hydravions de combat alliés. Une version 100 ch fut également produite. Elle équipa notamment le fameux avion de chasse Nieuport, l’un des plus réussis des premières années de guerre.
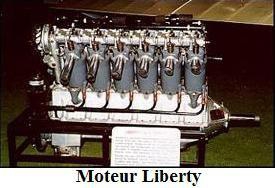
Ce moteur américain de 12 cylindres développait une puissance de 400 ch et tournait à 1750 tours/minute, fut construit à partir de 1917. Il était refroidi par liquide. Ce fut le moteur le plus puissant de la Première Guerre Mondiale, arrivé malheureusement trop tard pour être utilisé en temps de guerre.Il équipa de nombreux appareils américains jusque dans les années trente.
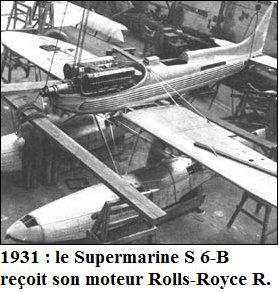
Les ingénieurs de la firme Rolls-Royce imaginèrent et construisirent ce moteur pour le monter sur les hydravions Supermarine de compétition. Il permit donc aux Royaume-Uni de remporter la Coupe Schneider, sorte de championnat du monde de l’époque. Il s’agissait d’un moteur à douze cylindres en V, à refroidissement par liquide, d’une puissance de 2 350 ch à 3 200 tours/mn. De grande qualité, il fut à l’origine de la célèbre lignée des moteurs Merlin, dont furent équipés de nombreux appareils de guerre britanniques de la Seconde Guerre Mondiale, comme le Spitfire.

Dérivé du moteur Rolls-Royce R, réalisé à la fin des années trente, le Merlin fut construit à plus de 150 000 exemplaires et équipa les avions anglais les plus prestigieux de la seconde guerre mondiale du Hawker Hurricane au Avro Lancaster, en passant par le Spitfire ou encore le Mosquito. C’était un moteur à douze cylindres en V, refroidi par liquide et suralimenté. Les premières versions annonçaient une puissance de 990 ch, mais les dernières versions dépassaient 2 000 ch. Le Merlin fut vraiment le moteur de la victoire pour la Royal Air Force.

Ce moteur mis au point par la société américaine Wright succéda au Whirlwind. Il fut mis au point aux États-Unis au début des années trente. Il était équipé de neuf cylindres en étoile. Il fut utilisé par de nombreux constructeurs pour équiper des avions de combat qui prirent part à la Seconde Guerre Mondiale, dont le célèbre bombardier B-17 Flying Fortress (Forteresse volante).

Ce moteur à douze cylindres en V équipa toutes les versions du Messerschmitt 109, le plus célèbre chasseur allemand de la Seconde Guerre Mondiale Construit à partir de 1937, dans version initiale DB 600, il a subi pendant la guerre de nombreuses améliorations. Les ingénieurs utilisèrent pour la première fois le principe de l’injection directe. Le DB 601 avait une puissance de 1050 ch. Il permit à un Messerschmitt Bf109 modifié de battre le record du monde de vitesse avec 610 km/h. Le DB 605 produits à partir de 1941 a sans doute été la version la plus réussie de ce moteur. Il put atteindre les 2000 ch dans sa version de 1944. L’ultime développement de la série, sous le nom de DB 610, se présentait sous la forme de deux DB 605 rassemblés côte à côte. Il avait une puissance de 2870 ch, mais n’équipa qu’un seul avion allemand, le bombardier Heinkel 177. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les moteurs à pistons ont été progressivement remplacés par les premiers réacteurs, d’abord sur les avions de chasse, puis sur la plupart des avions de ligne. Aujourd’hui, il n’y a plus que les avions de tourisme qui soient encore équipés de moteurs de ce genre. Ils sont évidemment bien moins puissants que ceux utilisés en 1945.
Anzani
Un moteur pour Blériot
C’est un pionnier italien de la mécanique qui permit à Blériot de réussir sa traversée historique Alexandre Anzani, constructeur et inventeur de moteurs, appartenaient à cette catégorie d’Italiens doués pour la technique qui firent carrière à l’étranger. Son nom reste attaché à la première traversée aérienne de la Manche : c’est, en effet, un moteur de sa conception et de sa construction qui équipait, en 1909, le fragile monoplan de Louis Blériot.

Anzani naquit à Gorla, non loin de Milan, le, 5 décembre 1877, dans une famille modeste. Attiré par la technique et la mécanique, il acquit, très jeune, une grande habileté et la mit à profit pour construire des bicyclettes et des motos. Dans ce domaine bien particulier, il put se familiariser avec le fonctionnement des moteurs et se livrer à quelques expériences hors du commun comme la réalisation d’une moto mue par une hélice susceptible d’atteindre des vitesses de l’ordre de 80 km/h.
Les progrès de l’aviation en Europe le poussèrent à s’intéresser aux moteurs légers destinés aux avions. Contrairement aux frères Seguin, inventeurs du moteur Gnome rotatif, Anzani s’intéressait au moteur à cylindres fixes en étoile munis de grandes ailettes pour améliorer le refroidissement par air. Cette solution avait le mérite de réduire considérablement le poids, à puissance égale.

Le premier moteur aéronautique d’Anzani, réalisé en 1908, était à 2 cylindres opposés et délivrait la modeste puissance de 15 ch pour un poids de 33 kg. L’année suivante, le constructeur étudiait un nouveau moteur à 3 cylindres en étoile, d’une puissance identique à celle du modèle antérieur; il en tira immédiatement une nouvelle version, de même configuration, dont la puissance atteignit 25 ch pour un poids de 65 kg.
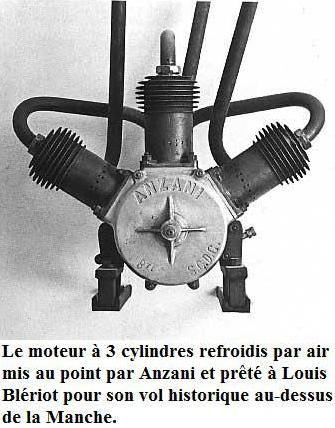
Le choix de Louis Blériot. La rencontre d’Anzani et de Louis Blériot, en 1909, devait jouer un rôle décisif pour l’avenir du mécanicien italien. L’industriel français, passionné d’aviation et constructeur d’avions monoplans, avait caressé l’idée de participer à la course aérienne organisée par le journal britannique Daily Mail, lequel voulait récompenser l’aviateur qui relierait d’un seul coup d’aile le Continent à l’Angleterre. Cette ambition était encore attisée par la perspective du prix offert (25 000 livres sterling-or!), et les concurrents étaient nombreux. Parmi ceux-ci, le comte de Lambert et Hubert Latham figurait parmi les favoris.
Louis Blériot n’était pas satisfait des performances de ses monoplans, et son souci majeur portait sur l’endurance trop modeste des moteurs qu’il avait pu essayer.

Le 27 mai 1909, le pionnier français décolla pour essayer son modèle XI, auquel il avait apporté une modification fondamentale en remplaçant le moteur REP, de fabrication française, mais trop lourd et sujet à la surchauffe, par un nouveau moteur plus léger, à 3 cylindres refroidi par air, qu’Anzani venait juste de mettre au point. L’essai fut concluant, et, deux mois plus tard, à l’aube du 25 juillet 1909, le même Anzani aidait Blériot à démarrer le moteur du modèle XI au départ d’un vol qui allait faire date. Les recommandations du motoriste permettant de pallier la faiblesse du vent relatif nécessaire au refroidissement des cylindres par une grande consommation d’huile avaient été parfaitement comprises par Blériot, qui doit beaucoup à Alexandre Anzani. Les autres constructeurs ne s’y trompèrent pas, et les commandes affluèrent.
Peu de temps après, le constructeur proposait un moteur à 4 cylindres en V de 85 kg et 35 ch et un moteur à 5 cylindres en étoile de 115 kg et 50 ch. Entre 1910 et 1914, projets et réalisations devaient se succéder à un rythme rapide : moteurs à 6 cylindres en V de 50 ou 60 ch, moteurs en double étoile à 10 cylindres de 70 ch, à 5 cylindres de 80/90 ch, à 10 cylindres en double étoile de 100 ch – puissance portée à 125 ch, enfin, en 1913, moteurs à 20 cylindres en quatre étoiles de 260 kg et 200 ch.
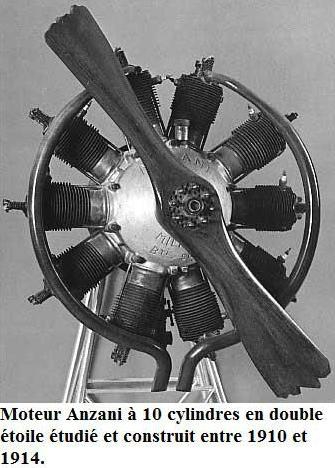
Toute la production d’Anzani était axée sur les moteurs refroidis par air, plus simples et plus légers mais de puissance et de régime limités. Un seul groupe, un 8-cylindres en ligne de 70 ch, fut étudié avec un refroidissement par eau, mais sans succès.
Au début de la Première Guerre mondiale, les moteurs Anzani de 100 ou 125 ch furent choisis par l’aviation militaire française (le Caudron G-4, par exemple, était équipé d’un Gnome ou d’un Anzani), mais les groupes plus puissants de 200 ou 210 ch ne furent pas réceptionnés.
Anzani poursuivit son activité après la guerre, mais son succès commercial resta limité, le constructeur étant plus attiré par la recherche que par la fabrication en série. C’est ainsi qu’il s’intéressa aussi à l’automobile et à la moto. II faut noter qu’en 1909 Alexandre Anzani avait également construit un aéroplane dont les performances furent médiocres. Ce fut sa seule infidélité à sa carrière de motoriste.
AVIATION 1939-1945 1e partie
LE RAID SUR TOKYO
James Doolittle voit le jour sous le soleil de Californie, à Alameda, le 14 décembre 1896. Au tournant du siècle, ce fils de charpentier déménage avec sa famille pour s’installer dans le camp de chercheurs d’or de Nome en Alaska. C’est dans cette nature sauvage qu’il grandit et se forge un caractère d’aventurier et de casse-cou. De retour en Californie, il fait ses études au Los Angeles Junior College avant de s’inscrire à l’école des mines de Californie.
Son ambition était de devenir ingénieur et de travailler dans des exploitations minières de l’Ouest américain. Mais, entre temps, il a découvert l’aviation qui le passionne au plus haut point. De 1910 à 1912, il travaille à la construction de son propre planeur, s’appuyant sur des plans fournis par un magazine.

B-25 B parqué et sanglé sur le pont du Hornet au 2e plan, le destroyer USS Gwin
En 1917, année de l’entrée en guerre des USA, Doolittle met un terme à ses études d’ingénieur et s’enrôle dans le Signal Corps Reserve comme cadet. Il suit des cours au sein de l’école d’aéronautique militaire ainsi que sur le terrain de Rockwell en Californie.
Le 11 mars 1918, il est nommé aspirant. James Doolittle quitte la côte Ouest et part pour le Texas afin de rejoindre son affectation. Bien que s’étant porté volontaire pour aller se battre en Europe, notre homme ne quitte pas le territoire des Etats-Unis. Souvent muté, Doolittle est successivement basé dans l’Ohio, puis en Louisiane avant de retourner en Californie. En 1919, il sert comme instructeur de tir avant de boucler à nouveau ses malles et de repartir au Texas. Il vole au sein du 104th Squadron puis dans les rangs du 90th Squadron.
Les opérations se limitent à des patrouilles le long de la frontière américano-mexicaine ainsi qu’à des vols d’entraînement. Le 01 juillet 1920, il est promu au grade de lieutenant et part suivre des cours de perfectionnement dans l’Ohio.
Le 04 septembre 1922, James Doolittle commence à se faire connaître et remarquer. Pilotant un de Havilland DH-4B de l’US Army Air Service spécialement équipé avec des instruments de navigation, il se lance pour défi de traverser les USA en moins de 24 heures depuis la côte Est jusqu’à la côte Ouest. Le raid transcontinental, le premier du genre dans ces conditions, est un succès ! Décollant de Pablo Beach en Floride, James Doolittle se pose à San Diego (Californie) après un vol de 21 heures et 19 minutes. L’exploit est de taille, ce qui vaut au jeune lieutenant de recevoir la Distinguished Flying Cross des mains de ses supérieurs.

Les B-25 B sur le pont de L’USS Hornet (CV-8). Au premier plan l’avion du capitaine Jones.
En juillet 1923, Jimmy entre au Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT, afin d’y suivre des cours d’ingénieur en aéronautique. Il sera diplômé en 1924 et obtiendra en 1925 le premier titre américain de docteur en aéronautique.
Tout au long de sa vie notre homme entretiendra des relations privilégiées avec le MIT et participera activement aux nombreuses recherches menées par le College. Parallèlement, James Doolittle poursuit sa carrière dans l’armée. Il dirige des tests sur l’accélération des avions à Mc Cook field en 1924. En juin 1925, il est affecté à la base aéronavale de Washington DC et travaille sur les hydravions rapides. Il tente régulièrement de battre des records de vitesse. Doolitle est engagé dans la Schneider Cup Race, une course d’hydravions, qu’il gagne en 1925 aux commandes d’un appareil produit par Curtiss.
L’année suivante, il obtient de la part de l’armée un congé pour participer à une tournée en Amérique du Sud. En avril 1926, au Chili, il se brise les deux chevilles. Cela ne l’empêche pas le lendemain de participer au meeting aux commandes de son biplan Curtiss P-1 « Hawk ». Doolittle est finalement rapatrié par avion sanitaire aux Etats-Unis, où il est hospitalisé, les deux chevilles dans le plâtre.
Il reste au Walter Reed Hospital de Washington DC jusqu’en avril 1927 afin d’y suivre une longue et pénible rééducation. A sa sortie, il rejoint le terrain militaire de Mc Cook. Sur place, il poursuit ses travaux et ses recherches, tout en participant à l’instruction de pilotes de bombardiers réservistes.
En septembre 1928, avec le Guggenheim Full Flight Laboratory, il travaille sur les équipements et instruments de vol par mauvaise visibilité. Il participe à la mise au point de l’horizon artificiel et d’autres appareils de navigation. Joignant la théorie à la pratique, Doolittle teste lui-même ces équipements et réalise le 24 septembre 1929 le premier vol en aveugle de l’histoire à bord d’un Consolidated NY-2.
L’expérience est concluante, le pilote et l’appareil sont sains et saufs. Avec des équipements adéquats, les avions pourront désormais voler par relatif mauvais temps ou même dans l’obscurité. La presse américaine, toujours friande de héros, s’empare de la nouvelle et médiatise James Doolittle qui n’a que 33 ans. En récompense de ses travaux, notre homme reçoit le Harmon Trophy. Doolittle est bel et bien reconnu comme étant un véritable pionnier de l’aviation.

Les deux bombardiers du premier plan ont pour cible Tokyo.
En janvier 1930, James Doolittle est nommé conseiller par l’armée pour la construction de l’aérodrome Floyd Bennett de New-York. Le 15 février de la même année, notre homme décide de quitter les forces armées et d’entamer une carrière civile.
Nommé major dans le Specialist Reserve Corps, Doolittle rejoint la très puissante Shell Oil Company où il occupe le poste de directeur du département aéronautique et celui de vice-président. Il travaille notamment sur la mise au point de carburants pour les avions. Cette activité le conduit régulièrement à voler afin de procéder à des tests et des évaluations.
Toujours passionné par les courses, le pilote remporte la Bendix Trophy Race de Burbank à Cleveland. Il enlève aussi la Thompson Trophy Race à bord d’un Gee Bee R-1. Ces succès renforcent encore un peu plus son image de pilote talentueux et aussi de héros. En avril 1934, Jimmy devient membre du bureau militaire chargé de l’organisation de l’US Air Corps.
En 1940, Doolittle accède à la charge de président de l’institut des sciences aéronautiques. Alors que les armées du IIIe Reich déferlent sur les nations européennes, le président Roosevelt et les Etats-Unis commencent à envisager l’entrée en guerre.
Le 01 juillet 1940, James Doolittle est rappelé au service actif et est chargé d’évaluer les capacités de production d’appareils de combat. Affecté dans l’Indiana puis dans le Michigan, il travaille de concert avec les firmes automobiles.
Il écume usines et sites de production afin de prodiguer des conseils pour transformer les chaînes de montage d’automobiles en ateliers aéronautiques. Dès le mois d’août 1940, il s’envole pour la Grande-Bretagne en mission spéciale d’observation afin de bénéficier de l’expérience des constructeurs aéronautiques britanniques.
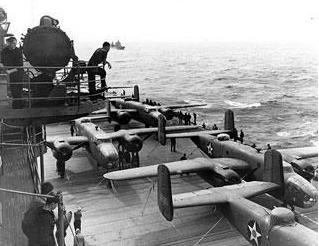
Belle vue des appareils du raid Doolittle depuis l’îlot du Hornet.
En décembre 1941, l’attaque de Pearl Harbor fait basculer l’Amérique dans la guerre. Promu lieutenant-colonel le 02 janvier 1942, James JimmyDoolittle est convoqué au quartier général de l’Army Air Force afin de planifier le premier raid aérien au dessus du sanctuaire national japonais.
Militairement peu efficient, ce raid doit avant tout redonner le moral à l’Amérique et prouver aux yeux du monde que le Japon n’est pas intouchable. Doolittle se porte volontaire pour mener à bien le raid. Il reçoit l’accord du général H.H. Arnold et celui de l’amiral King.
Le 18 avril 1942, seize bombardiers moyens B-25B, allégés d’un maximum de leurs équipements, s’élancent l’un derrière l’autre et décollent difficilement du pont du porte-avions USS Hornet (CV-8) commandé par Mitscher. Les cibles ? Des sites industriels nippons à Tokyo, Kobe, Osaka et Nagoya.
Le vol est sans retour, les équipages le savent, ils devront, si tout va bien, sauter en parachute au dessus de la Chine. Comme ses hommes, Doolittle saute. Il atterrit près de Chu Chow dans une rizière chinoise. La nouvelle de l’attaque booste le moral américain et celui des alliés. James Doolittle, promu général, reçoit la médaille d’honneur des mains du président Roosevelt. La cérémonie a lieu à la Maison Blanche.
James Doolittle est traité en héros national ! Il accumule les décorations et est aussi récompensé par les Anglais, les Français Libres, les Belges, les Polonais, les Chinois, etc.

Doolittle et ses hommes avec une bombe destinée aux Japonais.
En juillet 1942, notre homme embarque pour le théâtre d’opérations d’Europe-Afrique. Affecté à la 8th Air Force, il devient le patron de la 12nd Air Force en septembre 1942. Les escadrilles de Doolittle sont engagées en Afrique du Nord contre les forces axistes.
Sur place, il retrouve un très vieil ami, californien comme lui, le général George Smith Jr Patton. Il commande ensuite la 15th Air Force de mars 1943 à janvier 1944, avant de prendre la tête de la célèbre Mighty 8th Air Force qui bombarde massivement, jours après jour, le territoire du IIIe Reich. En 1945, alors que l’Allemagne nazie vient de capituler, Doolittle et sa 8th Air Force partent pour le théâtre d’opérations du Pacifique mais le Japon capitule à son tour.

À gauche, Doolittle à droite, Marc A. Mitscher commandant de L’USS Hornet.
Honoré par les Etats-Unis comme par l’ensemble des nations alliées, (Jimmy) Doolittle quitte l’armée en mai 1946 et retrouve son poste de vice-président à la Shell Oil Company. Parallèlement, il fait partie du National Advisory Committee for Aeronautics de 1948 à 1958 et du President’s Science Advisory Committee.
Ce dernier organisme regroupe des conseillers scientifiques rattachés à la Maison Blanche. Il part à la retraite en 1959, toute en restant particulièrement actif dans le domaine du développement de l’aviation, où ses avis restent précieux et fort appréciés. Il est aussi membre de plusieurs conseils consultatifs fédéraux traitant principalement de la sécurité national américaine.
Honoré une dernière fois par le président Ronald Reagan en 1985, James Doolittle s’éteint le 27 septembre 1993, à l’âge de 96 ans, à son domicile de Pebble Beach (Santa Monica) en Californie. Il laisse derrière lui ses deux fils, James H. Jr et John P, tous deux officiers de l’US Air Force. Le général Doolittle est inhumé au cimetière national d’Arlington, où il repose au côté de son épouse, Josephine Doolittle née Daniels (1895-1988). L’extraordinaire carrière de (Jimmy) Doolittle est racontée dans l’ouvrage de Quentin Reynolds, (The Amazing Mr. Doolittle).
Un film, (Thirty Seconds Over Tokyo), est aussi consacré au héros du (Tokyo Raid) ainsi qu’au raid lui-même.
La guerre des vents divins
Le 12 avril 1945, le commandement américain se décida à révéler l’existence d’attaques-suicides menées par l’aéronavale japonaise contre la flotte américaine au large d’Okinawa. Cette information provoqua la stupeur des Américains atténuée cependant par l’annonce de la mort du président Roosevelt. Le phénomène n’était en réalité pas nouveau. Il remontait à près de six mois. Les premières attaques-suicides étaient intervenues pendant le débarquement de Leyte en octobre 1944. Mais ce qui était nouveau, c’était l’ampleur de ce phénomène qui dérivait du code d’honneur de l’armée et de la marine nipponnes. Le vrai courrage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir déclare le 1er article du code du Samouraï : le Bushidô.
CHASSEUR DE CHARS HANS RUDEL
Pilote fanatique, Hans Ulrich Rudel revendiqua aux commandes du Stuka la destruction de cinq cent dix-neuf chars soviétiques en 2 530 missions de guerre. Hans Ulrich Rudel naquit à Konradswaldau (Silésie), le 2 juillet 1916. Son père, pasteur protestant, lui fit effectuer de longues études, et Rudel, féru de sport et décidé à devenir pilote, signa un engagement dans la Luftwaffe en 1936, après avoir passé un an dans le Reichsarbeitsdienst (Service du travail).
En juin 1937, il était admis à la Luftkriegsschule (école de guerre aérienne) de Berlin-Weder, qu’il quitta quelques mois plus tard pour le Stukageschwader 168. C’est là qu’il fit connaissance avec des hommes qui, pendant le conflit, devaient compter parmi les plus célèbres pilotes de Stuka : Dietrich Peltz, Walter Sigel et Hans Karl Stepp.
Sans que l’on en connaisse la raison, Rudel fut affecté au mois de décembre 1938 à l’Aufklarungsschule d’Hildesheim, où il devait accomplir un stage d’observateur. Cette mutation lui sauva peut-être la vie car, le 15 août 1939, le StG-168 vécut un drame inhabituel dans l’histoire de l’aviation.
Ce jour-là, en effet, trompés par le mauvais temps, treize Junkers Ju-87 de cette unité s’écrasèrent au sol lors d’un bombardement simulé dans la région de Neuhammer.

Hans Ulrich Rudel Né le: 02 juillet 1916 à Konradswaldau. Mort le: 18 décembre 1982 à Rosenheim
Hans Ulrich Rudel photographié, au mois de novembre 1943, avec son mitrailleur Erwin Hentschel (à droite); il vient de recevoir la Croix de fer avec glaives.
Déçu d’être éloigné des formations de combat en piqué, Rudel n’en acheva pas moins son temps à Hildesheim. Il obtint ses galons de Leutnant le ter janvier 1939 et rejoignit en mai la Staffel 2 du Fernaufklarungsgruppe 121, basé à Prenzlau, avec lequel il prit part à la campagne de Pologne (septembre 1939).
Le 10 novembre de la même année, aussitôt après avoir été décoré de la Croix de fer de deuxième classe, il demanda sa réintégration dans le corps des bombardiers en piqué. Après s’être vu opposer un refus obstiné, le jeune Silésien finit par obtenir gain de cause, et, à la fin de la bataille de France, Rudel arrivait à l’I/StG-3, stationné dans la région de Caen. Il ne participa à aucune mission de combat au-dessus de l’Angleterre, mais fut nommé Oberleutnant le ler septembre 1940.
Premiers succès
Après un séjour de trois mois à l’école d’entraînement au bombardement en piqué de Graz-Thalerhof, Rudel fut muté à l’I/StG-2, qui, en avril 1941, se trouvait en Grèce. Deux mois plus tard, la plus grande partie des formations de Stuka dont disposait la Luftwaffe fut concentrée le long de la frontière avec l’Union soviétique en vue de participer à l’opération Barbarossa.
Le 22 juin 1941, jour fixé par Hitler pour l’invasion de son puissant voisin de l’Est, Rudel subit donc l’épreuve du feu en attaquant, dans le secteur de Grodno, des unités blindées chargées du soutien des troupes terrestres soviétiques. Le 18 juillet, ayant à son actif plus d’une centaine de missions et gratifié de la Croix de fer de première classe, il devenait officier technique du III/StG-2.
C’est au mois de septembre suivant que Hans Ulrich Rudel accomplit l’exploit qui lui permit de se classer parmi les plus grands pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Le 23 septembre 1941, en effet, le, III/StG-2, opérant depuis son terrain de Tykovo, attaquait la flotte soviétique de la Baltique embossée dans le port de Kronstadt. Au cours de sa première sortie, Rudel largua une bombe de 1 000 kg sur le Marat, un croiseur de bataille de 23 600 t, qui sombra. A la fin de la même journée, il avait ajouté à son palmarès un autre croiseur de plus faible tonnage et un destroyer.

Croix de chevalier de la Croix de fer avec feuilles de chêne et glaives en or et brillants dont Rudel fut le seul titulaire.
Élevé au grade de chevalier de la Croix de fer le 6 janvier 1942, Rudel, nommé Staffelkapitan du 9/StG-2, passa la plus grande partie de l’été de 1942 en Crimée, menant de nombreuses actions au-dessus de la mer Noire et du Caucase. Le 24 septembre, il fêtait sa cinq centième mission.
Après un bref séjour dans un hôpital de Rostov-sur-le-Don, où il fut soigné pour une hépatite, il prit le commandement du I/StG-2 et continua à sillonner le ciel russe, si bien que le 10 février 1943 il pouvait s’enorgueillir d’être le premier pilote au monde à être crédité de mille sorties de guerre. Promu Hauptmann le ler avril suivant, il bénéficia d’une rétroactivité d’un an dans son nouveau grade en raison de sa conduite au feu.
Entre-temps, le I/StG-2 était passé sur Junkers Ju-87.G, avion d’attaque au sol et d’assaut armé de deux canons de 37 mm sous voilure qui n’avait encore jamais été utilisé en opérations; la guerre expérimentale que mena Rudel avec le nouvel appareil fut on ne peut plus concluante puisque, en moins d’une semaine, l’officier allemand parvint à détruire soixante-dix chars soviétiques dans la tête de pont du Kouban. Ces succès encouragèrent l’état-major de la Luftwaffe à introduire l’appareil en quantités importantes au sein des unités d’assaut, et, dès lors, les blindés de l’armée rouge devinrent les objectifs de prédilection de Hans Ulrich Rudel.
Dans la bataille de titans qui, en juillet 1943, mit aux prises, autour du saillant de Koursk, les armées allemande et soviétique, Hans Ulrich Rudel put affiner ses méthodes de combat antichar et devint une sorte de virtuose en la matière.
Le 5 juillet 1943, dès sa première sortie, il incendia quatre T-34 et, avant la fin de la journée, en ajouta huit autres à son palmarès. Le 12 août, il atteignait le total impressionnant de mille trois cents sorties, tandis que son radio-mitrailleur, l’Oberfeldwebel Erwin Hentschel, en totalisait mille.

Armé de deux canons de 37 mm, le Ju-87.G fut, aux mains des pilotes du SG-2, un redoutable tueur de chars. Le 1er juin 1944, Rudel revendiquait sur cet appareil la destruction de 223 blindés soviétiques. A la fin du conflit, son score atteignait le chiffre stupéfiant de 519 chars détruits.
Un score stupéfiant
C’est le 30 octobre 1943 que le Hauptmann Rudel inscrivit son centième char à son tableau de chasse avant d’accrocher, un mois plus tard, les glaives à sa Croix de fer. Au cours des deux premières semaines de 1944, le, I/StG-2 attaqua sans relâche la 67e brigade blindée soviétique dans le secteur de Kirovograd, où plusieurs Panzerdivisionen de la 1ère armée allemande étaient encerclées. A lui seul, Rudel détruisit dix-sept chars et sept canons autotractés ennemis.
Les quinze derniers mois de la guerre à l’Est furent marqués par la retraite de plus en plus précipitée des troupes allemandes. Le 20 mars 1944, Rudel, promu Gruppenkommandeur revenait d’une mission au-dessus du pont de Yampol, sur le Dniestr, quand il aperçut un Ju-87 qui avait été obligé de se poser derrière les lignes soviétiques.
Sans hésiter, le Gruppenkommandeur posa son appareil et entreprit de sauver de la capture l’équipage de l’avion en détresse. Son Ju-87.G avait à peine cessé de rouler que des soldats ennemis firent leur apparition et tirèrent dans sa direction. Blessé à l’épaule, Rudel se montra incapable de reprendre l’air.
Accompagné de Hentschel, il décida donc de traverser le Dniestr à la nage pour rejoindre le front, distant d’une cinquantaine de kilomètres. Hentschel coula à pic dans les eaux glacées du grand fleuve. Rudel, lui, eut la chance d’être recueilli par des soldats de la Wehrmacht.
Malgré sa blessure, il reprit tout de suite du service et, le 29 mars, se vit conférer la plus haute distinction allemande, la dignité de chevalier de la Croix de fer avec diamants. Le l er juin, son palmarès s’établissait à trois cent un blindés, dont soixante-dix-huit détruits à la bombe et deux cent vingt-trois au canon de 37 mm. Deux jours plus tard, Goering en personne lui remettait l’insigne en or des pilotes avec diamants.
Le 19 août, touché par la défense antiaérienne soviétique au-dessus de la Courlande, Rudel dut atterrir dans les avant-postes allemands avec une blessure légère à la jambe. Le 1 er septembre, il apprenait sa nomination au grade d’Oberstleutnant et devenait Geschwaderkommodore du SG-2.
Trois jours avant la Noël 1944, alors qu’il venait d’effectuer sa deux mille quatre centième sortie et d’être crédité de son quatre cent soixante-troisième char russe, il fut convoqué au GQG de la Wehrmacht, où, devant l’amiral Donitz, le Reichsmarshall Goering et tout le grand état-major allemand, Hitler le fit Oberst et lui décerna la Croix de fer avec feuille de chêne en or, distinction qu’aucun Allemand n’avait encore reçue.
Mais la chance tourna : le 8 février 1945, alors qu’il attaquait des chars lourds Staline, un éclat d’obus de 40 mm l’atteignit à la jambe droite. Au bord de la syncope, perdant son sang en abondance, Rudel, encouragé par son mitrailleur, Ernst Gadermann, réussit à poser son Ju-87.G dans les lignes allemandes.
Transporté de toute urgence dans un hôpital de la Waffen SS, il dut y subir l’amputation d’un pied. En dépit de ce lourd handicap, il poursuivit le combat jusqu’au 8 mai 1945, date à laquelle il se rendit aux Américains sur l’aérodrome de Kitzingen.
A la fin du conflit, Hans Ulrich Rudel était crédité du score stupéfiant de cinq cent dix-neuf chars, cent cinquante canons autotractés, quatre trains blindés et sept cents véhicules de toutes sortes. En outre, il avait envoyé par le fond deux croiseurs et un destroyer et détruit sept chasseurs et deux 11-2 soviétiques. Lui-même avait été abattu trente fois et blessé à cinq reprises.
CHUTE LIBRE DE 6000 MÈTRES

Alkemade Nicholas 1923-1987 Sergent / Mitrailleur – Squadron 115 RAF
De toutes les anecdotes que compte l’histoire de l’aviation, la mésaventure du Sergent Alkemade et de quelques autres miraculés sont de loin les plus extraordinaires que l’on puisse imaginer. Plus ou moins bien documentées, toutes ces histoires témoignent de la chance extraordinaire dont bénéficièrent les auteurs de ces chûtes libres de plusieurs milliers de mètres qui, dans la plupart des cas évoqués si après, se terminèrent seulement par des blessures légères. Mais avant d’aborder en détail le récit de ces histoires extraordinaires, voyons en quelques mots les conditions auxquelles ces chuteurs involontaires sont exposés.
La vitesse maximale à laquelle tombe un corps peut être calculée à l’aide de formules mathématiques complexes qui intègrent le poids du chuteur, sa surface (et donc la résistance qu’il oppose à l’air selon sa position), la densité de l’air, etc. Plus simplement des études réalisées en 1943 aux États-Unis ont permis de calculer que si un parachutiste de l’époque d’environ 85 kg mettait 24 minutes pour franchir 40 000 pieds (soit 13 000 mètres) à la vitesse moyenne d’environ 23 km / h, un chuteur libre ne mettait que 3 minutes pour franchir la même distance à la vitesse de 176 km / h.
Enfin, la vitesse maximale étant atteinte au bout de 14 seconde de chute (soit une distance d’environ 550 m) ceci veut tout simplement dire qu’une chute de 5000 m ne présente potentiellement pas plus de risque qu’une chute de 500 mètres en terme de vitesse finale à l’impact.
Ceci étant dit, étudions maintenant en détail le cas de nos miraculés.Alors qu’il se prépare pour sa treizième mission de bombardement sur l’Allemagne, le sergent Nicholas Alkemade est un peu nerveux.

Poste de mitrailleur de queue du Lancaster.
À peine âgé de 20 ans, il est mitrailleur dans la RAF et vole sur Lancaster au sein du Squadron 115. S’occupant du poste arrière, son rôle est primordial au cours de ces missions de nuit où la menace vient principalement de la Flak et des chasseurs de la Luftwaffe qui, en ce début d’année 1944 sont particulièrement bien organisés, dotés de radars performants et d’une puissance de feu redoutable suffisante pour abattre un bombardier lourd en une seule rafale d’obus de 20 et 30 mm. Isolé dans sa bulle de Plexiglas, il doit scruter le ciel en permanence afin de pouvoir tirer le premier en cas d’alerte.
Compte tenu de l’étroitesse de la tourelle arrière qui se compose de 4 mitrailleuses défensives Browning et de leurs munitions, la position est très inconfortable. Isolé du reste de l’équipage par une longue carlingue encombrée et difficile d’accès, le mitrailleur arrière peut toutefois communiquer par le biais de l’intercom, la radio du bord. La place est tellement réduite dans la tourelle que même le parachute est accroché aux flancs de la carlingue, en arrière de la tourelle. Outre le froid extrême qui règne à 6000 mètres (40° de moins qu’au niveau du sol), et les habituels barrages d’artillerie antiaérienne, les douze premières missions réalisées à bord du S comme Sugar se sont bien passées.
En ce 24 mars 1944, la température est particulièrement glaciale et le Squadron 115 a perdu un peu de temps au cours de son survol de l’Allemagne, essuyant le tir nourri de la Flak au-dessus de Francfort.
Éclairée par les Pathfinder (éclaireurs) la ville de Berlin s’apprête à passer une nouvelle nuit sous les bombes des 300 appareils envoyés ce soir là pour tenter de détruire de nouveaux objectifs stratégiques. Arrivé sur l’objectif qui lui a été assigné, l’équipage largue ses 2 tonnes de bombes explosives et ses 3 tonnes de bombes incendiaires avant que le pilote Jack Newman ne donne l’ordre magique du retour. A peine ont-ils amorcé le retour qu’une violente explosion secoue le Lancaster suivie par l’impact de projectiles. Atteignant l’avant dans un premier temps, la rafale déchire le fuselage avant d’atteindre la tourelle arrière dont le Plexiglas est troué par les balles.

Dessin représentant le sergent Alkemade Nicholas hors de l’avion en flamme
Indemne, Alkemade voit alors l’assaillant, un Junker Ju 88 isolé qui vole à 45 mètres à peine du Lancaster et qui se place en position de tir pour achever sa proie. Ripostant immédiatement, Alkemade parvint à toucher et à faire exploser le moteur droit du chasseur Allemand qui abandonne le combat en tombant. Euphorique d’avoir ainsi remporté sa première victoire aérienne, Alkemade est cependant rapidement rappelé à la réalité. La situation n’est pas brillante. Le feu qui s’est déclaré se propage dans la carlingue où se trouve son parachute. Au même moment, Alkemade entend le pilote qui donne l’ordre d’évacuation de l’appareil. Ouvrant la porte arrière de sa tourelle pour accéder au fuselage il découvre avec horreur que son parachute est la proie des flammes.
Comprenant immédiatement la gravité de la situation, Nicholas Alkemade déclarera plus tard avoir ressenti son estomac se décrocher de son corps en s’apercevant qu’il allait mourir. Malgré la situation, il reste calme et prend alors la décision qu’il ne périrait pas dans les flammes mais qu’il préférait une mort rapide et propre en se jetant dans le vide. Retirant son masque à oxygène déjà en partie fondu, il fait alors pivoter la tourelle de manière à placer l’orifice de la porte arrière restée ouverte face au vide et bascule dans la nuit Immédiatement, la terreur qui l’envahissait laisse la place à un sentiment de grande tranquillité et de calme. Ne ressentant pas la sensation de la chute, il a l’impression d’être couché sur un nuage et de se laisser porter, lui donnant le sentiment que la mort est finalement moins désagréable que l’idée qu’il s’en faisait.
Ayant calculé le temps qu’il lui faudrait pour atteindre le sol, il sait qu’il ne lui reste plus que 90 secondes à vivre. Dans l’intervalle, il pense à cette prochaine permission, prévue dans une semaine et qu’il ne prendra pas, de même qu’il ne reverra pas sa fiancée, Pearl. Couché sur le dos, il observe les étoiles, ayant une dernière pensée pour la bestialité de cette guerre, avant de perdre connaissance. Ne comprenant pas pourquoi il ressentait une telle sensation de froid, Alkemade croit tout d’abord être mort. Ouvrant un oeil, il aperçoit une étoile qui brille entre les sapins enneigés. Regardant sa montre, il note qu’il est 3 heures 10 du matin. Il est donc resté 3 heures inconscient, mais vivant. Dieu du ciel s’écrit-il alors, je suis vivant.
Ralenti dans un premier temps par les sapins, les 45 cm de neige qui recouvrent le sol ont fini d’amortir la chute, permettant ainsi au miracle de s’accomplir. Non seulement il était vivant après une chute de 6000 mètres mais l’analyse rapide de son état de santé ne semblait pas laisser apparaître de lésions grave en dehors d’une vive douleur au genou droit et de nombreuses ecchymoses et de quelques coupures et brûlures subies alors qu’il était encore dans le Lancaster. La douleur de son genou l’empêchant de marcher, il se résout alors à son futur sort de prisonnier. Commençant à souffrir du froid, il fait alors usage de son sifflet pour appeler de l’aide et ne pas mourir bêtement de froid. Alertés par les sifflements un groupe de Volkssturm finit par le retrouver fumant tranquillement une cigarette.
Ramassé sans vergogne, Alkemade manque de s’évanouir tant la douleur au genou est intense. Conduit à l’hôpital, il tente alors d’expliquer au médecin son aventure. Le prenant pour un fou, le médecin ne porte aucun crédit à son histoire. Transféré au Luft Stalag de Francfort, il subit trois interrogatoires et placé en isolement devant son insistance à répéter son histoire que bien sur, personne ne veut croire.
Pour les autorités Allemandes, les mensonges évidents d’Alkemade le désignent alors comme un espion potentiel. Maintenant son histoire, Alkemade parvient finalement à persuader le Lieutenant Hans Feidal, de la Luftwaffe, de se rendre sur les lieux du crash du S comme Sugar et de voir si des restes du parachute avaient subsisté, permettant ainsi d’attester sa version des faits. Découvrant les restes calcinés du parachute, les Allemands doivent finalement admettre que celui-ci n’a pas été utilisé et que la version d’Alkemade, aussi incroyable puise-t-elle paraître était bonne.
Ses compagnons du Stalag lui remettront plus tard une bible dans laquelle il est écrit que les recherches conduites par les autorités allemandes permirent de vérifier les déclarations du Sergent Alkemade, numéro matricule 1431537 de la RAF, qui a effectué une chute de 6000 mètres sans parachute et qui est tombé sur des sapins et dans la neige sans souffrir de blessure.
Libéré en 1945, il travaille après-guerre dans une usine de produits chimiques à Loughborough. Un jour, une poutre d’acier de 100 kg lui tombe dessus. Secouru par ses collègues qui le croient mort, il s’en sort avec une blessure superficielle à la tête. Une autre fois, il reçoit d’importantes projections d’acide sulfurique mais s’en sort encore indemne. Une autre fois, c’est une décharge électrique de forte intensité qui manque de le tuer. Une autre fois, il respire pendant plus d’une heure du chlore et s’en sort encore indemne. Finalement, il meurt le 22 juin 1987, à l’âge de 63 ans.
Pendant le dernier conflit, Bornes Wallis, dessinateur de prototypes d’avions, cherche un moyen de hâter la victoire de son pays, l’Angleterre. Comment atteindre les points vitaux de l’industrie allemande, les barrages? L’opinion de Barnes – contre l’opinion de tous les experts est qu’il faut de plus grands avions porteurs de bombes plus lourdes. Il se met au travail, accumule calculs, observations. Il lui faut convaincre les spécialistes qui le tiennent pour fou depuis qu’il parle de bombes de 10 tonnes. Barnes ne se décourage pas.
Après expériences, le chef d’État-Major de la R.A.F. approuve le projet dont Churchill se montre enthousiaste. Les Lancaster étaient nés, porteurs de bombes sismiques lourdes qui firent sauter le barrage de la Moehne, dévastèrent la Ruhr et détruisirent la base de Peenemünde.
Si les exploits de la R.A.F. étaient connus dans leur ensemble, cet ouvrage apporte des détails précis et nouveaux sur les opérations dans un secteur particulièrement spectaculaire, et d’une importance décisive pour l’issue de la guerre. Les briseurs de barrages est un ouvrage tout à fait digne de compléter la série des aventures aériennes inaugurées par le Grand Cirque. On ne le lira pas moins passionnément.
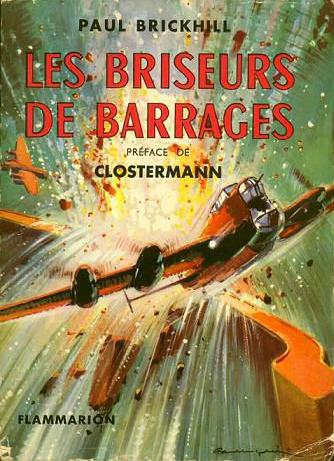
Les briseurs de barrages Paul Brickhill Flammarion 1954
Fils et petit-fils de journalistes, Paul Brickhill est né à Melbourne, en Australie, le 20 décembre 1916. II y fait ses études de Lettres et devient rédacteur au Sun de Sydney dès 1935.
En 1940, il s’engage dans la Royal Australian Air Force. D’abord pilote de chasse en Angleterre, il part pour le Moyen-Orient, avec son escadrille, en 1942. Le 17 mars 1943, son Spitfire est abattu sur la ligne de Mareth, en Tunisie. Grièvement blessé, Brickhill ne parvient à dégager son parachute, accroché au cockpit de l’avion en perdition, qu’à quelques mètres du sol.
Tombé dans les réseaux de barbelés ennemis, il est envoyé en captivité en Allemagne, au Stalag Luft III. Il entre alors dans l’ Organisation X d’évasion. Pendant un an, il travaille avec six cents camarades à la réalisation du projet qui aboutit à la plus grande évasion de groupe de toute la guerre. Mais la plupart des évadés sont repris et fusillés.
Peu avant la fin des hostilités, l’avance de l’Armée britannique lui apporte la libération. Attaché au bureau londonien du Sun, il profite de son séjour en Angleterre pour réunir les matériaux nécessaires à la rédaction de ses deux fameux récits de guerre : La grande évasion et Les briseurs de barrages.

Les lancasters à l’assaut du barrage
Briseurs de barrages
Après avoir guidé la formation qui, le 16 mai 1943, détruisit les barrages de la Ruhr, Guy Penrose Gibson devint le pilote de bombardement le plus célèbre de la RAF. Des cinquante et un aviateurs qui ont reçu la Victoria Cross, le Wing Commander Guy Gibson reste sans doute le plus célèbre. En trois ans et demi de service actif, cet officier effectua pas moins de soixante et onze missions de bombardement et une centaine de sorties de chasse.
Même après le raid sur les barrages allemands qui le porta au sommet de la gloire, Gibson continua à se battre jusqu’à la mission qui lui fut fatale, alors qu’il aurait pu finir tranquillement la guerre dans un bureau de l’Air Ministry.
Né à Simla, aux Indes, le 12 août 1918, Guy Gibson était encore enfant quand ses parents vinrent s’installer en Angleterre. Il fit ses études à Oxford et dans le Kent, puis, passionné par l’aviation, s’engagea en 1936 dans la Royal Air Force.
Ayant passé son brevet de pilote et achevé son entraînement, il fut affecté, un an plus tard, au Squadron 83, basé à Scampton. D’abord dotée de biplans de bombardement Hawker Hind, cette unité perçut des Handley Page Hampden à partir de septembre 1938. C’était l’année de Munich, et la RAF s’équipait activement en vue d’un conflit qui paraissait inéluctable.

Guy Gibson (quatrième au premier plan à partir de la gauche) avec des membres du Squadron 106. Pendant les six premiers mois de 1942, cette unité vola sur Avro Manchester.
Pilote de bombardier et de chasseur de nuit
Le samedi 3 septembre 1939, au moment de l’ouverture des hostilités, l’unité de Gibson fut désignée pour bombarder des unités navales allemandes. Mais les Hampden ne découvrirent pas leur objectif et durent se délester de leurs bombes en pleine mer. Gibson accomplit sa deuxième sortie opérationnelle sept mois plus tard, le Squadron 83 ayant reçu pour mission de mouiller des mines dans les eaux allemandes. Lorsqu’il quitta cette unité pour aller exercer des fonctions d’instructeur aux 14th et 16th Operationnal Training Units, Gibson était titulaire de la Distinguished Flying Cross (DFC). Ayant très vite demandé à reprendre du service actif, il obtint le 13 novembre d’être muté au Squadron 29 de chasse de nuit, basé à Digby et opérant sur Bristol Beaufighter.
Dès le 10 décembre 1940, Gibson survola le territoire allemand, mais c’est seulement le 12 mars 1941 qu’il enregistra son premier succès, en abattant un bombardier ennemi au-dessus de Skegness. Deux nuits plus tard, il détruisait un Heinkel He-111. Il remporta d’autres victoires aériennes le 7 mai, le 6 juillet et le 21 octobre de la même année. Durant cette période d’activité intense, Guy Gibson remplit une centaine de missions, qui lui valurent une palme à sa DFC. Depuis la fin du mois d’août 1940, il avait détruit trois appareils ennemis (plus un Dornier probable) et en avait endommagé trois autres.
Il quitta alors le Squadron 29 et fut nommé chef instructeur à l’OTU 51 de Cranfield, fonction qu’il remplit jusqu’en avril 1942. A cette date, il passa au Squadron 106, de Coningsby, une unité de bombardement équipée d’Avro Manchester, qui devait par la suite être transformée sur quadrimoteurs Lancaster.
Pendant les onze mois qui suivirent, Gibson participa à de nombreuses missions sur l’Allemagne et l’Italie, et, quand il fut nommé à la tête de son unité, il fut décoré du Distinguished Service Order (DSO).
Le 16 mars 1943, au lendemain d’un raid au-dessus de l’Allemagne, Gibson fut invité à se présenter au poste de commandement du groupe de bombardement dont faisait partie le Squadron 106. Là, on lui demanda de prendre le commandement d’une opération d’un type très particulier, sans lui préciser de quoi il s’agissait.
Gibson accepta sur-le-champ et reçut carte blanche pour former le plus vite possible un nouveau squadron. C’est ainsi que, le 21 mars 1943, fut constitué le Squadron 617; neuf jours plus tard, la London Gazette annonçait que Gibson venait de recevoir une palme à son DSO.

Moment de détente entre deux missions. Gibson arbore sur son uniforme le ruban rouge de la Victoria Cross, qu’il avait obtenue pour la destruction des barrages de la Ruhr.
La sélection de l’équipage
Après avoir soigneusement sélectionné ses équipages, Gibson apprit quel était le but de la mission pour laquelle on l’avait ch La RAF avait décidé de détruire les barrages hydro-électriques de la Môhne, de l’Eder, de la Sorpe, de l’Ennepe, de la Lister et de la Schwelme, qui assuraient l’approvisionnement en énergie de tout le complexe industriel de la Ruhr.
La destruction de ces ouvrages devait donc provoquer de graves perturbations dans la production de guerre allemande. Vingt Lancaster furent spécialement aménagés pour emporter sous le fuselage chacun un engin capable de briser le barrage. Ces engins de forme cylindrique, pesant 4 200 kg et contenant une charge élevée d’un puissant explosif (3 000 kg), étaient animés au moment du largage d’un mouvement rotatif puis, une fois lâchés, rebondissaient sur l’eau pour finalement éclater après avoir coulé le long de la maçonnerie.
Un tel résultat ne pouvait cependant être obtenu que dans des conditions très précises, les appareils se trouvant à 18 m d’altitude et à une distance variant entre 365 m et 410 m de l’objectif, la vitesse d’approche ne devant pas excéder 400 km/h.
Pour les équipages, la conjonction de tous ces paramètres n’était pas chose aisée, car l’attaque devait se dérouler de nuit. Gibson et ses hommes durent donc mettre au point des méthodes de bombardement tout à fait nouvelles. Pendant six semaines, ils s’entraînèrent à voler au-dessus des lacs britanniques, frisant à chaque fois la catastrophe tant leur altitude était faible. Progressivement, ils s’habituèrent à ces conditions.

Gibson et son équipage montent à bord du Lancaster B Mk-III du (Dam’s Raid).
Le 16 mai 1943, dix-neuf Lancaster du Squadron 617 prenaient l’air en trois formations séparées. L’opération « Chatside » avait débuté à 21 h 30. Gibson commandait personnellement neuf appareils. Il mit le cap sur la Sorpe, tandis que d’autres bombardiers se dirigeaient vers le barrage de la Môhne.
Un troisième groupe était maintenu en réserve. Malgré le feu de la Flak, Gibson guida chaque avion contre l’objectif. Les barrages de la Môhne et de la Sorpe furent complètement détruits, ce qui lui valut d’être décoré de la Victoria Cross. En août 1943, le Wing Commander quitta le Squadron 617 pour participer, en compagnie de Winston Churchill, à la conférence de Québec.
Après un voyage aux États-Unis, où il fut comblé d’honneurs, Gibson fut affecté à un emploi de bureau à l’Air Ministry, et un parti politique lui proposa de se présenter aux élections à la Chambre des communes. L’aviateur refusa. Souffrant de sa situation sédentaire, il ne pensait qu’à reprendre la tête d’une unité combattante, écrivant lettre sur lettre à l’Air Marshal Harris, chef du Bomber Command. Ce dernier finit par se laisser fléchir et autorisa Gibson à prendre part, comme Master Bomber, à une attaque de nuit contre Rheydt et Mônchengladbach.
Le raid était considéré comme peu dangereux et, effectivement, les pertes furent légers. Mais parmi les disparus figuraient Gibson et son coéquipier Warwick. Dans la nuit du 19 septembre, le Mosquito B Mk-XX que pilotait le brillant officier s’était écrasé au sol. Les Allemands ne purent identifier que Warwick.
Ils enterrèrent donc les deux corps sous la même croix, portant le nom du compagnon de Gibson. C’est seulement après la guerre que la Commission des tombes de guerre britannique lui donna une sépulture sur laquelle figurait son identité.
LES BRISEURS DE BARREAUX
Février 1944. But de la mission:
Ouvrir des brèches pour permettre une évasion. Le rôle des Mosquito consistait à bombarder les murs d’enceinte de la prison et certains bâtiments intérieurs, généralement occupés par les gardiens allemands et la direction. Une action de bombardement de ce style exigeait une précision absolue: quelques mètres ou quelques secondes d’erreur de la part des équipages des bombardiers et c’était le massacre général des patriotes français au lieu de la liberté promise.
Cette action avait été réclamée par le Maquis, comme l’ultime tentative susceptible de sauver d’une mort certaine les prisonniers aux mains de la Gestapo. Lorsque la RAF reçut cette étonnante requête, elle émit immédiatement des réserves quant à la possibilité de réussir un bombardement aussi précis; le risque de tuer les gens qu’il fallait sauver paraissait inévitable. Réussir cette mission supposait qu’il fallait placer les bombes au mètre près sur des points précis de l’édifice, déterminés de manière à faciliter l’évasion finale.
Techniquement, cela signifiait que les avions allaient devoir voler à 5 m d’altitude, larguer leurs bombes sans marge d’erreur et remonter immédiatement pour franchir les murs de la prison, hauts de 20 m. De plus, les intervalles séparant les appareils devaient être absolument respectés. Enfin, la mission, qui portait le nom de code (Jericho), ne pouvait en aucun cas être renouvelée.
La tâche revint au Wing 140 du 2nd Group de la RAF, dont tous les équipages, dès l’annonce de la mission et malgré les risques encourus, se portèrent volontaires. Plusieurs fois reporté en raison des conditions atmosphériques, le raid fut décidé le 18 février 1944. Le briefing rassembla les équipages choisis très tôt le matin. Trois formations de six Mosquito, menés par les hommes les plus expérimentés des Squadrons 21, 464 et 487, étaient prévues.

Peu avant le raid sur Amiens, P.C. Pickard, responsable de l’opération (à gauche), et son navigateur, J.A. Broadley. Tous deux devaient y trouver la mort.
Un appareil isolé appartenant au service cinématographique allait suivre toute l’opération pour en filmer les résultats. La première vague comprendrait deux groupes de trois Mosquito du Squadron 487, néo-zélandais, suivis de deux groupes de trois avions du Squadron 464, australien, tandis que les appareils du Squadron 21 étaient maintenus en réserve pour achever les destructions le cas échéant.
Le cerveau et en même temps le responsable de l’opération était un Group Captain grand et blond, sur la brèche depuis près de quatre ans: Percy Charles Pickard (OSO, OFC). La conduite du raid et la navigation étaient entre les mains de l’ami inséparable de Pickard, le Flight Lieutenant J. A. Broadley (OSO, OFC, OFM). Ce devait être leur dernière mission, car ils trouvèrent la mort à Amiens. Le Mosquito (photo) OZ 414 codé (O) (Orange), piloté par Tony Wickham, devait suivre la deuxième vague au-dessus de la prison pendant que Pickard survolerait l’objectif pour décider si le Squadron 21 devait ou non intervenir.
Pour contrer une éventuelle intervention de la Luftwaffe, une escorte de douze Hawker (Typhoon) du Squadron 198 accompagnerait les Mosquito. La tâche des Néo-Zélandais consistait à ouvrir des brèches dans les murs extérieurs de la prison, au niveau du sol et en deux endroits; celle des Australiens à ouvrir le bâtiment principal, placé au centre de l’ensemble, en détruisant le corps de garde allemand. L’intervalle entre les deux attaques ne devait pas excéder trois minutes. Chaque Mosquito emporterait deux bombes HE de 225 kg, à fusée réglée avec onze secondes de retard. Les équipages eurent deux heures pour étudier une maquette de la prison et de ses environs et calculer les angles d’attaque, les hauteurs, les obstacles, les positions de OCA et les itinéraires de dégagement. Les deux vagues reçurent explicitement l’ordre de regagner leur base immédiatement, une fois les bombes larguées.
Les équipages rejoignirent leurs avions et, à 10 h 30, les dix-neuf Mosquito étaient rassemblés en bout de piste sur la base de Hunsdon, dans l’attente de l’ordre de décoller, qui leur fut donné à 11 heures.

Avant la mission, les équipages eurent deux heures pour étudier cette maquette de la prison d ‘Amiens, aujourd’hui conservée à l’Imperial War Museum de Londres
L’heure militaire
Le raid était calculé pour que l’attaque fût déclenchée à 12 h 3 précisément, heure prévue du largage des bombes des Néo-Zélandais. L’un des participants a raconté; Nous avions tous décidé de faire tout cc qui était en notre pouvoir pour réussir cette mission. Je me rappelle que le Group Captain Pickard exprima tout haut ce que tout le monde pensait tout bas:
Dites-vous que c’est pile ou face. Si nous réussissons, ce sera l’une des plus importantes opérations de la guerre. Et même si vous ne faites plus rien, vous pourrez toujours dire que c’était bien le plus beau boulot que vous ayez accompli. En sortant, le temps nous apparut toujours aussi exécrable. Terrible même!
La neige tombait toujours en tourbillons épais qui masquaient ou démasquaient la piste. Très certainement, une opération ordinaire aurait été décommandée dans des conditions pareilles. Nous sommes montés dans les avions, nous avons fait chauffer les moteurs, en pensant que ce n’était pas un temps pour voler. Quand nous avons vu notre commandant embarquer dans son avion, nous étions sûrs d’y aller. Les dix-huit appareils décollèrent rapidement l’un après l’autre, et peu après 11 h du matin nous étions en route pour attaquer la prison au moment précis où les gardiens seraient à la Soupe.
Février 1944
Un petit groupe de bombardiers De Havilland (Mosquito) décolle, avec le plein de bombes, pour une mission inhabituelle: sauver des vies humaines. Objectif: la prison d’Amiens, où les Allemands détiennent une centaine de membres de la Résistance, dont beaucoup sont à la veille d’être exécutés. Sur les dix-huit avions, deux Mosquito du Squadron 21 puis deux du Squadron 464 quittèrent la formation, pour regagner leur base sur incidents de vol causés par les mauvaises conditions atmosphériques. Le Flying Officer Sparks poursuit ainsi son récit: « Le temps d’atteindre une trentaine de mètres d’altitude, et je ne vis plus rien qu’une soupe grise, brumeuse, la neige et la pluie frappant le plexiglas de l’habitacle.
Il était impossible de se mettre en formation ou d’y rester, et je volais droit vers la côte de la Manche. A 3 km au large, le temps était magnifiquement clair, et quelques minutes après nous étions au-dessus de la France. Nous suivions la côte à l’altitude zéro. Nous avons contourné Amiens par le nord avant de nous disposer en formation d’attaque.

Quelques prises de vues du raid sur la prison d’Amiens.
Comme à la parade
Mon avion, avec celui du Wing Commander et un autre, resta en formation pour la première attaque; notre travail consistait à percer le mur d’enceinte à l’est. Nous avions pris la route d’Albert à Amiens comme repère; elle est toute droite et nous mena directement sur la prison. Je me souviendrai toujours de cette longue route rectiligne et couverte de neige.
Elle était bordée de hauts peupliers et nous volions tous les trois si bas que je devais incliner mon avion pour ne pas toucher la cime des arbres. Alors que je pilotais avec un reil sur les peupliers et l’autre sur la route, l’escorte de chasseurs se rappela à mon bon souvenir. Un Typhoon me croisa juste devant et je manquai d’être arraché de mon siège. Puis, les peupliers s’effacèrent d’un coup et la prison apparut à 1 500 m devant. Elle ressemblait exactement à la maquette. Nous fûmes dessus en quelques secondes.
Nous serrions le sol au maximum et le moins vite possible. Nous larguâmes nos bombes à la base des murs et passâmes au-dessus; pour nous, c’était fini. Il ne s’agissait pas de rester pour voir le résultat. Nous devions dégager tout droit et laisser la place aux autres. En tournant la tête, nous vîmes la deuxième section néo-zélandaise mener son attaque et nous suivre. Le Wing Commander I.S. Black Smith (DFC), patron de la première vague, a raconté l’attaque ainsi: Ma section arriva juste sur le coin du mur est pendant que les autres allaient virer loin pour revenir droit sur le mur nord. La navigation avait été parfaite et je n’avais jamais aussi bien volé. On aurait dit une démonstration.
Nous volions aussi bas et aussi lentement que possible, de manière à larguer nos bombes juste au pied des murailles. Malgré tout, les bombes traversèrent le mur extérieur et la cour intérieure pour exploser de l’autre côté. Je larguai les miennes à 3 m d’altitude et tirai ferme sur le manche. L’air était plein de fumée, mais de toutes les bombes lâchées par ma section une seule manqua l’objectif.
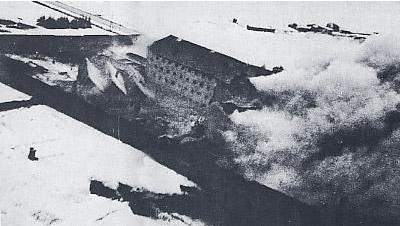
Photo de la prison d’Amien après le raid des Mosquitos
Dans les fenêtres
Dès que les Néo-Zélandais eurent dégagé, le Wing Commander R. W. (Bob) Iredale (DFC) amena ses Australiens sur l’objectif pour la deuxième phase de l’opération: la destruction du corps de garde. Arrivant si bas qu’ils durent sauter le mur d’enceinte pour glisser leurs bombes dans le bâtiment, les Australiens durent traverser l’épais rideau de fumée et de débris qu’avait soulevé la première attaque des NéoZélandais.
En décrivant des cercles autour de l’objectif, Pickard se rendit compte tout de suite que la mission était un succès: d’énormes brèches dans les murailles livraient passage à des centaines de prisonniers, minuscules silhouettes de fourmis répandues sur la neige audessous de lui. En conséquence, il donna l’ordre au Squadron 21 de rentrer à sa base avec ses bombes inutiles. Pendant ce temps, Wickham entamait sa première passe sur la prison avec son Mosquito photo: Au premier passage, nous avions vu que l’opération était réussie.
Les deux extrémités de la prison étaient complètement détruites et les murs d’enceinte étaient démolis en de nombreux endroits. On pouvait voir un grand nombre de prisonniers qui s’échappaient sur la route. Les appareils installés dans l’avion enregistraient tout ça, et l’opérateur couché dans le nez prenait photo sur photo aussi vite qu’il le pouvait. Il en était si enthousiasmé qu’il réussit à nous faire rester au-dessus de l’objectif plus longtemps que la prudence ne le recommandait.
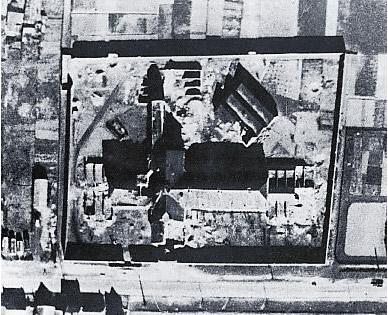
Vue aérienne de la prison d’Amiens après le raid britannique. On remarque en haut, à gauche, la brèche ouverte dans le mur d’enceinte. De toutes les bombes larguées par les avions de la RAF une seule manqua son objectif.
AVIATION 1939-1945 2e partie
LA BATAILLE D'ANGLETERRE
Spitfire au dessus de l'Angleterre en 1940
L’été 1940 est une période sombre pour les forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale. La majorité du continent européen est entre les mains des nazis et Hitler se prépare à lancer une invasion à grande échelle de la Grande Bretagne, mais il doit d’abord dominer l’espace aérien au dessus de la Manche. Pour ce faire, il faut que la Luftwaffe (la Force aérienne allemande) détruise la Royal Air Force.
La machine militaire d’Hitler envahit la France à une vitesse fulgurante. La bataille de France commence le 10 mai 1940 avec l’invasion des Pays Bas et de la Belgique. La Pologne, le Danemark et la Norvège ont déjà capitulé.
En trois jours, les forces allemandes traversent la frontière française et, à la fin de mai, les forces françaises et britanniques sont repoussées jusqu’à la Manche. C’est alors que se produit le (miracle de Dunkerque: du 27 mai au 4 juin, plus de 300 000 hommes réussissent à quitter la France. Les rescapés des plages de Dunkerque embarquent sur des navires militaires et civils de toutes les tailles et de toutes les formes qui font la navette entre l’Angleterre et la France.

La célèbre photo du premier ministre britannique Winston Churchill prise par Yousuf Karsh à Ottawa, en décembre 1941. Churchill fait l’éloge des pilotes de chasse de la bataille d’Angleterre en disant que jamais dans l’histoire des guerres un si grand nombre d’hommes a dû autant à un si petit nombre.
L’Armée de terre doit abandonner une grande quantité de matériel à Dunkerque et fait maintenant face à une pénurie d’équipement. La RAF réussit à garder la majorité des bombardiers et des chasseurs allemands à distance et abat 150 avions. Cependant, elle perd 100 chasseurs précieux et 80 pilotes irremplaçables. Ces pertes aggravent la situation dangereuse dans laquelle se trouvent les forces alliées. Paris capitule le 14 juin, soit huit jours avant que la France signe un armistice avec l’Allemagne.
Quelques jours plus tard, Winston Churchill, le nouveau premier ministre de la Grande-Bretagne, prononce un discours à la Chambre des communes britannique sur la situation critique des Alliés.
La directive no 16
L’opération Lion de mer (Seelöwe), le plan de l’invasion de la Grande‑Bretagne, est en cours d’élaboration depuis un certain temps. Après l’évacuation de Dunkerque et la capitulation de la France en 1940, Hitler s’attend à ce que l’Angleterre soit réaliste et sollicite la paix, affirme Halliday. Cependant, les jours passent et les Britanniques ne donnent aucun signe laissant entendre qu’ils sont prêts à demander la paix, ou même à négocier. Hitler décide donc de lancer l’opération Lion de mer. Ce n’est que le 16 juillet 1940 qu’il établit la directive no 16, rédigée en des termes hésitants, poursuit Halliday.
Étant donné que l’Angleterre ne montre aucune volonté de conclure une entente malgré sa situation militaire désespérée, j’ai décidé de préparer et, au besoin, de lancer une manœuvre de débarquement contre l’Angleterre, écrit Hitler. Cette opération visera à éliminer la capacité du territoire anglais à servir de base pour la poursuite de la guerre contre l’Allemagne et, au besoin, à l’occuper entièrement.
La directive mentionne également que la Force aérienne britannique doit être détruite au point où elle sera incapable d’opposer une force substantielle aux troupes d’invasion. Pour que les Allemands puissent envahir l’Angleterre, la Marine (allemande) doit contrôler la Manche. Pour ce faire, il faut que la Luftwaffe domine l’espace aérien au‑dessus du nord‑ouest de la France, des Pays‑Bas, de la Manche et du sud‑est de l’Angleterre.
Les deux belligérants font face à d’énormes problèmes sans précédent. C’est la première fois de l’histoire qu’une nation tente d’en vaincre une autre grâce à la puissance aérienne. La bataille d’Angleterre est tout à fait nouvelle et une affaire extrêmement serrée, ce qui en fait probablement la campagne la plus intéressante de la Deuxième Guerre mondiale. Ni les Britanniques ni les Allemands ne savent ce qui va se passer. Ils ne savent même pas ce qu’il faudrait pour obtenir les conditions recherchées.
Première étape la bataille de la Manche (Kanalkampf)
La première étape de la bataille commence le 10 juillet et dure un mois. Durant cette période, la Luftwaffe attaque des convois dans la Manche et ses ports. Elle commence aussi à bombarder les stations radars sur la côte sud de l’Angleterre.

Le Lieutenant d’aviation Blair Dalzell (Dal) Russel 1917-2007. Le Lt avn Russel est membre du 1er Escadron (canadien). Il reçoit la Croix du service distingué dans l’Aviation, l’Ordre du service distingué et la Croix de guerre.
Deuxième étape – l’attaque de l’aigle (Adlerangriff)
La deuxième étape, l’assaut principal, comprend de nouvelles attaques sur les radars et des bombardements d’envergure contre les aérodromes afin de détruire la force de chasse de la Grande-Bretagne dans les airs et au sol. Les aérodromes du 11e Groupe, au sud est de l’Angleterre, sont notamment soumis à des bombardements. Le seul escadron de l’Aviation royale du Canada qui participe au combat, le 1er Escadron (canadien) qui sera plus tard renommé le 401e escadron – fait partie du 11e Groupe.
L’assaut principal est lancé le 13 août; le haut commandement allemand l’appelle le jour de l’aigle (Adlertag). La veille, la Luftwaffe endommage sérieusement la chaîne de stations radars du sud, sans la détruire. Stokesbury raconte que, le jour de l’aigle, la Luftwaffe attaque en force : elle bombarde les stations radars, les aérodromes et les usines qui produisent des avions. Elle effectue environ 1 500 sorties, contre approximativement 700 pour les Britanniques.
Le 20 août, au plus fort de l’attaque de l’aigle, Churchill prononce un discours dans lequel il fait l’éloge des aviateurs combattants dans des mots qui trouvent encore un écho plusieurs décennies plus tard. Les attaques se poursuivent tout au long du mois et jusqu’en septembre; la situation du 11e Groupe est désespérée, Toutefois, les Allemands jugent que leurs attaques sur les stations radars ne sont pas utiles au moment même où elles commencent à l’être et ils décident de les interrompre, commettant ainsi une autre erreur fatale.
Troisième étape – le blitz
Le 1er août 1940, Hitler émet la directive no 17, qui stipule que la guerre contre l’Angleterre doit comprendre des attaques contre des industries et des objectifs de la Force aérienne. Toutefois, il se réserve le droit de décider d’effectuer des attaques terroristes à titre de représailles des attaques contre des civils. Plus tard au cours du mois, la Luftwaffe semble avoir l’avantage, mais la bataille d’Angleterre prend un autre tournant inattendu.
Des bombardements ont déjà eu lieu sur des cibles militaires en périphérie de Londres et des docks. Cependant, la nuit du 24 au 25 août, un avion de la Luftwaffe largue par erreur ses bombes sur Londres. Pour riposter, plus de 80 bombardiers britanniques bombardent Berlin. Pendant que le bombardement de Berlin se déroule, Hitler, furieux, annule la directive 17 et ordonne des attaques perturbatrices contre la population et les défenses antiaériennes des grandes villes britanniques, y compris Londres, de jour comme de nuit.
Le bombardement intensif, qui dure 57 nuits, commence le 7 septembre, et la bataille d’Angleterre commence à favoriser les Britanniques. Ironiquement, c’est exactement ce dont les Britanniques avaient besoin. Londres est comme une grande éponge qui absorbe tous les dommages.

Un bombardier allemand Heinkel He III survole Wapping et l’Isle of Dogs dans le quartier East End de Londres au début des bombardements de la Luftwaffe le soir du 7 septembre 1940. Cette photo a été prise par la Luftwaffe et a été réorientée de sorte que le nord est au haut de l’image.
Le changement d’objectifs permet au 11e Groupe au sud‑est de l’Angleterre de réparer ses aérodromes et ses stations radars. En outre, les avions allemands qui se rendent à Londres sont à la portée du 12e Groupe, situé dans les Midlands et à East Anglia. Le dimanche 15 septembre est l’apogée de la bataille selon plusieurs on l’appelle maintenant le jour de la bataille d’Angleterre. Les Allemands déclenchent une attaque massive sur Londres : 123 bombardiers y participent, escortés par plus de 650 chasseurs. La Luftwaffe subit de lourdes pertes, mais elle revient le lendemain. Les combats sont acharnés, mais en fin de compte, les aviateurs alliés sont victorieux.
Douze jours plus tard, la Luftwaffe effectue un dernier grand bombardement diurne sur Londres. Les suivants sont toujours effectués la nuit, et tous les combats aériens d’envergure de jour devront avoir lieu au‑dessus de l’Europe occupée, indique l’histoire officielle de l’ARC. La Luftwaffea manifestement échoué dans sa tentative de détruire la Royal Air Force; deux jours plus tard, Hitler annonce que l’opération Sea Lion est reportée et il disperse partiellement la force d’invasion.
Quatrième étape la fin de la bataille
La suite de la bataille d’Angleterre voit la Luftwaffe effectuer des attaques de bombardiers lourds contre des villes et des raids perturbateurs sur de petites villes et des objectifs militaires, mais les Allemands ont perdu l’initiative. Après la mi‑septembre, l’ampleur des raids diminue considérablement, d’autant plus que les conditions météorologiques commencent à empirer.
Le 12 octobre, Hitler informe officiellement ses chefs de service que l’opération Sea Lion est remise au printemps 1941. Halliday affirme qu’en fait, son esprit et ses énergies se portent déjà vers l’est la Russie et il ne revient jamais à l’opération Sea Lion.
À la fin d’octobre, la bataille d’Angleterre est terminée. Certains historiens disent qu’elle s’essouffle graduellement.
Le blitz se poursuit dans l’espoir de détruire la volonté de combattre des Britanniques. Durant 57 nuits consécutives, les bombes pleuvent sur Londres. Les villes britanniques subissent des bombardements aériens pendant neuf mois.
Selon Halliday, il serait erroné d’affirmer que le commandement de chasse vaincra la Luftwaffe dans le contexte de la bataille d’Angleterre. À la fin d’octobre 1940, les deux ennemis comptent plus d’avions et de pilotes qu’au début d’août. La RAF remporte tout de même la victoire puisqu’elle empêche l’adversaire d’atteindre son objectif l’éradication des défenses aériennes britanniques pour empêcher toute attaque d’avions contre les forces d’invasion.
La Bataille d’Angleterre n’en est pas moins, comme celle de Waterloo, une affaire très serrée. Au début de septembre, (la Luftwaffe) est dangereusement près d’obtenir la supériorité aérienne dans les régions où l’invasion doit avoir lieu. L’ennemi échoue en grande partie parce qu’il surestime les dommages infligés et qu’il change fréquemment ses plans, conclut‑il.
La contribution canadienne
Les aviateurs, que Churchill appelle le petit nombre, comprennent 2 353 pilotes et hommes d’équipage aérien de la Grande-Bretagne et 574 d’outre‑mer. Tous effectuent au moins une sortie opérationnelle autorisée avec une unité admissible de la Royal Air Force ou de l’aéronavale entre le 10 juillet et le 31 octobre. Ils reçoivent l’agrafe de la bataille d’Angleterre en plus de l’étoile 1939‑1945. On retrouve des Polonais, des Néo‑Zélandais, des Canadiens, des Tchèques, des Australiens, des Belges, des Sud‑Africains, des Français, des Irlandais, des Américains ainsi qu’un Jamaïcain, un Rhodésien du Sud et un aviateur du protectorat palestinien. Cinq cent quarante‑quatre d’entre eux perdent la vie.

Le Commandant d’aviation Ernest McNab 1906-1977, commandant du 1er Escadron (canadien) de l’ARC, devant un Hawker Hurricane I à Northolt (Angleterre), le 12 septembre 1940.
On estime que plus de 100 Canadiens participent à la bataille d’Angleterre, dont 23 meurent au combat. Un escadron de l’Aviation royale du Canada prend part à la Bataille : le 1er Escadron (canadien), composé de pilotes d’une unité de la Force régulière et d’une unité auxiliaire, qui est mis en service le 17 août 1940. On l’appelle canadien pour le distinguer du 1er Escadron de la RAF, mais en février 1941, il devient le 401e Escadron.
Trois membres du 1er Escadron (canadien) reçoivent la Croix du service distingué dans l’Aviation en reconnaissance de leurs efforts au cours de la bataille d’Angleterre : le Commandant d’aviation Ernie McNab, son commandant adjoint, le Capitaine d’aviation , et le Lieutenant d’aviation (Dal) Russel.
Les aviateurs du pays combattent également au sein du 242e Escadron canadien de la RAF, qui est composé en grande partie, mais pas exclusivement, de Canadiens. Il est dirigé par le Commandant d’escadron de la RAF Douglas Bader durant la bataille d’Angleterre. (Le Cmdt avn Bader est passé à l’histoire de la Force aérienne, lui qui perd ses deux jambes lors d’un accident de vol en 1931; il réussit à se réenrôler dans la RAF au moment du déclenchement du conflit et il demeure en service jusqu’en 1946. Il est notamment abattu et fait prisonnier de guerre. Il réussit même à s’évader à une occasion.)
De nombreux autres Canadiens sont membres d’autres escadrons de la RAF ainsi que du Bomber Command et du Coastal Command et soutiennent les opérations visant à empêcher l’invasion allemande. Un nombre indéfini font partie du personnel de piste et permettent aux chasseurs de continuer de décoller.
Selon Halliday, le personnel de piste qui assure l’entretien des Hurricane du 1er Escadron (canadien) affronte parfois les feux de l’ennemi et travaille généralement sous pression. Il reçoit une reconnaissance tardive en juin 1942 lorsque le Sergent de section John R. Burdes reçoit la Médaille de l’Empire britannique et que le Sergent de section Cecil M. Gale est cité à l’ordre du jour.

Un rampant non identifié fait le plein d’un Hawker Hurricane I du 1er Escadron (canadien) de l’ARC, le 6 octobre 1940 à Northolt (Angleterre).
Le texte de la citation de Gale mentionne notamment : Travaillant dans des conditions éprouvantes, il maintient l’escadron d’avions avec compétence. En raison de l’activité opérationnelle intensive à la fin d’août et en septembre, l’équipe de maintenance Air doit travailler à plein régime. Souvent, le sergent Gale commence à s’acquitter de ses fonctions très tôt le matin et termine tard la nuit. Il fait en sorte qu’un nombre suffisant d’avions soient prêts à décoller en tout temps.
Le remplacement des pilotes expérimentés constitue un défi de taille tout au long de la bataille, surtout au début. Plus tard, cela devient moins difficile, mais les pilotes s’épuisent et leurs remplaçants ont moins d’expérience. Selon l’histoire officielle de l’ARC, au cours des 10 derniers jours d’août le Fighter Command perd 231 pilotes, c’est‑à‑dire près du quart de son effectif initial, et 60 % de ces pertes sont des aviateurs aguerris qui ne peuvent être remplacés que par des novices à peine sortis des unités d’entraînement opérationnel. Plus le temps passe, moins il y a de pilotes expérimentés qui s’envolent. Pendant que les pilotes prennent de l’expérience sur le terrain, ils ont des chances d’être tués, blessés, épuisés mentalement ou encore promus au sein d’un autre escadron.
La bataille d’Angleterre n’aurait pu être remportée sans la contribution d’un autre Canadien : Max Aitkin, Lord Beaverbrook.
Churchill nomme Lord Beaverbrook, un magnat de l’industrie de la presse, au poste de ministre de la Production d’aéronefs en mai 1940. Il se lance dans une série de changements et d’innovations qui irritent la haute direction du ministère de l’Air, mais qui augmentent considérablement la production de chasseurs pour l’effort de guerre. Il ne tient nullement compte des habitudes agréables de lenteur en temps de paix. Les gestionnaires d’usine et les officiers supérieurs de la Force aérienne en viennent à le détester, mais sans lui, ou quelqu’un de tout aussi acerbe, on peut difficilement voir comment les Britanniques auraient pu résister tout l’été. Il fournit un nombre sans cesse grandissant d’avions, de sorte que malgré les pertes qui dépassent largement 100 % des forces, la RAF est plus forte à la fin de la bataille qu’au début.
Au cours des mois précédant la nomination de Beaverbrook, 256 chasseurs sont produits. En septembre, mois crucial, à l’époque où les pertes de la RAF sont au zénith, le système de Beaverbrook permet de produire 465 chasseurs. Maintenant, devant l’échec imminent du plan nazi d’invasion de l’Angleterre, une autre contribution canadienne essentielle à la guerre aérienne commencera à porter ses fruits. À la fin de la bataille d’Angleterre, les premiers jeunes pilotes, observateurs et tireurs sortent des écoles du Plan d’entraînement aérien du Commonwealth britannique au Canada, explique Leslie Roberts. Ils déferleront bientôt sur le champ de bataille.
Les Canadiens en service

Robert Alexander Butch Barton 1916-2010
Un des derniers anciens combattants canadiens de la bataille d’Angleterre toujours vivant, le Capitaine d’aviation Robert Alexander Butch Barton fait partie des 41e et 249e escadrons de la RAF pendant la bataille d’Angleterre. Il reçoit la Croix du service distingué dans l’Aviation (DFC) en reconnaissance de ses actions durant la bataille d’Angleterre ainsi qu’une barrette à la DFC l’année suivante. Il reçoit également l’Ordre de l’Empire britannique. En 1959, il prend sa retraite à titre de commandant d’escadre de la RAF et revient au Canada.
Il est pour le moins difficile de déterminer avec exactitude combien de Canadiens participent à la bataille d’Angleterre. Selon les sources consultées, il y en aurait 88, 103 ou 112. Une partie du défi est dans le calcul du nombre de Canadiens, parce qu’il y a un problème de définition en ce qui concerne qui était un Canadien en 1940. Toutefois, les sources semblent convenir que 23 Canadiens meurent au cours de cette bataille.
Le tableau d’honneur de la Royal Air Force fait état des personnes qui perdent la vie durant la bataille, de même que celles qui sont tuées ou meurent plus tard pendant la guerre et celles qui survivent jusqu’à la fin du conflit ainsi que les escadrons dont ces membres font partie. Il comprend 88 Canadiens.

Le monument de Londres qui commémore la bataille d’Angleterre porte cependant les noms de 112 Canadiens. Pourtant, le tableau d’honneur de la RAF semble mentionner les noms de trois personnes qui ne figurent pas sur ce monument.
POUR QUELQUES PONTS
En septembre 1944, les unités aéroportées alliées sont sacrifiées à Arnhem en tentant de créer une tête de pont face aux meilleures divisions blindées allemandes. II y a peu d’épisodes plus glorieux que celui d’Arnhem, et vos successeur, auront beaucoup de mal à égaler ce que vous avez fait.

Les parachutistes alliés sautent sur Arnhem. L’opération Market Garden, conçue par Montgomery, fut confiée à la 1ère Armée aéroportée, qui regroupait des éléments américains, britanniques et polonais. Des 36 000 hommes engagés dans la bataille, un tiers ne revint pas.
Tel fut le message que le Field Marshal Montgomery adressa aux hommes qui avaient pris part à ce qui aurait dû être une glorieuse page des opérations combinées alliées et qui ne fut en réalité qu’un tragique exemple d’erreur tactique, de liaisons rompues entre les forces terrestres et aériennes et de carence des services de renseignements.
Essentiellement, la bataille d’Arnhem de septembre 1944 constituait un élément d’une vaste attaque confiée aux troupes terrestres et aux avions de la 1 ère armée aéroportée alliée (sous le commandement du Lieutenant-General L.H. Brereton, qui engagea sa 1 re division aéroportée (Major-General R.E. Urquhart) comprenant la Brigade polonaise, les 82 et 101 divisions américaines ainsi que le 52nd Lowlanders. La RAF détachait les 38th et 46th Groups et les Américains, le IXth Troop Carrier Command (commandement des troupes aéroportées). Le but de l’opération consistait à attaquer et à tenir non seulement Arnhem, mais également Eindhoven, Grave, Nimègue et surtout les ponts sur le Rhin, le Waal et le Lek, ainsi qu’à ouvrir un corridor sur le Zuiderzee. La partie maîtresse de l’opération incombait aux XXXth, XIlth et Vlll th Corps. Le premier, commandé par le Lieutenant-General Brian Horrocks, devait fournir l’effort capital sur l’axe principal, clé de la réussite de cette opération aéroportée.

En vol vers la (Dropping Zone). Les armes et le paquetage sont fixés aux jambes, de façon qu’ils ne se prennent pas dans les sangles du parachute.
Le plan de Montgomery
L’opération (Market Garden) (tel fut son nom de code), essentiellement conçue par Montgomery, supposait la coopération la plus étroite entre les forces aériennes et terrestres britanniques, polonaises et américaines. Inévitablement, il y eut des divergences sur la manière de déployer ces forces, et il n’y avait pas de liaison directe entre les quartiers généraux des formations terrestres et les forces aériennes tactiques, dont l’intervention était vitale. En cas de succès, selon (Monty), la poussée devait ouvrir une route directe vers Berlin, encore qu’aucune réserve stratégique susceptible d’exploiter l’avance ne fût prévue. Enfin, alors que les équipages des bombardiers revenant de missions sur l’Allemagne avaient signalé un accroissement de l’intensité de la Flak dans la région d’Arnhem, les services de renseignements négligèrent le renforcement de l’artillerie dans cette zone ainsi que la présence du Panzerkorps 2.
L’épisode aérien débuta le 17 septembre 1944 et mit en ligne 519 appareils pour les troupes de la 1ère division aéroportée, dont la Brigade polonaise, 530 pour la 82, division et 494 pour la 101 °. Tous les avions américains étaient des Douglas C-47 du IXth Troop Carrier Command, tandis que les forces britanniques comprenaient 149 C-47 américains et 130 C-47 anglais ainsi que 240 bombardiers transformés : des Handley-Page Halifax (la plupart remorquant des planeurs), des Short Stirling et quelques Armstrong WhitworthAlbemarle, qui avaient déjà servi à larguer des parachutistes sur la Normandie en juin. La couverture de chasse était confiée principalement à environ 1200 Spitfire et Hawker Tempest.

Des (rampants) de l’US Air Force observent les C-47 prenant leur formation de vol peu après le décollage pour Arnhem. Outre les 82e et 101divisions aéroportées américaines, les C-47 emmenèrent des troupes britanniques.
L’attaque aéroportée dépendait de l’emploi massif des planeurs, emploi qui avait également soulevé des divergences de vues. Au total, quelque 2 800 planeurs, la plupart britanniques, furent utilisés par les unités, dont le commandement préférait l’Airspeed Horsa, capable de transporter vingt-neuf hommes complètement équipés, et l’énorme Hamilcar, réservé à l’équipement lourd.
Les planeurs américains étaient des Waco CG-4A, plus petits que les Horsa et n’accueillant que quinze combattants équipés. Les chefs américains préféraient utiliser le C-47, susceptible de transporter au moins dix-neuf hommes. On prit donc la décision de confier à la RAF le remorquage des planeurs, tandis que les Américains largueraient les parachutistes en économisant leurs Waco.
La 101 ème division devait dépêcher un régiment parachutiste dans la région de Weghel, au sud-ouest de Grave, et employer le restant de ses forces à établir une tête de pont au nord-ouest de Zon, au-delà d’Eindhoven, en envoyant des détachements vers le nord et le sud pour contrôler les ponts. Pendant ce temps, la 82e devait larguer deux régiments parachutistes, plus des éléments divisionnaires ainsi que cinquante planeurs chargés d’armes lourdes et d’équipements, sur les pentes des collines de Groesbeek; le régiment restant devait quant à lui sauter au nord de la Meuse et à l’est de Grave. La RAF avait choisi une région située au sud du Rhin, proche de la route ArnhemNimègue comme (DZ) (Dropping Zone, zone de largage) pour la 1ère division, et des (LZ) (Landing Zone, zone d’atterrissage) au nord-ouest du fleuve pour les planeurs. 11 devait y avoir trois vagues principales, les 17, 18 et 19 septembre, la première emportant les deux tiers des divisions aéroportées, les deux autres, les réserves et les approvisionnements.
La première décolla à 14 h 30, le 17 septembre, de sept bases britanniques et de dix-sept bases américaines situées en Angleterre. La force la plus petite, constituée de 494 C-47 et de 70 Waco de la 1ère aéroportée, prit une route sud vers Gheel avant d’obliquer à gauche vers ses zones de largage près d’Eindhoven. La force la plus importante, constituée par la 1ère aéroportée et par la 82e division, passa la côte hollandaise au nord avant de faire route vers l’est pour éclater au-dessus de ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), la 82e visant Grave et Nimègue, et la 1ère, Arnhem.
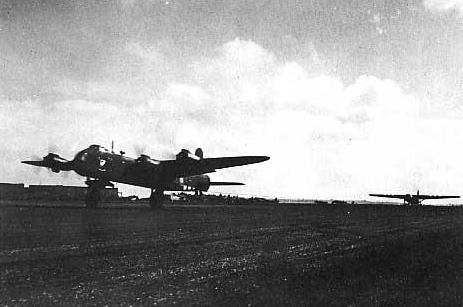
Short Stirling remorquant un planeur Horsa
Une surprise pour rien
La RAF avait insisté pour que l’opération aérienne fût menée dans des conditions de sécurité maximales comme le rapporte Maurice Tugwell dans son ouvrage Airborne to Battle : Se faisant un devoir d’amener les soldats à pied d’oeuvre sans pertes en vies humaines, elle s’efforça d’articuler le plan d’atterrissage en fonction d’une zone restreinte et sûre. Il fallait éviter les zones à forte densité de DCA, les pilotes ne pouvant pas toujours répondre de leurs réactions face à l’intensité de la Flak. Trente-cinq C-47 et seize Waco de la première vague furent détruits, mais aucun transport de troupe à destination d’Arnhem ne fut perdu du fait de l’ennemi. Douze planeurs n’arrivèrent pas pour diverses raisons.
La surprise initiale à Arnhem fut totale, bien qu’à midi, douze Stirling eussent largué une force d’éclaireurs pour marquer les DZ et LZ prévues. Mais un Waco s’écrasa à proximité du quartier général du colonel Kurt Student, commandant une nouvelle grande unité allemande (la 1ère division parachutiste) près de Hertogenbosch. Les Allemands découvrirent alors sur le corps d’un officier américain un jeu complet d’instructions, dont Student comprit l’importance capitale. Moins d’une heure après le début de l’opération, il était déjà en mesure de passer à la contre attaque. Le Panzerkorps SS 2, à Doetinchen, et la Panzerdivision 9, à Deelen, entrèrent rapidement en action contre les Irish Guards en pointe devant le XXXth Corps, lancé sur Arnhem, alors que deux cents chasseurs bombardiers Typhoon armés de roquettes attaquaient les positions antichars qui faisaient obstacle à leur progression.

Des hommes de la compagnie de commandement de la 1ère division d’artillerie aéroportée commencent à décharger leur matériel des deux premiers Horsa ayant atterri à Arnhem.
Peu à peu, au fil des jours, le plan commença à craquer du fait des conditions atmosphériques et d’une farouche résistance autour d’Arnhem. La chasse allemande, constituée principalement de Force-Wulf 190 et de Messerschmitt Bf-109, abattit un grand nombre de C-47 et de planeurs. Au cours des quatre premiers jours, l’aviation alliée effectua plus de 4000 sorties d’avions et 2 800 sorties de planeurs. Les transports de la RAF affrontèrent une Flak intense et perdirent cinquante-cinq appareils.
Le 21 septembre, on songea à utiliser une piste en herbe près de Grave pour permettre aux C-47 d’évacuer les blessés. Le 25, la bande aménagée permit 209 mouvements d’avions sans incidents, mais le lendemain aucun atterrissage ne put avoir lieu, le 83rd Group ayant réclamé cet aérodrome pour ses chasseurs bombardiers. Le rapport du ler corps aéroporté précise même : Il faut remarquer qu’à aucun moment le 83rd Group ou la 2nd Tactical Air Force n’ont été en liaison directe avec les corps aéroportés, pas plus qu’ils n’ont répondu aux offres des officiers de ces unités de leur préparer des pistes d’atterrissage pour leurs avions de chasse.
Le 83rd Group de la RAF fut âprement critiqué dans ce rapport, qui démontra que son soutien tactique avait été (négligeable) jusqu’au 23 septembre. Cela tenait en partie aux conditions atmosphériques, mais surtout au fait que les appareils de cette unité étaient interdits de vol au-dessus de la zone des combats pendant les périodes choisies pour les parachutages de troupes ou d’équipements, c’est-à-dire, pendant la majeure partie de la journée.
Vers le cinquième jour de la bataille, Urquhart sut que la situation était désespérée et que ses troupes risquaient d’être cernées dans la ville d’Arnhem ou autour. Les Alliés purent tenir les ponts pendant un certain temps, mais les divisions blindées ne parvinrent pas à percer jusqu’à eux. Le mauvais temps empêchait toujours de recevoir la totalité du ravitaillement espéré.

L’aire d’atterrissage Z paesemée de planeurs. Certains ont été brisés pour décharger le matériel, d’autres ont eu les extrémitées des ailes arrachées à l’atterrissage.
La 1ère division reçut l’ordre de se retirer sur la rive gauche du Lek. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, 2 163 hommes exécutèrent le mouvement. C’étaient les survivants des 8 900 officiers et soldats et des 1 100 pilotes de planeurs qui avaient combattu côte à côte. La Brigade polonaise laissa 1 000 hommes dans l’opération; la 82e division eut 1 669 tués, blessés ou disparus, et la 101e, 2074. Le tiers des 35000 hommes engagés dans cette (épopée) ne revint pas.
NANTES SOUS LES BOMBES
Du 27 juillet 1940 au 2 août 1944, Nantes subit 28 attaques aériennes. Les 16 et 23 septembre 1943, Nantes subit deux attaques aériennes particulièrement dramatiques, effectuées par des unités américaines. Entre 1000 et 1500 bombes sont larguées visant, en principe, les infrastructures portuaires et industrielles.
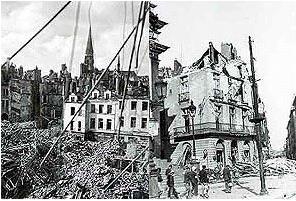
La ville de nantes partiellement détruites par les bombardements alliés
Les 16 et 23 septembre restent et resteront encore longtemps pour les Nantais des dates synonymes de cauchemar et de douleur. Des centaines de bombes ravagèrent la ville de Nantes, faisant 1 463 victimes et 2 500 blessés. 700 maisons et immeubles sont détruits et près de 3 000 inhabitables. Beaucoup d’interrogations seront soulevées après la libération de la ville, le 14 août 1944. Pourquoi un tel déluge de feu et d’acier s’est-il abattu sur Nantes ? Pourquoi l’aviation anglaise et américaine s’est-elle acharnée sur la cité des ducs ? Ces raids étaient-ils un sacrifice nécessaire pour vaincre l’occupant ? Quels étaient les objectifs assignés à ces déferlantes aériennes ? Cette stratégie qui consiste à lancer des offensives de bombardiers lourds sur des cibles économiques, industrielles et militaires est, aux yeux de Churchill et du commandement allié le moyen de mettre fin au conflit avec l’Allemagne nazie.

Photo du centre ville de Nantes
Nantes constitue un objectif de choix avec son port et ses chantiers navals, ses industries et sa place dans le dispositif militaire allemand. A partir de 1941, des bombardements sporadiques frappent Nantes et la zone portuaire. Le raid le plus spectaculaire a lieu le 23 mars 1943 lorsqu’une escadrille composée de 11 bombardiers de type Mosquitos détruisent une partie de l’usine des Batignolles qui produit des locomotives pour le front de l’Est. Les ouvriers, prévenus trop tard, compteront 33 morts. Mais comparée à Saint-Nazaire, avec sa base sous-marine, la ville de Nantes est encore relativement épargnée. En 1943, cette impunité prend tragiquement fin les 16 et 23 septembre. Les bombes américaines des unités de la 8° Air Force, commandées par le général Travis, vont ravager Nantes. Le bombardement est décidé après une intense période de raids sur l’Allemagne au cours de laquelle l’aviation américaine avait subi de lourdes pertes. La 8° Air Force tente de mettre à profit ce répit pour se réorganiser et incorporer de nouveaux équipages, peu aguerris. Des missions moins meurtrières sont programmées. C’est un bateau de support logistique de sous-marins basés à Saint-Nazaire, amarré quai Ernest-Renaud, qui désigne Nantes comme objectif de l’un de ces raids.
16 septembre 1943
En cette fin de journée, les Nantais sont nombreux à s’affairer. Malgré les alertes qui retentissent, c’est vers Saint-Nazaire que se dirigent les bombardiers, pensent les Nantais, habitués à ces ballets aériens.

Panache de fumées du centre ville de Nantes
Pourtant le premier largage est effectué à 16h02, d’une altitude de 5000 mètres, par un bombardier qui, localisant très mal son objectif, lâche ses bombes trop tôt, autour du parc de Procé, à trois kilomètres en amont du site visé. Les deux vagues suivantes, déportées vers l’ouest, pilonnent le port à hauteur de Chantenay, alors que deux autres, déroutées, arrosent l’aéroport de Château-Bougon.
Enfin, l’un des derniers groupes de l’escadrille manque également son objectif et libère toute sa cargaison de bombe sur le centre de Nantes. Une déferlante meurtrière s’abat sur la ville, balayée par le souffle infernal des bombes incendiaires et à gaz. Selon les témoins, le déluge de fer n’a duré qu’à peine plus de 15 minutes. Mais les rues offrent un visage apocalyptique. C’est dans ces conditions que les secours tentent de s’organiser car le bilan humain et matériel et très lourd. La population est traumatisée.

La ville en ruine après le bombardement
23 septembre 1943
Six groupes de la 80 Air Force reçoivent une mission : destination Nantes. Ils décollent à 5h45. Le célèbre acteur Clark Gable fait partie de l’escadrille et accomplit là sa dernière mission de combat, avec le tournage d’un film de propagande. 9h14: l’alerte est déclenchée.
Le raid débute par le bombardement du port, la gare de l’Etat et Chantenay et Sainte-Anne. Le port est lourdement touché ainsi que les chantiers navals. 18h55 : une seconde alerte retentit. C’est la première fois qu’un objectif est bombardé deux fois le même jour. Par erreur, des bombes sont encore larguées sur le centre de Nantes. Cette deuxième vague dévaste les mêmes quartiers que celle du 16 touts en débordant vers l’est et Saint-Donatien. Symbole du centre-ville, les magasins Decré ne sont plus qu’un immense squelette d’acier, terrassés.

Après les bombardements, les civils déblaient les grabbats dans la ville
Le bilan de ces deux journées est effroyable
1463 victimes et 2500 blessés sont dénombrés. 700 maisons et immeubles sont détruits et près de 3000 inhabitables. On estime entre 1000 et 1500 le nombre de bombes larguées sur Nantes au cours des trois raids aériens. Une grande partie du centre-ville et des quartiers périphériques est à reconstruire. Les infrastructures portuaires et industrielles sont lourdement touchées. Le prix payé par Nantes pour retrouver la liberté est un véritable sacrifice.
BOMBARDEMENT DE LA VILLE DE DRESDES

Vue du centre-ville de Dresde après les bombardements
Le bombardement de Dresde, qui eut lieu du 13 au 15 février 1945, détruisit presque entièrement la ville allemande de Dresde. La Royal Air Force (RAF) et les United States Army Air Forces (USAAF) utilisèrent principalement des bombes à fragmentation et incendiaires, provoquant plusieurs dizaines de milliers de morts.

Avoins marqueurs Mosquito ont laissé tomber les cibles indicatrices qui brillait en rouge et vert pour guider les bombardiers
Raisons de l’attaque de février 1945
Les services de renseignements occidentaux étaient arrivés à la conclusion que la Wehrmacht allait déplacer 42 divisions (un demi-million d’hommes) vers le front de l’Est, alors proche de la ville, et les services soviétiques avaient signalé d’importants mouvements de trains sur le centre de triage de Dresde (en fait, des trains de réfugiés fuyant l’avance de l’Armée rouge qui effectuait l’offensive Vistule-Oder). Les états-majors pensèrent que la ville servirait de nœud logistique pour ce transfert.
La stratégie allemande faisait de l’ensemble des grandes villes sur le Front de l’Est, die Festungen (les forteresses), un rempart. Même sans ce bombardement, la ville de Dresde aurait peut-être partagé le triste sort de Berlin et Breslau, réduites en cendres par l’artillerie et les chars soviétiques. Une autre théorie avance que ce massacre fut délibérément conçu par les états-majors américain et britannique en vue de saper une fois pour toutes le moral des troupes allemandes.

Forteresses volantes B-17 de l’USAAF.
Il est possible aussi que les États-Unis et le Royaume-Uni aient voulu impressionner l’URSS. Ce bombardement a eu lieu quelques jours après la clôture de la conférence de Yalta, et il aurait eu une force dissuasive sur Staline, dans le contexte naissant de la guerre froide. À l’inverse, des études de l’USAF insistent sur les demandes répétées des Soviétiques de bombardements sur les nœuds ferroviaires de l’est de l’Allemagne pour faciliter la progression de l’Armée rouge.
Enfin la libération du camp d’Auschwitz, quinze jours plus tôt, en faisant découvrir la réalité de la Shoah aurait retiré les derniers scrupules vis-à-vis des populations civiles allemandes. Il s’agirait d’un bombardement de vengeance. Cette hypothèse paraît pour d’autres d’historiens particulièrement peu crédibles, dans la mesure où les Alliés connaissaient la situation dans les camps de concentration et l’usage des camps d’extermination. De plus, l’extermination des Juifs n’est jamais mise en avant dans l’immédiat après-guerre, il ne figure même pas parmi les chefs d’inculpation au procès de Nuremberg. Le génocide n’est placé au centre de l’attention qu’à partir du début des années soixante.
Les raids

Bombardiers Avro Lancaster de la RAF.
En deux jours, 1 300 bombardiers au total ont largué environ 3 900 tonnes de bombes lors de quatre raids.

Vue aérienne après le bombardement.
La manière de considérer ces attaques aériennes varie selon le point de vue. À l’époque déjà, le ministère de la Propagande de Joseph Goebbels avait utilisé le bombardement de Dresde pour relativiser la responsabilité de l’Allemagne dans la guerre et placer les Allemands dans un rôle de victimes. Au cours de la guerre froide, les préjugés idéologiques empêchèrent une étude objective du déroulement des événements.
Le premier maire communiste de Dresde, après la guerre, Walter Weidauer, considérait en 1946 les attaques comme évitables bien qu’ayant été provoquées par les fascistes allemands. Cependant trois ans plus tard, il considérait les puissances occidentales comme seules responsables du bombardement criminel de Dresde qui ne répondait à aucune nécessité militaire. Une hypothèse (défendue entre autres par l’Allemagne de l’Est à partir de 1949) était que les Alliés occidentaux avaient voulu laisser à l’Union soviétique une zone d’occupation détruite.
Des estimations élevées se réfèrent souvent à des déclarations de témoins oculaires qui ne peuvent plus être réexaminées, ainsi qu’à des informations de sources aux motifs divers : Un document du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de 1946 a donné le chiffre de plus de 305 000 morts. Ce nombre n’était cependant pas le résultat d’investigations propres, mais émanait de rapports basés sur des sources issues des indications de l’administration nazie.
L’ancien officier d’État-major de Dresde Eberhard Matthes, qui avait alors été chargé de travaux de déblaiement, a affirmé en 1992 que, jusqu’au 30 avril 1945, 3 500 cadavres auraient été pleinement identifiés, 50 000 en partie et 168 000 pas du tout. Ces chiffres auraient été communiqués à Adolf Hitler en sa présence. Mais il n’existe aucune preuve écrite qui pourrait confirmer cela et on doute aussi qu’’Hitler ait demandé une telle communication le jour de son suicide. Des journaux (Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine) ont souvent publié des chiffres difficiles à certifier précisément variant de 60 000 à 300 000 morts.

Amas de cadavres après le bombardement. La plupart des corps furent regroupés ainsi afin d’être incinérés sur place, souvent sans même avoir été identifiés, pour éviter les épidémies.
La population totale de la ville était de 630 000 habitants à l’époque mais elle comptait aussi des blessés, des prisonniers ou des réfugiés dont il est impossible d’évaluer précisément le nombre. De plus, beaucoup de victimes ont disparu en fumée sous l’effet d’une température souvent supérieure à 1 000 °C. L’évaluation du nombre de morts a beaucoup fluctué. Ainsi, le maximum de 250 000 morts était avancé par les Soviétiques. L’écrivain négationniste britannique David Irving, quant à lui, jugeait réaliste un nombre de 135 000 victimes. Le chercheur allemand Jörg Friedrich fait état de 40 000 morts. L’évaluation actuelle de 25 000 morts maximum (dont 18 000 corps identifiés) est celle d’une commission d’historiens mandatée par la ville de Dresde, rapport de clôture au début du mois d’octobre 2008.
Réactions au bombardement
Certains des leaders nazis, particulièrement Robert Ley et Joseph Goebbels, voulurent se servir du bombardement pour abandonner la convention de Genève sur le front ouest. Finalement, le gouvernement nazi ne s’en servit qu’à des fins de propagande.
D’après Frederick Taylor, le ministère de la Propagande de Goebbels fit gonfler le nombre de morts par un facteur 10. Les diplomates allemands firent circuler dans les pays neutres des photographies des destructions, de morts et d’enfants grièvement brûlés. Par coïncidence, le jour précédant le raid, un document du ministère des Affaires étrangères allemandes avait été mis en circulation dans les pays neutres, critiquant Arthur Harris comme le responsable des bombardements de terreur.

Affiche de propagande exploitant la destruction de Dresde.
Le 16 février, le ministère de la Propagande dirigé par Goebbels publiait un communiqué de presse qui dessinait la ligne générale de la propagande nazie : Dresde n’avait aucune industrie de guerre, n’était qu’une ville de culture et d’hôpitaux. Le 25 février, une nouvelle note paraissait, accompagnée de photos d’enfants brûlés, sous le titre Dresde – Massacre de Réfugiés et indiquant que 200 000 personnes étaient mortes.
D’autres bombardements sur l’Allemagne (Berlin et Hambourg lors de l’Opération Gomorrhe) furent aussi très meurtriers mais celui de Dresde a plus profondément choqué les esprits, peut-être parce que c’était une ville d’arts et de culture et qu’elle n’avait pas d’intérêt stratégique (pouvant justifier une attaque aussi lourde) si on considère qu’Albertstadt, le fort militaire de Dresde, n’a pas été bombardé.
LA GUERRE DES KAMIKAZES
Le 12 avril 1945, le commandement américain se décida à révéler l’existence d’attaques-suicides menées par l’aéronavale japonaise contre la flotte américaine au large d’Okinawa. Cette information provoqua la stupeur des Américains atténuée cependant par l’annonce de la mort du président Roosevelt. Le phénomène n’était en réalité pas nouveau. Il remontait à près de six mois. Les premières attaques-suicides étaient intervenues pendant le débarquement de Leyte en octobre 1944. Mais ce qui était nouveau, c’était l’ampleur de ce phénomène qui dérivait du code d’honneur de l’armée et de la marine nipponnes. Le vrai courrage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir déclare le 1er article du code du Samouraï : le Bushidô.

Aspirants pilotes de l’école d’aviation de Utsunomiya, au nord de Tokyo. Dès la fin de 1944, ces aviateurs ne seront plus antraînés pour des attaques conventionnelles mais pour des vols suicides.
Il s’agissait là d’une décision pensée, réfléchie prise en toute liberté, appuyée par une (démarche spirituelle) nourrie de l’esprit du shintô (promu religion nationale), associé à la divinisation de l’empereur et au bushido (voie du guerrier), voire à l’une des écoles de la sagesse bouddhique. Avec néanmoins des références aux vieux mythes remis au goût du jour paf les militaristes et les ultra-nationalistes du gouvernement. Par exemple celui d’Amaterasu Omikami, déesse du soleil et origine de la dynastie impériale, mobilisée comme patronne des kamikazes. Enfin et surtout, la tradition du sacrifice et de la mort volontaire choisie et non subie exerçait encore sa fascination. Les pilotes savaient qu’ils mourraient tôt ou tard dans un combat inégal, mieux valait choisir une mort plus prompte, mais plus efficace. Ces hommes ne se promettaient d’ailleurs aucune récompense, aucun paradis, bientôt ils ne se promirent même plus la victoire. Rien n’émoussait pour eux le tranchant de la mort !
De la signature de leur engagement à leur mort différée mais inéluctablement programmée, plusieurs semaines pouvaient s’écouler. Les volontaires, parmi lesquels nombre d’étudiants n’ayant souvent reçu qu’une instruction de base du pilotage effectuaient un stage spécial d’une semaine: deux jours pour le décollage avec une bombe de 250 kg, deux jours pour le vol en formation et trois jours pour l’approche et l’attaque. Une grande importance était accordée à la préparation mentale d’un sacrifice dont l’unique justification était l’efficacité, sinon l’utilité, exigeant de celui qui l’accomplissait parfaite lucidité, paix du coeur et maîtrise de soi. L’accent était alors mis sur la nécessité absolue de rester les yeux ouverts jusqu’à la (rencontre) avec l’objectif, car une fraction de seconde d’abandon pouvait la faire échouer. On apprendra que les kamikazes s’interrogeaient beaucoup sur les possibilités de contrôle de cet instant ultime.

L’explication théorique en piqué pour une attaque suicide sur des navires Américains
Puis un soir le commandant de la base leur annonçait que c’était pour le lendemain à l’aube. Leur dernière nuit et la dernière lettre aux parents. Au petit jour, après l’habituel briefing, ils sont tous là, en tenue de vol avec en plus le sabre de samouraï au côté, et sur la tête l’écharpe blanche frappée du soleil levant de ceux qui vont mourir. Le commandant de la base offre à chacun une coupe de saké, tous s’inclinent en direction de l’empereur avant de s’élancer vers les appareils sous les acclamations de leurs camarades. La méthode d’attaque était au point : les appareils kamikazes escortés par des chasseurs devaient arriver à basse altitude en vue de la flotte américaine, monter à 4 500 mètres et plonger en se partageant les cibles pour atteindre la cage de l’ascenseur central sur les porte-avions, l’aplomb de la passerelle sur les autres bâtiments. Les (héros) avaient vite compris que les chefs leur avaient menti, qu’ils avaient été dupés, manipulés, sacrifiés. Marqués par leur terrible familiarité avec la mort, les kamikazes transformèrent souvent leur amertume en fureur contre ce qui avait gâché leur jeunesse, l’institution impériale et familiale, les conceptions religieuses, idéologiques, étatiques, militaristes, réunies sous le nom de kokutaï que les Américains s’étaient engagés à respecter.

L’instruction de quelques semaines à de nouveaux pilotes suffisait pour leurs formation
Avant chaque départ les jeunes pilotes d’avions-suicides remettaient une lettre à leurs familles
Dans les années 1946-1948, certains rejoignirent le parti communiste, d’autres furent séduits par le nihilisme. Et les nostalgiques de la vie collective et de l’encadrement s’agrégèrent à des groupes de toutes tendances politiques, parfois aux bandes de pillards ou de malfaiteurs qui connaissaient leur âge d’or à cette époque. Leur réintégration au conformisme social s’effectuera sans bruit à partir de 1951 grâce au miracle économique japonais. Les kamikazes auréolés de gloire de 1945 feront carrière dans les sociétés Sony, Honda, Denzu ou autres. Ils sont aujourd’hui des retraités sereins qui parlent peu des fantômes du passé.

Le dernier regard d’un pilote kamikaze avant son départ peut-être son dernier!

Scène d’un avion-suicide contre un navire
Le cérémonial du Kamikaze

Le cérémonial d’une unité de pilotes kamikazes. Avant leur ultime et unique mission, des kamikazes posaient pour le photographe. Au XIIIème siècle, un typhon avait détruit la flotte d’invasion mongole. Le terme de kamikaze (vent divin) avait été choisi en mémoire de cet ouragan providentiel.
C’est Yukio Seki qui va populariser auprès de tous les futurs pilotes Kamikaze un cérémonial calqué sur les plus pures traditions des samouraï. La veille de la mission, ils se font couper les cheveux au plus court. Pendant cette veillée d’armes, ils rédigent une lettre ou un poème auquel seront joints une mèche, et parfois des rognures d’ongles, à l’attention de leurs proches (mère, femme ou fiancée). Ils distribuent tous leurs biens matériels à leurs camarades. Avant de monter dans leur avion, ils se ceignent le front d’un bandeau sur lequel un hinomaru (l’emblème du soleil levant) et des inscriptions patriotiques ont été peints (par la suite, des milliers de bandeaux brodés par des femmes japonaises afflueront aux unités spéciales). Certains portent le sabre court, celui utilisé pour le seppuku, cette cérémonie traditionnelle plus connue en Occident sous le nom vulgaire de « hara kiri ». Tous arborent un foulard de soie blanche négligemment noué autour du cou. Enfin, juste avant le départ, ils portent un toast à l’empereur en buvant un bol de saké au terme d’une cérémonie qui, au fil du temps, deviendra un véritable protocole.
Les premières missions kamikazes

Un avion suicide percutant le flanc d’un navire tuant tous les occupants de la tourelle de tir
Il est 07H50 quand les vigies du porte-avions Sangamon repèrent en visuel quatre chasseurs japonais arrivant par le sud-ouest. Ceux-ci se comportent de manière quelque peu déconcertante, semblant peu s’intéresser aux nombreuses proies qui s’offrent pourtant à eux sous la forme de lourds bombardiers-torpilleurs en train de décoller d’autres porte-avions. Un nuage les cache un moment au regard des guetteurs américains. Au débouché, trois d’entre eux partent en piqué accentué, tandis que le quatrième conserve son attitude et se met à décrire des cercles, visiblement observant la scène avant de prendre une décision.

Navire touché par un avion kamikaze
A bord du porte-avions Santee, les servants de DCA n’ont pas le temps d’armer leurs canons que l’un des chasseurs est déjà sur eux. À leur grande surprise, alors qu’il aurait déjà dû larguer la bombe qu’il porte sous le fuselage et entamer sa ressource, il maintient son piqué. Sur le pont, dans un suprême réflexe, tout le personnel se jette à plat ventre. Le chasseur japonais percute le porte-avions dix mètres devant l’ascenseur arrière, pénétrant jusqu’au pont inférieur par une brèche de trois mètres. Le bâtiment vacille sous le choc. En explosant, la bombe cause une déchirure de huit mètres dans le pont du hangar, entraînant une série d’incendies et de nouvelles détonations.
Les marins se relèvent tandis que résonnent les sirènes d’incendie et que les équipes de sécurité courent dans tous les sens, au milieu des cris des blessés et du bruit assourdissant des déflagrations. Les regards échangés dénotent un sentiment d’inquiétude. La même question est sur toutes les lèvres : le Japonais a-t-il raté son attaque ou s’est-il délibérément écrasé ? Les deux autres chasseurs ne tardent pas à leur fournir la réponse. Cette fois, la DCA ouvre le feu. L’un des deux est touché de plein fouet. L’autre, également touché, est dévié de sa course. Il se dirige vers le Sangamon, mais percute l’eau avant d’atteindre sa cible. Il n’y aucun doute possible, ces piqués à la mort ne peuvent être que volontaires. Les marins américains ont déjà eu l’occasion à différentes reprises d’être confrontés à ce type d’attaque, mais il s’agissait d’actes isolés perpétrés par des pilotes dont l’avion avait été trop fortement endommagé pour qu’il puisse retourner à sa base ou à son propre porte-avions. Dès le 7 décembre 1941, à Pearl Harbor, un avion japonais dont les réservoirs d’essence avaient été crevés s’était précipité sur le porte-hydravions Curtiss et un autre avait visé un hangar à Kaneohe. Mais, cette fois, il est clair qu’il ne s’agit pas d’actes circonstanciels, mais réfléchis et délibérés. Entre-temps, un sous-marin japonais, le I-56, a fait son apparition sur la scène, ajoutant un peu plus à la confusion ambiante en logeant une torpille dans la coque du Santee.

Un avion-suicide en flamme passe à côté d’un navire
Le quatrième (Zéro) continue à tourner en rond, peut-être encore hésitant sur la conduite à tenir ou peut-être, tout simplement indifférent à tout ce tumulte, est-il en train de choisir sa cible avec sérénité ? Une fumée noire s’échappe du capot. La DCA a fait mouche. Alors, le pilote se décide enfin et pique à son tour sur le Suwanee (CVE-27). Les servants de DCA ont compris : c’est lui ou eux. Tout ce qui peut tirer dans la flotte américaine ouvre le feu sur cet avion fou. Le (Zéro) est touché à de multiples reprises, mais il ne dévie pas de sa course et vient percuter un avion qui est en train d’apponter. Les deux appareils explosent dans une gigantesque boule de feu. Le choc, terrible, ébranle le porte-avions. L’incendie se propage à d’autres avions sur le pont. Il faudra deux heures aux pompiers pour en venir à bout. On relève 143 cadavres et 102 marins sont blessés plus ou moins grièvement. Ce 25 octobre 1944 marque la première mission officielle du corps des volontaires de la mort, mieux connus sous le nom de Kamikaze. Elle est symbolique à plus d’un titre. Pour ces quatre premiers pilotes et les quelque 2 936 qui les suivront, les résultats ne seront pas à la hauteur des sacrifices consentis ni de leurs espérances. Le Suwanee sera à nouveau pleinement opérationnel trois heures après avoir été percuté par le Kamikaze.
Une seule et unique mission

25 novembre 1944: un Zéro qui laisse une traîné de carburant lance une attaque suicide contre l’Essex
Très rapidement, l’ampleur des attaques spéciales mène le Japon à une véritable impasse. Les premiers volontaires se recrutent parmi les pilotes les plus anciens, que la frustration ressentie depuis des mois conduit à s’exposer une dernière fois dans l’espoir que leur sacrifice influera sur le cours de la guerre, ou tout simplement pour prendre une revanche sur des mois d’impuissance. Le haut commandement ne va tarder à s’émouvoir de cette situation et prendre des mesures pour sauvegarder les cadres les plus expérimentés en vue de l’ultime bataille qui s’annonce sur le sol même de la Mère-patrie. Il ne reste plus alors qu’à puiser dans le réservoir des jeunes recrues, puis à former des pilotes dont on exigera d’eux qu’une seule et unique mission, sans retour. La menace que font peser le survol régulier du Japon par l’aviation américaine et les sévères restrictions en carburant amènent à réduire la formation des recrues au strict minimum, l’accent étant mis sur l’aspect théorique. Lancés dans la bataille avec parfois moins de vingt heures de vol, ces jeunes pilotes recrutés jusque dans les classes terminales des lycées savent à peine maintenir leur avion en ligne. Quand ils ne s’égarent pas pour faire le grand plongeon bien avant leur arrivée sur l’objectif, ils n’offrent aucune résistance à la puissante et efficace chasse américaine qui ne va pas tarder à mettre en place des parades à cette menace de première importance.
Du côté américain

Une batterie de 40mm tirant sur des avions-suicide
Du côté américain, l’étonnement ne tarde pas à céder à l’horreur, puis bientôt à la panique. Rien n’a préparé les chefs de l’état-major combiné à une telle épreuve. La menace Kamikaze n’a rien de très inquiétant sur le plan stratégique mais sur le plan psychologique, elle cause des ravages parmi les marins. Selon les statistiques les plus fiables, environ 5 000 Américains seraient tombés victimes de ces attaques spéciales. Cependant, les cas de désordre mental passent de 9,5 % fin 1941 à 14,2 % fin 1944, un phénomène que l’on attribue à l’augmentation du rythme de la guerre moderne avec ses horreurs épuisantes et inhabituelles. Il y a de quoi ! James J. Fahey, matelot breveté à bord du croiseur USS Montpelier, a décrit dans son journal, à la date du 27 novembre 1944, une attaque-suicide ordinaire: Les Japs nous arrivaient dessus de tous les côtés. Avant leur attaque, nous ne savions pas qu’il s’agissait d’avions-suicides qui n’avaient aucune intention de rentrer à leur base. Ils n’avaient qu’une chose en tête, c’était s’écraser sur nos navires, avec leurs bombes et tout ça. Il fallait les descendre, les endommager ne servait pas à grand chose. Pendant ce temps, les avions qui explosaient au-dessus de nous nous arrosaient de débris. C’était un peu comme s’il pleuvait des morceaux d’avion.
Cela tombait un peu partout sur le bâtiment. Un certain nombre d’hommes furent atteints par de gros morceaux d’avions japs. Les explosions étaient terribles quand les avions-suicides percutaient la mer à proximité de notre bâtiment. L’eau était couverte d’une fumée noire qui montait dans le ciel. La mer avait l’air d’être enflammes. Tous les canons des navires tiraient sans arrêt. Ça, c’était de l’action ! Pas un moment de répit. Les gars passaient les munitions à la vitesse de l’éclair tandis que les canons tournaient dans toutes les directions pour cracher leur acier brûlant. Pendant une accalmie, les gars allaient récupérer des souvenirs, et quels souvenirs ! J’ai eu quelques morceaux d’avion. Le pont près de mon affût était couvert de sang, de tripes, de morceaux de cervelle, de langues, de scalps, de coeurs, de bras, etc. Ils ont dû sortir les lances à incendie pour nettoyer le pont de tout le sang répandu. L’eau était rouge de sang. Des morceaux de Japs étaient éparpillés un peu partout.

Un Bombardier en piqué rase les flots avec sa torpille
L’amiral Nimitz ordonne un (black-out) complet sur le phénomène Kamikaze, qui ne sera révélé au grand public qu’en avril 1945, par pure coïncidence, le jour où la presse annoncera le décès du président F.D. Roosevelt. Sur le terrain, la réponse américaine consiste à remanier les Task Forces afin de renforcer l’écran anti-aérien. À bord des porte-avions, le nombre de bombardiers est réduit au profit de chasseurs supplémentaires. Grâce au radar et aux écoutes des émissions radio japonaises, les Américains sont capables de détecter suffisamment à l’avance l’arrivée des Kamikaze et peuvent monter des patrouilles de chasse très en avant de la position de leur flotte. Les flottes renforcent leurs piquets de destroyers pour former un écran d’artillerie antiaérienne. Les servants de DCA apprennent une technique nouvelle qui consiste à tirer des obus explosifs dans la mer de manière à créer des gerbes d’eau afin d’aveugler les pilotes japonais et les empêcher d’aligner correctement leur cible. Une autre manière de tarir la source des avions-suicides consiste à effectuer des patrouilles permanentes le long des routes que doivent emprunter les appareils japonais entre le Japon et les Philippines de manière à les intercepter avant même qu’ils ne puissent atterrir à Luçon. Cette tactique se révèle payante à diverses reprises, notamment le 11 novembre 1944, lorsque les escadrilles américaines interceptent une formation de kamikazes et en abattent 11 au-dessus de la baie d’Ormoc. Les Américains iront même plus loin en attaquant les bases aériennes au Japon de manière à détruire toute menace potentielle.
Le porte avions américain Bunker Hill

Un blessé est transféré du porte-avions sur un autre bateau marchant à la même vitesse, après l’attaque du Bunker Hill par les kamikazes en 1945, qui tua 353 hommes.
En mai 1945, le porte avions américain Bunker Hill, frappé par deux bombardiers kamikazes, est transformé en une masse brûlante d’avions, d’essence et de munitions explosant en série. La totalité du pont-hangar était devenue un fourneau ronflant, chauffé à blanc sur toute sa longueur. Même de l’endroit où je me trouvais, la lueur du métal en fusion était bien visible. A ce moment-là, les explosions avaient cessé, et un croiseur et trois destroyers purent venir bord à bord, manches à eau en batterie. Comme les bateaux-pompes du port de New York, ils déversèrent des tonnes d’eau dans le bateau, et la fumée commença enfin à prendre une coloration grise montrant que les flammes s’étouffaient par endroits. Sur la passerelle, le capitaine George A. Seitz, le pacha, de plus en plus préoccupé par la gîte prise par son bateau, entreprit une manoeuvre risquée. Lançant le Bunker Hill dans un virage à 70 degrés, il lui imposa lentement une gîte inverse de façon que les tonnes d’eau accumulées d’un côté soient soudainement renvoyées sur l’autre flanc en balayant les ponts pour être déversées par-dessus bord. Par une chance insigne, cette masse d’eau emporta aussi avec elle le coeur de l’incendie du hangar.

Le corps d’un soldat est immergé selon la tradition au large des îles Marshall, en janvier 1944
Le naufrage du destroyer USS Pringle
Le 16 avril, un (Zéro) (zeke) percute le destroyer USS Pringle. Jack Gebhardt a confié son témoignage au service d’histoire orale de la Naval Historical Foundation. Il convient au préalable de rappeler que le Pringle avait déjà constitué la cible d’un Kamikaze le 26 novembre 1944. Le Pringle était assigné au piquet radar n° 26 à environ 75 miles au nord-nord-ouest d’Okinawa. Les premiers jours de veille furent calmes, mais le 15 avril 1945 après être restés à nos postes de combat pendant presque 24 heures d’affilée, les Japonais ont attaqué en masse. Ils savaient que nous avions veillé toute la nuit pour repousser des raids incessants et que nous étions crevés. L’attaque principale dura toute la journée et, finalement, à l’aube du 16 avril, le Pringle fut attaqué par une horde d’avions japonais. Certains furent descendus, mais un (Zeke) passa à travers nos défenses et s’écrasa à l’arrière de la passerelle et de la chambre des cartes où je me trouvais en tant que téléphoniste pendant les grandes alertes. L’avion arriva par le tribord de la proue, passa à trois ou quatre mètres au-dessus de moi et s’écrasa dans une grande boule de feu.

Le corps d’un matelot tué à bord d’un destroyer qui a été touché par un kamikaze
Lorsque les deux bombes de 500 livres de l’avion explosèrent, j’eus l’impression que c’était la fin du monde. La chambre des cartes fut tout ébranlée et des années de poussière tombèrent depuis le haut des étagères. J’ai senti que le Pringle était sérieusement endommagé et j’ai essayé de quitter la passerelle par la porte tribord, mais elle était coincée et l’échelle avait été pulvérisée. J’ai réussi à tordre suffisamment la porte pour me glisser jusqu’au pont supérieur Mon regard s’est porté vers l’étrave : le bâtiment n’était qu’un brûlot flottant, avec des hommes titubant hagards et sanguinolents, et avec de la fumée et des flammes partout. J’ai vu des hommes sauter par-dessus bord puis quelqu’un a crié : Abandonnez le navire ! J’ai aperçu sous le pont un magasin de munitions de 40 mm en flammes, alors je me suis dirigé vers le côté tribord et je me suis frayé un chemin jusqu’au pont principal.

Un avion suicide se dirigeant vers un porte-avion, cible prioritaire pour les kamikazes
Un avion japonais est abattu alors qu’il tentait une attaque-suicide sur l’U.S.S. Kitkun Bay le 1er janvier 1945. La presse nippone avait utilisé ce document avec la légende: un avion américain abattu. La tromperie de la propagande japonaise était grossière: on reconnaît un Hellcat américain sur le pont du porte-avions au premier plan. Le bouclier du pont avait été arraché et j’ai pu aller jusqu’aux tourelles où j’ai retiré mes chaussures et mon calot pour les ranger soigneusement contre la cloison pare-feu, comme si j’allais revenir ! C’est curieux comme les gens peuvent faire des choses étranges dans des circonstances pareilles. J’ai enfilé mon gilet de sauvetage et je me suis préparé à sauter par-dessus bord En rampant jusqu ‘au bastingage, je me suis rappelé que j’avais laissé mon casque lourd dans la chambre des cartes et j ‘ai décidé d’aller le chercher. Mais, en chemin, j’ai vu d’autres hommes sauter dans l’eau et, sans réfléchir, j’ai sauté à mon tour et nagé aussi vite que je le pouvais pour m’éloigner du bâtiment. Je ne sais pas quelle distance j’ai pu parcourir; plusieurs centaines de mètres peut-être, avant de m’arrêter et de me retourner pour regarder le Pringle, en proie aux flammes, brisé en deux par le milieu, en train de sombrer L’étrave pointait presque à la verticale et j’ai entendu des cris quand elle s’est enfoncée et a disparu. Il ne s’était pas écoulé plus de cinq minutes entre l’attaque de l’avion japonais et le naufrage.

Corps de soldats qui sont morts pendant une attaque d’avions-suicide à Leyrte
Le naufrage du Pringle a fait 69 morts et de nombreux blessés, dont certains succomberont ultérieurement à leurs blessures. Jack Gebhardt est décédé en 1995. Le rédacteur du Naval Historical Foundation a ajouté, en post-scriptum, que (Gibby) ne parviendra jamais à surmonter son stress et ses réactions nerveuses aux bruits soudains et aux passages d’avion à basse altitude.
Okinawa Une bataille sanglante

Départ d’une ecadrille japonaise sur l’île d’Okinawa pour allez attaquer la flotte Américaine

L’amiral Onishi intigateur des avions-sucides kamikazes. L’amiral Onishi explique leur mission à des aviateurs japonais. À l’annonce de la reddition de son pays, Onishi mit fin à ses jours par le traditionnel seppuku (improprement appelé harakiri) et, contrairement à ce que permet le bushido, il refusa de se faire décapiter ensuite, ce qui prolongea son agonie pendant douze heures.
Apprenant la nouvelle de la capitulation le 15 août 1945, l’amiral Onishi se retire seul dans son bureau après avoir congédié les amis avec lesquels il a passé la soirée. Il écrit plusieurs lettres, en forme de testament, puis rédige un dernier poéme. Il s’agenouille et sort du fourreau son court sable d’apparat. Il ouvre son kimono et plante la fine lame d’acier dans son ventre. D’un geste rapide, il s’ouvre l’abdomen, puis retirant son arme, il tente de se trancher la gorge. Ses forces l’abandonnent et il s’écroule sur le dos. Il est découvert agonisant, baignant dans son sang, par l’un de ses serviteurs le lendemain matin. Refusant toute assistance, il attendra la mort seul. Elle ne viendra le chercher qu’à six heures du soir, pour l’emmener retrouver les milliers de jeunes aviateurs qu’il a précipités avant lui dans le sacrifice suprême. Au moment de rendre l’âme, il leur demandera pardon.

Un Yokosuka découvert par les Américains sur l’île d’Okinawa en 1944
Le Yokosuka MXY-7 Ohka était davantage un missile doté d’un pilote humain qu’un avion. Fixé sous un bombardier spécialement aménagé à cet effet, il était amené à proximité de sa cible, puis largué. Le kamikaze allumait alors ses fusées et essayait d’atteindre son objectif. En raison d’une vitesse excessive (environ 900 km/h) et de la piètre manoeuvrabilité de l’engin, très peu d’(Ohka) atteignirent leur cible.
L’utilisation massive de kamikazes n’aura eu pour effet que de freiner l’arrivée américaine, mais sans doute aussi de renforcer la détermination de l’Oncle Sam d’en finir avec un pays qui lui coûtait trop de (boys), quels qu’en soient les moyens.
PERSONNAGES 1e partie
Clément Ader 2 avril Muret Mort 1925 Toulouse
Clément Agnès Ader est né à Muret le 2 avril 1841 de François Ader (30/1/1812 ; 14/1/1889) et de sa deuxième femme, Antoinette Forthané (8/3/1816 ; 6/11/1865). Les Ader sont tournés vers la menuiserie depuis plusieurs générations. L’arrière grand-père de Clément était menuisier et architecte. Il s’illustra dans la réfection del’église d’Ox, à quelques kilomètres de Muret.
Son grand père maternel qui servit dans les armées de Napoléon Ier, vivait avec se femme dans un moulin, dont le mécanisme enchanta longtemps le petit Clément. Il venait souvent le regarder, tout en écoutant les récits de campagne de son aïeul. C’est sûrement ces histoires qui insufflèrent au jeune enfant le patriotisme qui ne le quitta jamais durant toute sa vie. Il était premier de l’école communale de Muret et brillait particulièrement en arithmétique et en français, en plus, il possédait un vrai talent dans les travaux manuels. A 11 ans, il réalisa un collier de constitué de maillons de bois.

Ce collier, réalisé seulement avec un canif, fut taillé en une fois dans la pièce de bois ! Ader père espérait beaucoup que Clément lui succéda à la tête de la menuiserie familliale. Mais il souhaitait avant tout le bonheur de son fils unique. Aussi, lorsque l’instituteur de Muret vint lui conseiller d’envoyer Clément à Toulouse pour suivre des études secondaires, il se résigna. Son fils partit en octobre 1853, à l’âge de 12 ans, comme pensionnaire de l’institution Assiot.

Il optint son baccalauréat à 15 ans. Il était considéré par ses professeurs comme (un élève très sérieux, particulièrement doué en mathématiques et en dessin).
En 1857 s’ouvre une nouvelle section dans l’établissement : une école industrielle amenant un diplôme d’ingénieur équivalent aux Arts et Métiers.
Ader fait parti de la première promotion, d’où il sortira diplômer en 1861. On pense qu’il commença les concours d’entrée aux Grandes Ecoles, mais soit ne les passa pas par goût, soit échoua, ce dont on peut douter. Ses études terminées, il se mit en quête d’une situation stable. Il mit au point un plus lourd que l’air, qu’il appela Eole, et avec lequel il s’éleva de terre le 9 oct. 1890. En 1891, Eole II parcourut 200 mètres au camp de Satory. Il est considéré comme le père de l’aviation.
Après avoir réalisé un moteur à essence pour ballon dirigeable et étudié un cerf-volant capable de soulever une charge, Clément Ader (s’attacha à la réalisation d’un véhicule plus dense que l’air permettant de voler. Il y parvint vers 1890 après sept années de travail.
En 1855, à Muret près de Toulouse, Clément Ader alors âgé de 14 ans fait ses (premières ailes). Revêtu d’un costume d’oiseau constitué d’une grande veste, de quelques mètres de lustrine et de deux bâtons, il se lance du haut d’une colline.

Armand Lotti 1897-1993, (portant lunettes), Jean Assolant 1905-1942 et René Lefèvre (de gauche à droite) à Prague avec l’Oiseau Canari.
Deux ans après Lindbergh, Assollant, Lefèvre et Lotti, accompagnés d’un passager clandestin, réalisent sur l’Oiseau-Canari, la première traversée française de l’Atlantique. Nord Old Orchard Beach, État du Maine, 13 juin 1929. Les 600 ch du moteur Hispano-Suiza 12 Lb ébranlent doucement le Bernard 191 (Grand Raid) jaune. Lentement il prend de la vitesse, si lentement même que sa queue met un temps infini à se soulever. En ligne de vol, il ne décolle toujours pas, se ruant péniblement vers la jetée qui limite 2 000 m de plage superbe. La foule attend la collision et l’explosion de l’avion, bourré de carburant. Mais, le Bernard s’élève lentement, juste de quoi contourner l’obstacle, au ras de la mer. Il est 10 h 8, heure locale, soit 15 h 8 G.M.T.
A bord, le pilote Jean Assollant, le navigateur René Lefèvre et le radio et commanditaire du raid, Armand Lotti, ne comprennent pas. Lors d’une première tentative, le 20 mai, ils avaient décollé si aisément! Et là, on avait frôlé la catastrophe avec moins d’essence à bord et sans le canot de sauvetage et autres objets inutiles, éliminés avant le second départ. L’avion grimpe centimètre par centimètre, queue basse, comme déséquilibré.
Tout s’arrange, lorsque, soudain, surgissant des profondeurs du fuselage arrière, où il compromettait très dangereusement le centrage de l’avion, un jeune Américain de vingt-cinq ans, Arthur Schreiber, vient calmement déclarer à Lotti : 1 am here. II est là, ce passager clandestin; on ne peut revenir le déposer, ni non plus le jeter par-dessus bord.

Le Bernard 191 GR Oiseau-Canari, qui allait faire la célébrité de la firme en devenant le premier avion français à traverser l’Atlantique. Ses 600 ch et ses 3 760 I de carburant lui conféraient une vitesse de 240 km/h et un rayon d’action de 5 800 km. Lotti lui fait signer un papier. En cas de succès, Schreiber, le premier passager sur l’Atlantique, ne pourra tirer aucun avantage de sa situation.
Deux heures après, l’Oiseau-Canari n’est encore qu’à 700 m d’altitude, au-dessus du cap Sable; encore une heure et demie et le moteur tourne soudain à vide, le temps interminable de mettre en circuit un autre réservoir. Déjà 600 litres de brûlés; il sera dur d’arriver à Paris, et il faut rester pleins gaz, le Bernard étant encore trop lourd en carburant. A 20 h G.M.T., le temps se dégrade, du givre apparaît, alourdissant la machine; l’équipage décide de prendre un cap au sud, où les conditions météorologiques doivent être meilleures. Non.
Onze heures durant, les quatre hommes vivent dans un enfer orageux, pliant le Bernard aux caprices des vents. Mais il est solide ce monoplan de transport pour douze passagers, dont les sièges ont fait place à quatre réservoirs de carburant. Le point au sextant révèle beaucoup de retard sur le plan de vol et l’essence baisse. A 10 h 10 G.M.T., le goniomètre de Horta, aux Açores, signale à l’avion qu’il passe sur son méridien nord. Cap est mis sur Vigo, en Espagne. Vers 12 h G.M.T., descente sous la couche est amorcée pour vérifier la dérive; le vent est plein arrière. C’est la détente. Assollant et Lefèvre se dégourdissent les jambes, Lotti pilote l’avion pendant une heure et demie.
A 17 heures, des bateaux de pêche sont survolés et, trente-deux minutes plus tard, la côte est franchie au cap Finisterre, plus au nord que prévu. Il y a vingt-six heures et quarante minutes que l’appareil à décoller du sol américain. L’Atlantique est vaincu, cette fois par des Français. A 19 heures, Oviedo est passé. Pas de piste pour s’y poser, ni à Gijon, une heure plus tard. A 20 h 30, le soleil se couche. La fatigue, l’essence au plus bas, la nuit arrivant vite font choisir à Assollant une plage repérée à 20 h 40 pour se poser. Elle est étroite entre mer et falaises, un ruisseau la coupe. Calmement, le pilote fait toucher le sol à l’avion, qui saute le ruisseau et finit sa course roues dans l’eau, une aile au ras du rocher.
Au village proche de Cormillas, que gagne Lotti, c’est d’abord l’incrédulité, ensuite la liesse, le centre du monde d’où part la nouvelle enfin, avant que n’affluent les télégrammes de félicitations. Après les agapes, le lendemain, on remet de l’eau, de l’huile, car il n’en restait plus que dans le fond du carter, et 150 litres d’essence. Le 16 enfin, l’équipage décolle pour Cazaux. En fait d’arrivée triomphale, une panne d’essence contraint à poser l’avion sur une plage landaise, près de Mimizan!
C’est quand même le triomphe en attendant le carburant pour rallier Cazaux, puis, dans la soirée, Paris, où une foule attend ainsi que les responsables de l’aéronautique, prêts à encenser après avoir tout fait pour que deux petits sergents et un aventurier sorti on ne sait d’où ne puissent réaliser l’aventure de leur vie. Gérant avec son père l’hôtel familial parisien, Armand Lotti ne s’intéressa à l’aviation qu’en 1926 alors qu’un accident de chasse lui avait fait perdre un ceil, ce qui lui interdisait en principe d’obtenir un quelconque brevet de pilote. Il apprit néanmoins à piloter, en cachette de ses parents, à l’école Blériot de Buc et passa ses brevets de tourisme.
L'HOMMES DES GRANDES CROISIÈRES

Italo Balbo 1896 Ferrare Mort 28 juin 1940 près de Tobrouk
L’homme des grandes crosières
Italo Balbo fut le pionnier des raids à longue distance effectués par des formations d’avions importantes, qui attirerent l’attention sur les progrès techniques et le nouveau regime politique de l’Italie Italo Balbo fut le premier à réaliser des vols en formation sur longue distance incorporant un grand nombre d’appareils. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’aviation italienne était l’une des plus florissantes du monde, et Italo Balbo en était le chef le plus considéré. Né en 1896 à Ferrare, Balbo avait participé à la guerre contre les Empires centraux et y avait gagné le grade de capitaine d’aviation et trois décorations.
Après les hostilités, il s’était intéressé aux luttes sociales et, très tôt, avait épousé les thèses du fascisme naissant. Compagnon de la première heure de Benito Mussolini il avait participé à la fameuse marche sur Rome, Balbo avait pourtant gardé un réel esprit d’indépendance à l’égard du Duce (il s’était d’ailleurs opposé, mais trop tard, à l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Allemagne en 1940).
Conscient de ses qualités, Mussolini le nomma en 1927 sous-secrétaire d’État à l’Aviation. Dès cette époque, alors que la tendance était aux exploits individuels, il avait préconisé les raids de masse et les croisières collectives.

L’armada de Balbo ancrée dans le port d’Amsterdam à la veille de son départ pour les États-Unis; ce vol préfigure déjà les grands raids de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale.
En 1925, Savoia-Marchetti avait produit un hydravion militaire catamaran, le SM-55A, propulsé par deux moteurs en tandem Fiat de 700 ch cnacun, installés en nacelle au-dessus de la voilure. L’appareil, extrêmement robuste, avait des performances remarquables pour l’époque. Il fut cnoisi pat halo Balbo pour former sa première armada de grande croisière. Le 17 décembre 1930, quatorze appareils commandés par le jeune général en personne (il avait été nommé ministre de l’Ait un an plus tôt) quittaient le pian d’eau d’Orbeteilo, à destination de Rio de Janeiro.
Ces appareils devaient voler en formation, et c’était la première fois qu’autant d’avions étaient appelés à couvrir ensemble une aussi longue distance (à l’époque, seule la Regia Aeronautica était capable de mener à bien une telle performance). Le vol, qui comportait sept escales, dura soixante et une heures. Dix appareils seulement arrivèrent à destination : trois d’entre eux avaient été victimes d’accidents ayant entraîné la mort de cinq hommes, le quatrième n’avait pu poursuivre son voyage. Le raid fut malgré tout un succès, et Balbo et ses équipages furent reçus triomphalement au Brésil par le président Getùlio Vargas, tandis que le roi d’Italie, Mussolini et D’Annunzio leur adressait des félicitations par radio. Encouragé par ce premier exploit, le général Balbo décida de conduire une formation massive de Savoia depuis l’Italie jusqu’à Chicago, où devait se tenir l’Exposition universelle de 1933.
L’organisation de l’armada
Organisateur remarquable, Balbo apporta le plus grand soin à préparer sa nouvelle armada. Cette fois, il avait prévu une formation de deux escadrilles totalisant vingt-quatre hydravions Savoia-Marchetti SM-55X équipés de deux moteurs Isotta-Fraschini Asso de 750 ch chacun. Doté d’hélices tripales, cet appareil avait des flotteurs et des capots-moteurs mieux profilés que ceux du SM-55A.
Le général Balbo avait également compris l’importance de la radio pour communiquer tant avec les appareils de l’escadre qu’avec la station spéciale qui avait été installée sur le parcours. Six chalutiers avaient également été équipés pour transmettre des renseignements météorologiques.

Le 15 juillet 1933, les Savoia-Marchetti SM-55X sur le lac Michigan, devant les gratte-ciel de Chicago. Au-delà de l’exploit technique et humain, la réussite d’Italo Balbo constitue une propagande de premier ordre pour le régime de Mussolini.
La formation était divisée en groupes de trois appareils, qui portaient des couleurs distinctives (noir, rouge, blanc et vert), ressortant sur un fond uniforme, gris métallisé. Pour différencier les groupes de même couleur (dans les deux escadrilles), les empennages étaient marqués soit d’une étoile, soit d’un cercle. Chacun des avions avait reçu un marquage civil rappelant le nom de son pilote. Ainsi l’immatriculation de Balbo était-elle l-BALB.
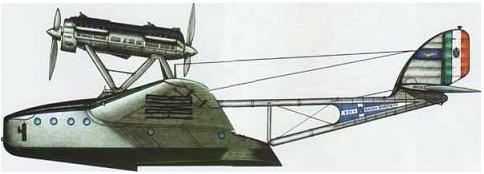
Le Savoia-Marchetti SM-55X immatriculé l-BALB, appareil personnel d’ltalo Balbo lors du périple de juillet 1933.
Le samedi Ierjuillet 1933, les hydravions décollèrent d’Orbetello. Selon l’itinéraire prévu, ils devaient suivre une route jalonnée de plans d’eau, de façon à pallier d’éventuels incidents de vol. Ils survolèrent donc le lac Majeur, le lac de Côme, puis le Rhin, après avoir traversé les Alpes, et firent une première escale à Amsterdam.
Les conditions atmosphériques étaient si mauvaises que, une fois franchie la frontière des Pays-Bas, ils ne purent voler à plus de 250 m d’altitude. A l’amerrissage, l’un des hydravions capota dans l’eau peu profonde du Zuiderzee, ce qui endommagea ses coques et ouvrit une voie d’eau. Trois des occupants furent légèrement blessés et un mécanicien se noya. Un appareil de réserve remplaça l’avion endommagé lorsque la formation prit le départ pour l’Irlande, le lendemain matin. Après avoir traversé la mer du Nord sous la pluie, l’armada de Balbo survola l’Écosse, escortée par un hydravion de la Royal Air Force.
Un temps épouvantable
Sur la route de Reykjavik (Islande), la formation fut retardée de deux jours par le mauvais temps. Les équipages volaient aux instruments à travers des nappes de brouillard. C’était là un genre de navigation extrêmement dangereux pour des appareils volant en formation, mais les difficultés furent malgré tout surmontées grâce à l’habileté des équipages, et les vingt-quatre Savoia-Marchetti amerrirent finalement sans dommage après avoir couvert, en six heures, une distance de 1 500 km.

Le triomphe du futur maréchal de l’Air Balbo à New York, lors de la traditionnelle descente de Broadway sous les acclamations de la foule.
L’étape suivante, qui devait les mener à Cartwright, au Labrador, était la plus longue (2 500 km). Le mauvais temps retarda encore une fois le départ, et lorsque celui-ci fut décidé, l’avion du général Balbo tomba en panne. C’est seulement le mercredi suivant, dans l’après-midi, que les hydravions atteignirent enfin Cartwright, après avoir volé une fois de plus à quelque 30 m seulement au-dessus des eaux glacées de l’Atlantique Nord, parsemées d’icebergs.
Balbo
Le temps était maintenant compté pour se rendre àl’Exposition universelle de Chicago, et les hydravions, une fois le plein fait et les moteurs vérifiés par les mécaniciens, reprirent l’air dès le lendemain matin pour la baie de Shediac, au Nouveau-Brunswick. Grâce à un vent favorable, cette escale fut rapidement atteinte.
Des centaines de Canadiens attendaient les pilotes italiens pour leur souhaiter la bienvenue et leur prêtèrent toute l’assistance désirable afin que les Savoia puissent reprendre l’air au plus tôt à destination de Montréal. Là, une foule énorme était réunie sur les berges du Saint-Laurent pour fêter leur arrivée. Le fleuve lui-même était couvert de petites embarcations qui mirent les appareils en péril tant elles se pressaient autour du point d’amerrissage.

Deux SM-55X de l’armada en vol au-dessus de l’Atlantique. Sur les quatre-vingts appareils participant au raid un seul se perdra en route. L’exploit est indiscutable, l’Italie est à l’apogée de sa puissance aérienne. Quatre ans plus tard, ce sera le déclin.
Chicago et New York : du délire
Malgré une météo tout à fait défavorable, l’armada décolla le lendemain matin en direction de Chicago. Au-dessus des lacs Érié et Ontario, des orages obligèrent Balbo à changer plusieurs fois de cap. Le temps s’améliora lorsque l’escadre atteignit le lac Michigan, au-dessus duquel de nombreux avions officiels et appareils de tourisme l’attendaient afin de lui faire une escorte triomphale jusqu’à l’aire d’amerrissage.
Ce voyage de près de 9 000 km s’acheva heureusement le 15 juillet, après un peu plus de quarante-cinq heures de vol effectif. Après avoir été fêtés comme ils le méritaient par la population de Chicago et les visiteurs de l’Exposition universelle réception officielle, télégramme de félicitations du président Roosevelt, descente triomphale de la 7e Avenue les pilotes italiens reprirent l’air le 19 juillet pour New York, où leur arrivée souleva encore plus d’enthousiasme, la ville comptant de nombreux immigrés italiens.
Le lendemain, Italo Balbo et une vingtaine de pilotes furent invités à déjeuner à la Maison-Blanche; le 21, tous les équipages défilèrent dans Broadway, sous la traditionnelle pluie de papiers. Après avoir quitté triomphalement New York le 25 juillet, les Savoia se retrouvèrent, après quelques incidents dus au mauvais temps, à Shoal Harbour (Terre-Neuve). Mais les conditions atmosphériques au-dessus de l’Atlantique Nord étaient si épouvantables que l’escadrille dut attendre près d’une semaine pour prendre le chemin du retour.
Initialement, celui-ci comportait une escale en Irlande, mais, vu la météo, Balbo décida de rentrer par l’Atlantique Sud, via les Açores et Lisbonne. Le voyage de retour fut endeuillé par la perte de l’un des appareils, qui entraîna la mort de l’un des membres de son équipage. Le 12 août cependant, les vingt-trois hydravions restants se présentèrent en formation impeccable, dans le soleil levant, au-dessus d’Ostie, l’antique port de Rome, qu’ils survolèrent avant d’amerrir.
Du maréchal à Tobrouk
Le jour suivant fut celui du véritable triomphe. Après une marche à travers Rome sous les acclamations de la foule, Italo Balbo reçut l’accolade de Mussolini, qui l’éleva à la dignité de maréchal de l’Air. Dans les années qui suivirent, le maréchal Balbo occupa une place de plus en plus importante dans l’Administration italienne.
Le 28 juin 1940, alors qu’il venait de prendre son commandement en Afrique du Nord, son appareil fut pris pour un bombardier anglais et abattu par erreur, près de Tobrouk, par la DCA italienne. Le jour suivant, le comte Ciano, gendre de Mussolini, notait dans son journal : Balbo n’avait pas mérité cette fin.
Il n’avait jamais voulu la guerre et avait lutté contre elle, mais celle-ci ayant été déclarée, il n’avait plus parlé que le langage d’un fidèle soldat. C’était un véritable Italien, avec les grands défauts, mais aussi les grandes qualités de notre peuple.

Maryse Bastié 27 Février 1898 Limoges Morte 6 juillet 1952 Lyon
Née à Limoges le 27 Février 1898, orpheline de père à 11 ans, celle qui s’appelait encore Marie-Louise Bombec fut d’abord une modeste piqueuse sur cuir dans une usine de chaussures. Elle fut une petite fille, puis une jeune fille comme d’autres, turbulente et têtue. Un premier mariage qui fut un échec lui donna un fils. Elle découvrit l’aviation en épousant son filleul de guerre, le pilote Louis Bastié. Louis ne pouvant lui donner de leçons sur un appareil militaire, c’est Guy Bart, un moniteur civil qui s’en chargea. Mais le 15 Octobre 1926, son mari trouva la mort dans un accident d’avion. L’aventure aéronautique aurait pu s’arrêter là, mais le virus de l’aviation, tenace et irraisonné, la rongeait.
Quand elle est enfin engagée comme monitrice de pilotage, c’est le bonheur pendant six mois. L’école disparaît, mais Maryse, mieux entraînée, a pris foi en son étoile, et elle décide d’acheter son propre avion, elle obtient un Gaudron C109 à moteur de 40 C.V. Elle n’a pas le premier sou pour le faire voler, Drouhin, va l’aider.
Le 13 Juillet 1928, il lui offre le poste de premier pilote.Ce record (1058 kilomètres) est battu à Treptow en Poméranie. C’est le premier record homologué de Maryse Bastié. En 1935 elle crée, à Orly, l’école (Maryse Bastié aviation). La traversée de l’Atlantique Sud. Encouragée par Mermoz, elle bat le record de traversée de l’Atlantique Sud en treize heures trente minutes.
Une fin tragique
Le 6 Juillet 1952, elle est désignée pour accompagner l’équipage d’un (Nord 2501) à un meeting, à Lyon. Après l’appareillage, en vue du retour, l’avion décolle et, vers 200 mètres de hauteur, il pique du nez vers le sol, où il s’écrase et prend feu.

Citation à l’ordre de la Nation
Aviatrice ayant acquis une renommée mondiale en dix records au cours desquels, seule à bord, elle a fait preuve d’une rare maîtrise, servie par un total mépris du danger. A inscrit à son palmarès, parmi d’autres exploits:
En 1930, le record de durée féminin international en 37 heures 55 minutes;
En1931, le record féminin international de distance, avec 2.976 kilomètres;
En 1936, la traversée féminine de l’Atlantique Sud en 12 heures 5 minutes
Capitaine de l’armée de l’Air, 3.000 heures de vol, Commandeur de la Légion d’honneur à titre militaire, Maryse Bastié lègue à la postérité l’admirable leçon d’une victoire constante de la volonté sur la fragilité. Son nom restera parmi les plus grands et les plus purs de l’histoire des Ailes françaises.

Louis Blériot 1er juillet 1872 Cambrai Mort 1er Août 1936.
Louis Blériot, le chef d’entreprise, à son bureau. Le pionnier cessa de voler fin 1909. Né à Cambrai le 1er juillet 1872, Louis Blériot fit de solides études d’ingénieur à l’École centrale des arts et manufactures avant de fabriquer des phares d’automobile dans une usine située à Neuilly-sur-Seine. Sa société était florissante et ses revenus confortables, mais le futur vainqueur de la Manche n’était pas homme à se contenter de cette existence tranquille. Curieux de tout, passionné par les techniques nouvelles, il s’intéressa à l’aviation, qu’il devait marquer de son empreinte, devenant ainsi l’un des pionniers du (plus lourd que l’air) les plus célèbres de ce début du xxe siècle.
En 1900, alors que l’aviation n’en était qu’à ses balbutiements, Blériot décida d’en savoir plus sur l’art du vol. En bon scientifique, il étudia la théorie dans les livres, puis, à la fin de l’année, conçut et assembla un modèle réduit de machine volante à ailes battantes.
Inspiré de l’ornithoptère, cet engin possédait une envergure de 1,50 m, pesait une dizaine de kilogrammes et était propulsé par un moteur à acide carbonique développant près de 2 ch. Construit grandeur nature, cet appareil se révéla incapable de prendre l’air. Déçu, ayant englouti dans l’opération une centaine de mille francs, somme énorme pour l’époque, Blériot abandonna momentanément l’aviation.
Cinq ans plus tard, le capitaine Ferber, l’une des figures de proue de l’aéronautique française, lui présenta Gabriel Voisin, un pionnier du (plus lourd que l’air) qui avait déjà étudié et réalisé un planeur équipé de flotteurs. Le 15 juin 1905, cette machine volante, pilotée par le même Voisin, décolla, remorquée par un canot automobile.
Conquis par le talent du jeune inventeur, Blériot accepta le principe d’une association, et les deux hommes fondèrent la société Blériot-Voisin, dont la première machine volante fut un hydroplaneur pourvu, sur l’avis de Blériot, de surfaces courbes. Les essais se déroulèrent entre le pont de Billancourt et celui de Sèvres, mais s’achevèrent de façon décevante. Si l’engin quitta facilement son plan d’eau, il termina en effet son envolée par un plongeon magistral. Dans l’année qui suivit, les deux pionniers n’essuyèrent que des échecs, d’où leur séparation.

Brevet n°1 de pilote pour Blériot.
Louis Blériot continua seul ses recherches et réalisa un monoplan de type canard, aéroplane équipé d’une hélice propulsive à l’arrière et d’un équilibreur, de même que de gouvernes à l’avant. Quand celui-ci s’écrasa au sol en juin 1907, après quelques sauts de puce, le constructeur renonça à la formule canard et confia à son chef d’atelier, Louis peyret, la mise au point du modèle VI, appelé (Libellule).
Propulsé par un moteur Antoinette de 24 ch, cet appareil effectua quelques vols importants avant de céder la place au VI bis, qui atteignit l’extraordinaire altitude, pour son temps, de 25 m et la vitesse de 80 km/h. Cet exploit se termina cependant sur une chute, la première des trente-deux que le courageux pionnier allait connaître de 1907 à 1909. Le 6 décembre 1907, (l’homme qui tombe toujours), surnom qu’avait valu à Blériot sa propension à souvent s’abîmer au sol, effectua une très belle volte-face avec le VII bis, qui prit fin elle aussi par un écrasement.
De chute en chute, celui-ci avait englouti une véritable fortune dans ses malheureuses expériences, qui lui avaient pourtant beaucoup appris. C’est ainsi qu’il fondait de grands espoirs sur son dernier-né, le modèle XI, monoplan de lignes modernes couronnant de nombreuses années d’efforts et de peine. Mû par un propulseur REP (Robert Esnault-Pelterie) de 28 ch, le Blériot XI prit l’air pour la première fois en janvier 1909 et, dans les mois qui suivirent, prit part à de nombreux meetings au cours desquels Blériot accumula du savoir-faire et gagna de l’argent. Le 3 juillet 1909, au cours d’une tentative de record de distance, celui-ci se brûla sérieusement le pied.
Très handicapé, il s’inscrivit tout de même au concours du Daily Mail, épreuve dotée d’un prix de 25000 francs-or récompensant la première traversée de la Manche sur un plus lourd que l’air, dès qu’il apprit l’échec d’Hubert Latham, le poulain de la société Antoinette. Se déplaçant à l’aide de béquilles, Blériot se rendit tout près de Calais et, le 25 juillet 1909, à 4 h 41, aux commandes du Blériot XI, équipé d’un moteur Anzani, il s’envola pour l’Angleterre.
A 5 h 13, le fragile monoplan se posa près de Douvres. Cet exploit sans précédent valut au pionnier gloire et fortune et le sauva sans doute d’une faillite totale. Avant la fin de cette même année, celui-ci abandonna, à la suite d’un accident, le pilotage pour se consacrer à la mise au point de ses machines volantes. Il acquit des usines à Leval lois, créa des écoles de pilotage à Pau, Étampes, Mourmelon et Issy-les-Moulineaux.

Édition spéciale annonçant la traversée de la Manche.
En 1913, les affaires de Blériot étaient prospères. Près de 800 avions avaient été vendus à l’étranger, tant à des civils qu’à des militaires; en outre, une nouvelle école avait vu le jour à Buc. Quand survint la guerre, le vainqueur de la Manche confia à l’ingénieur Béchereau le bureau d’études de la Société pour l’aviation et ses dérivés (SPAD).
A la fin du conflit, les usines de Levallois et de Suresnes tournaient à plein régime et avaient produit, entre autres, les SPAD VII et XIII. Pourtant, le marasme résultant de la cessation des hostilités toucha très durement la Blériot Aéronautique, qui dut ralentir ses activités et diversifier ses fabrications.
Blériot prit cependant une part non négligeable au développement de l’aviation commerciale en figurant parmi les premiers commanditaires de la Compagnie des messageries aériennes puis d’Air Union. A partir de 1927, de nombreux appareils portèrent son nom. Le plus célèbre fut sans doute le Blériot 110 Joseph Le Brix, conçu par l’ingénieur italien Zappata, sans parler du fameux hydravion Santos-Dumont.
Pour ce dernier, Blériot comptait beaucoup sur une commande de l’État. Malheureusement pour lui, le contrat fut en partie révisé et la perte d’argent qui en découla l’obligea à fermer ses ateliers. En juillet 1936, sa santé s’altéra et, le 1er août, il mourut, terrassé par une crise cardiaque.

Jorge Chavez dit Geo 1887 Paris Mort 1910 Domodossola.
Etablit un record du monde d’altitude sur son Blériot XI en 1910 à 2652 m. Deux semaines plus tard, il estle premier à franchir les Alpes. Malheureusement, son avion s’écrase à l’atterrissage.Il meurt 3 jours plus tard. On l’entendra souvent répéter avant de mourir : Arriba, siempre arriba (Plus haut, toujours plus haut), qui restera la devise de l’aviation militaire Péruvienne.

Samuel Cody 1887 Paris Mort 7/08/1913 Domodossola
Américain installé en Angleterre est un personnage à part. Il est le premier aviateur à voler en Grande Bretagne en 1909 à bord de son aèroplane (cathédrale volante). Il remporta le British Empire Michelin Trophy et établit de nouveaux records anglais d’endurance et de distance. Il meurt le 7/08/13 en testant un nouveau biplan.

Jean Conneau Né le 8 février 1880 Lodève, Hérault -Mort le 5 Août 1937.
Plus connu sous le pseudo d’André Beaumont. Remporta 3 des plus dures épreuves en 1911. Paris – Rome, Le premier circuit d’Europe et la Round Britain Race. Etait un excellent navigateur.

Léon Delagrange Né en 14 mars 1872 Mort le : 4 janvier 1910 la Croix d’Hins, près de Bordeaux.
A Turin, à bord d’un Voisin, il a donné son baptême de l’air à sa pupille Thérèse Peltier, qui devint ainsi la première femme ayant volé dans un avion. Au Panthéon des faucheurs de marguerites, Léon Delagrange voit parfois son étoile un peu occultée par les Farman, Blériot, Santos-Dumont et autres Wright.
Pourtant, le (dandy volant) mérite sans doute qu’on s’intéresse davantage à son parcours. Détenteur du brevet de pilote n°3 de l’Aéro-Club de France, il s’était intéressé très tôt aux balbutiements du plus lourd que l’air et fut un des tout premiers clients des frères Voisin.
Son (exploi) le plus connu est celui d’avoir été le premier à emmener une femme à son bord, après avoir été le premier à emporter un passager (et pas des moindres : son rival Henri Farman). En apôtre de l’aéroplane, il sillonna l’Europe (et davantage), portant la bonne parole avant de disparaître le 4 janvier 1910 lors d’un accident aérien sur le terrain de la Croix d’Hins, près de Bordeaux.

Élise Deroche Né le 22 août 1882 : Mort en : 1919
Aéronaute confirmée et pionnière de l’aviation, plus connue sous le nom de (baronne) de Laroche, elle fut la première à voler en solo en octobre 1909. Elle se tua au cours des essais d’un nouvel aéroplane en 1919.

Marcel Doret Né le 3 mai 1896 Paris 18e Mort le 31 août 1955 Vernet
Il fit voler pour la première fois les plus célèbres réalisations de Dewoitine, dont le 0.520 et le 0.550. Les 43 prototypes dont il mena l’expérimentation en trente ans de carrière font de Marcel Doret l’un des pilotes d’essai les plus prestigieux de l’entre-deux-guerres. Né à Paris, le 3 mai 1896, ce jeune mécanicien, passionné d’aviation, vécut son adolescence à Versailles, tout près du terrain d’lssy-les-Moulineaux sur Iequel il put admirer les exploits des pionniers du plus lourd que l’air. Quand éclata la Grande Guerre, Doret, qui venait tout juste d’avoir dix-huit ans, s’engagea dans l’artillerie, qu’il quitta au bout de trente-six mois, à la suite d’une blessure. Décoré de la médaille militaire, le jeune homme fut, une fois guéri, autorisé à tenter sa chance dans l’aviation. Il partit donc pour Dijon avant de rejoindre Chartres. Était-il doué ou avait-on un besoin urgent de pilotes? Toujours est-il que Doret fut lâché après un peu plus de 1 h 40 mn de vol en double commande.
Après avoir achevé sa formation, il fut dirigé sur Avord, puis vers l’école d’acrobatie de Pau, pépinière des pilotes de chasse de l’aéronautique militaire française. Mais, alors qu’il était fin prêt à se battre, les qualités qu’il avait toujours affichées et les impératifs de l’heure le firent désigner comme moniteur.
Un homme avide d’action comme Doret un tel poste ne convenait guère. Aussi fut-il satisfait d’être affecté au réglage et à la réception des appareils réparés. C’est ainsi qu’il allait faire ses débuts dans le difficile métier de pilote d’essai. Démobilisé, Marcel Doret fut, comme nombre de ses camarades de l’aéronautique militaire, obligé de se reconvertir et il dut, quatre années durant, travaillé dans l’industrie automobile comme mécanicien et représentant. Il ne négligeait cependant aucune occasion de s’entraîner, n’ayant jamais perdu l’espoir de revenir à l’aviation. Et puis, un jour, en Grande-Bretagne, tandis qu’il se livrait à une démonstration pour une firme automobile, un télégramme de son ami Rabatel lui annonça qu’une société française recherchait un pilote d’essai. C’est ainsi que le 1.’ juin 1923, Doret entra chez Dewoitine.
Le premier appareil qu’on lui confia fut un D.1 C1, dont le prototype avait été mis au point par Georges Barbot, machine volante sur laquelle il battit, en décembre 1924, son premier record de vitesse sur 1 000 km volant à une moyenne de 223 km/h. Mais le travail de Doret consistait aussi à effectuer des missions de propagande dans les pays étrangers. Présentant un jour le nouveau Dewoitine de chasse D.19 à Zurich, il fit contre son habitude un atterrissage normal, mais avec une charge de 70 kg en l’occurrence son mécanicien Simon assis dans le fuselage située en arrière du centre de gravité de son appareil, prouvant ainsi la stabilité de celui-ci.
En 1927, bien que la maison Dewoitine connat de graves difficultés, Marcel Doret, sollicité par de nombreux constructeurs, refusa toutes les propositions qui lui étaient faites par fidélité à Émile Dewoitine, l’homme qui lui avait donné sa chance. A partir de ce moment, il vécut exclusivement de la voltige et acquit un D.1 ter sur lequel il installa une caméra qui lui permit de tourner de nombreuses séquences d’acrobatie. Celles-ci, montées par J.C. Bernard, furent rassemblées dans un film intitulé Roi de l’acrobatie aérienne, qui fit connaître Doret et lui valut quelques contrats.
Au cours de l’importante rencontre de voltige aérienne qui se déroula près de Zurich au mois d’août 1927, il prit la troisième place, derrière le Français Fronval et l’Allemand Fieseler. Au mois d’octobre suivant, il rencontrait à nouveau Fieseler à Tempelhof, dans un duel d’acrobatie en trois manches dont il sortit vainqueur.
Désormais, il ne cessa plus de se produire, à Vincennes, au Bourget. à Bruxelles et aux Etats-Unis où, à l’issue des National Air Races, il se vit décerner le titre de champion du monde d’acrobatie aérienne. A cette dernière occasion, il parvint à effectuer sur un hydravion Savoia-Marchetti qu’il pilotait pour la première fois une série de loopings à 200 m, suivie de virages à la verticale. Puis, le 21 novembre 1930, Doret prit les commandes du D.33 Trait d’union, un grand monoplan aux lignes élancées dont le surnom allait constituer le titre du livre qu’il écrirait par la suite. Secondé par Le Brix, il réussit, en juin 1931, à parcourir 10 732 km en circuit fermé sans ravitaillement; c’était la première fois au monde que le cap de 10 000 km était ainsi franchi.
Aussitôt après, il s’attaqua à un raid Paris-Tokyo sans escale avec Le Brix et Mesmin. Une première tentative s’acheva par une panne au-dessus de l’Oural (juillet 1931). Deux mois plus tard, un second essai prit fin sur un drame. Si Doret réussit à se parachuter de son appareil en perdition, ses deux compagnons n’eurent pas la même chance et ils périrent dans l’accident.
Après une longue période de doute, le grand pilote d’essai revint cependant à l’aviation. En juillet 1933, il assura le premier vol du Dewoitine D.332 et battit, deux mois après, quatre records de vitesse avec quatre passagers à bord.
Le 26 septembre suivant, avec trois hommes d’équipage et plusieurs passagers, il relia Le Bourget à Londres en 1 h 20 mn, établissant ainsi un record de vitesse sur parcours commercial. Tout en prenant part à de nombreux meetings, Doret n’en continuait pas moins à expérimenter les appareils mis au point chez Dewoitine. En 1937, il essaya à nouveau de réaliser le rêve qui le hantait depuis des années, le raid Paris-Tokyo, mais il dut renoncer à 500 km du but.
Après une longue éclipse due à la guerre et à la mise sur pied, en 1944, d’un groupe de chasse F.F.I., équipé de Dewoitine D.520 repris à l’occupant, Marcel Doret recommença à voler. En 1948, il prit part aux National Air Races de Cleveland sur un planeur Habitch (il s’était intéressé au vol à voile avant le conflit), et il fit sa dernière apparition au cours du meeting de Reims, en juin 1955, avant de s’éteindre, deux mois plus tard, dans sa maison de Vernet, près de Toulouse.

Robert Esnault-Pelterie Né 1887 Paris Mort 1957 Nice
Vers 1906 il mit au point un moteur 7 cylindres en étoile refroidi par air. Il construisit et pilota le premier avion à fuselage entoilé. Egalement inventeur du dispositif de commande appelé manche à balai.

Ferdinand Ferber Né 1862 Lyon Mort 1909 Boulogne/mer.
Il fut un touche-à-tout auxquels l’aviation doit tant. Il fut le premier en France à saisir la portée de la découverte des Wright. En 1904, est le premier européen à construire un planeur sur les principes des Wright.

Claude Graham-White Né le21 Août 1879 Mort le 19 Août 1959.
Pionnier de l’aviation anglaise. Vainqueur de la coupe Gordon Bennett en 1910 au meeting de Belmont Park (USA). Il fut le premier à effectuer un vol de nuit au-dessus de la Grande Bretagne.

Charles Hamilton Né 1886 New Britain Mort en1914.
Sa carrière débuta à New Britain dans le Connecticut, où il sauta d’une fenêtre avec un parapluie en guise de parachute.Le (casse-cou) vedette de la troupe Curtiss. En 1910 il etablit un record de distance en effectuant en 1 journée et 1 seule escale le trajet New-York/ Philadelphie soit 277 hm. Il survécut à 63 accidents et chutes et mourut dans son lit, comme il l’avait toujours prédit.
Adversaire infortuné de Louis Blériot au-dessus de la Manche, Hubert Latham se fit une réputation de pilote obstiné et courageux. Bien qu’il n’ait jamais réussi à traverser la Manche, Hubert Latham est cependant le premier homme qui osa la survoler à bord d’un plus lourd que l’air. Son flegme et son humour britanniques – son père n’était-il pas Anglais ? La sempiternelle cigarette qu’il arborait en toutes occasions conféra à ce personnage une réputation qui dépasse sans doute ses mérites aéronautiques.
Né en 1883 dans le château familial de Maillebois, près de Chartres, Hubert Latham effectua d’excellentes études en Angleterre et obtint un diplôme au Balliol College d’Oxford. II fréquenta par la suite les milieux aristocratiques sans pouvoir se plier à la règle de vie qui caractérisait cette société : l’oisiveté. Aux salons et aux mondanités il préférait les voyages, l’aventure et la chasse aux grands fauves.

Le pilote et son appareil sont recueillis à une dizaine de kilomètres de Calais par le contre-torpilleur Harpon.
La Manche, Latham l’affronta tout d’abord avec un plus léger que l’air. Dans la nuit du 11 au 12 février 1905, il accompagna, en qualité de passager, l’aéronaute Jacques Faure dans un court voyage en ballon, du Crystal Palace à Paris. II se lança ensuite dans les courses de canots automobiles. C’est au cours d’une compétition de ce genre, qui se déroula à Monaco et dont il fut le vainqueur, qu’il fit la connaissance, par l’entremise de son cousin Jules Gastambide, d’un certain Léon Levavasseur.
Ce dernier, ingénieur prolifique, se consacrait depuis un certain temps à la construction de bateaux et de moteurs. Depuis peu, il s’intéressait à la fabrication d’aéroplanes. Après cette rencontre, Latham partit pour l’Abyssinie chasser le buffle et le rhinocéros. De retour en France au mois de décembre 1908, il se rendit aux usines Antoinette de Puteaux, où il put admirer les réalisations de Levavasseur.
L’infortuné de la Manche
C’est seulement en février 1909 que Latham fut pressenti pour piloter les monoplans Antoinette. Bien qu’il n’eût jamais approché un aéroplane de sa vie, il accepta les propositions de Gastambide et de Levavasseur, et fit son entrée au sein du conseil d’administration de la société, qu’il avait décidé de commanditer, avec l’appui de sa famille, à la place de Louis Blériot dont la démission était toute récente.
Mais l’Antoinette était un appareil des plus capricieux. Latham, qui s’était installé à Mourmelon pour apprendre à le dompter, connut bien des difficultés. Après quelques semaines de travail intensif, il parvint malgré tout à battre, le 5 juin 1909, les records d’endurance en vol des monoplans et de vol mécanique français. Le lendemain, il s’appropria le Trophée AmbroiseGoupy après avoir parcouru 6 km en 4 mn 13 s. Puis, comme un coup de foudre, tomba l’annonce de sa participation au concours du Daily Mail, qui offrait un prix de 25 000 francs-or au premier aéroplane qui, sous certaines conditions, réussirait à traverser la Manche.

Latham peu avant le décollage.
Le 2 juillet 1909, l’Antoinette IV quitta son hangar de Puteaux pour être convoyé par chemin de fer jusqu’à Calais. Trois jours plus tard, Latham y débarquait à son tour, s’installant au Grand Hôtel. Restait à trouver l’endroit le mieux adapté à la préparation de la tentative. Après quelques recherches, Latham, Levavasseur et les mécaniciens de l’équipe Antoinette choisirent l’usine du tunnel sous la Manche, construite près de la falaise de Sangatte, à 8 km de Calais.
Malheureusement pour lui, Latham ne bénéficia pas d’un temps favorable pour s’envoler dans les délais qu’il s’était fixés. Bien pis, jamais le vent n’avait soufflé si fort sur la région, et le brouillard joint à la pluie rendait tout décollage extrêmement dangereux. En désespoir de cause, l’aviateur dut se résigner à attendre de meilleures conditions atmosphériques et à griller les centaines de cigarettes turques et égyptiennes que certains fabricants lui envoyaient à titre publicitaire. Un curieux va-et-vient s’établit alors entre Sangatte et le Grand Hôtel de Calais.

Le 19 juillet 1909, Hubert Latham échoue dans sa tentative de traversée de la Manche.
Tous les jours, en effet, Latham se rendait aux installations du tunnel dans l’espoir de voir le temps se dégager. A bout de nerfs, il résolut de tenter quelque chose pour sortir d’une inaction qui le rongeait et effectua un vol d’essai avec l’Antoinette dans la journée du 13 juillet. Mais la foule des curieux gêna son atterrissage, et le monoplan s’abîma au sol. Les dégâts furent rapidement réparés, et l’attente se poursuivit.
Le 19 juillet, le vent se calma tout à coup. Comme une telle occasion risquait de ne pas se représenter de sitôt, Latham prit la décision de tenter sa chance. Aussi, à 6 h 42, peu de temps après le lever du soleil, c’est-à-dire en conformité avec le règlement du concours, l’Antoinette prit l’air. II survola le cap Blanc-Nez et se dirigea vers Douvres.
Mais, à une dizaine de kilomètres de Calais, alors que son aéroplane volait à 300 m d’altitude; Latham sentit son moteur changer de régime et cafouiller, avant de se taire tout à fait. En dépit des tentatives du pilote, le propulseur ne repartit pas. L’Antoinette plana et se posa sans dommage sur les flots. Allumant une cigarette, Latham attendit tranquillement que le contre-torpilleur Harpon vînt le recueillir. Ce fut chose faite à 7 h 20.

Six jours après la première tentative de Latham, Louis Blériot réussissait l’exploit. Ne s’avouant pas vaincu, Latham prenait, le 29 juillet, les commandes de l’Antoinette Vit pour un nouvel essai qui se solda par un échec à 500 m de Douvres.
Après cet échec, la consternation puis le découragement s’emparèrent de l’équipe Antoinette, d’autant plus profonds que le monoplan était irréparable. Seul Latham nourrissait encore quelque espoir. Ayant parié 17 000 francs sur son succès et ne tenant pas à les perdre, il demanda à l’usine de Puteaux de lui expédier d’urgence un autre appareil, l’Antoinette V11, qu’il gardait en réserve.
Bien que le nouveau modèle fût doté d’un moteur plus puissant que celui de son prédécesseur, il avait le net désavantage d’être à gauchissement. Latham n’était pas du tout familiarisé avec ce système, mais il dut s’y habituer d’autant plus rapidement que Blériot venait d’arriver à Calais après avoir annoncé son intention de se lancer lui aussi au-dessus de la Manche.
On connaît la suite. Le 25 juillet, en se réveillant, Latham aperçut le Blériot XI qui volait vers l’Angleterre et le succès. Le 27 juillet, après avoir effectué un vol d’essai avec l’Antoinette V11, le poulain de Gastambide et de Levavasseur tenta de rallier les côtes anglaises. Comble de malchance, et encore une fois à cause de son moteur, son monoplan dut amerrir à 500 m à peine des falaises de Douvres, et Latham fut sérieusement blessé.

En 1911, l’Antoinette de Latham survole l’autodrome de Brooklands (Grande-Bretagne), dont la partie centrale avait été aménagée en piste d’atterrissage.
Celui qui n’avait pas peur du vent
L’aviateur sortit de cette aventure épuisé physiquement et nerveusement. Il décida alors de se lancer dans les affaires, mais échoua assez lamentablement. Sur les conseils d’un certain Pierre Chalmard, il avait en effet obtenu la majorité au conseil d’administration de la société Antoinette, ce qui avait amené Gastambide et Levavasseur à donner leur démission. Mais, très vite, l’entreprise se heurta à de graves difficultés financières. Latham, mis en minorité, accepta le retour de ses associés et se consacra désormais à l’aviation.
Il participa au fameux meeting de Reims-Bétheny, qui marqua l’apothéose du plus lourd que l’air dans cette première décennie du xxe siècle et remporta, à la fin du mois d’août 1909, pour près de 50 000 francs de prix. Il y acquit une grande réputation de courage et de sang-froid en évoluant- ce qu’aucun aviateur ne s’était encore risqué à faire, dans un vent qui soufflait en assez fortes rafales.
Cette attitude, quelque peu suicidaire pour l’époque, s’explique en partie par le fait que Latham se savait atteint de turberculose et n’avait donc plus rien à perdre. Le 7 janvier 1910, à Port-Aviation (Juvisy), il battit le record du monde de hauteur en s’élevant à 1 000 m, mais se le fit presque aussitôt ravir. Puis, il se montra aux meetings de SaintPétersbourg, d’Héliopolis, de Budapest et de Blackpool, affrontant, dans ce dernier cas, une nouvelle fois un vent violent. En avril 1910, au meeting de Nice, son avion dut se poser sur la mer, ce qui ne l’empêcha pas de gagner une forte somme.
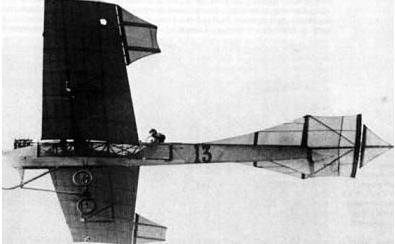
En août 1909, Latham participait, sur Antoinette XXIX, aux épreuves du premier meeting de Reims. Confronté aux plus grands pilotes de l’époque, il s’adjugea les prix de la plus haute altitude, avec 155 m, et de la distance, ayant couvert en 2 h 17 mn 131 km en tours de piste.
Latham effectua ensuite une tournée aux États-Unis, où il se classa quatrième dans la Coupe Gordon Bennett, qui se courait près de New-York. Pour 5 000 dollars, il fit faire un vol à un millionnaire invalide, puis se distingua en inventant un sport nouveau : la chasse au canard en aéroplane. Mais les concours militaires de 1911 ne furent pas favorables à la maison Antoinette, qui connut alors de graves problèmes. Déçu, Latham abandonna le plus lourd que l’air, décidé à ne se consacrer qu’à la chasse. En décembre 1911, il quittait la France pour se rendre en Afrique équatoriale dans le but d’enrichir sa collection de trophées. Et, le 7 juin 1912, au cours d’un safari mené le long du Chari, il fut chargé par un buffle blessé, qui l’encorna et le piétina à mort.